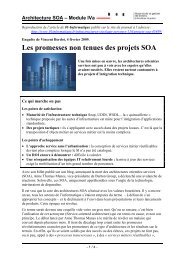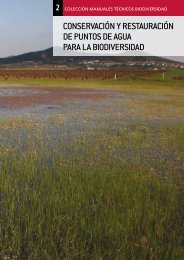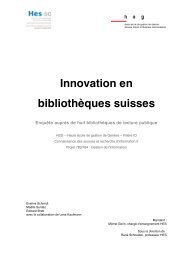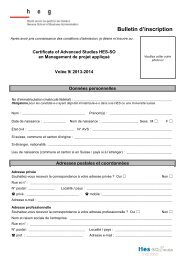Mares temporaires
Mares temporaires
Mares temporaires
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
exigeantes en lumière. Elle aboutit, le plus souvent, à la banalisation<br />
des communautés végétales et animales (pertes des espèces<br />
spécialistes et de la faune n’y effectuant qu’une partie de son<br />
cycle).<br />
La gestion permet de limiter l’accumulation de sédiments minéraux<br />
ou organiques, lorsque les causes en sont bien identifiées. La<br />
dégradation de la végétation dans le bassin versant est une cause<br />
classique d’accélération de l’érosion du bassin versant et, par suite,<br />
de la sédimentation dans les zones humides en aval. Les causes de<br />
cette dégradation peuvent être contrôlées par la gestion (contrôle<br />
du pâturage, fréquentation humaine, pistes véhicules, etc.). Au<br />
minimum une barrière végétale peut être constituée en périphérie<br />
pour stopper le sédiment tout en laissant passer l’eau.<br />
Lorsque le comblement est lié à une accumulation minérale, un<br />
fonctionnement hydrologique correct peut être restauré en surcreusant<br />
la mare et en exportant les sédiments. En fonction de la<br />
taille de la mare, ce creusement pourra être mécanique ou manuel.<br />
Les principales difficultés de la restauration par décapage du sédiment<br />
superficiel sont d’une part le choix du niveau à atteindre<br />
(niveau historique ou à calculer à partir d’objectifs hydrologiques)<br />
et d’autre part la présence ou non de stocks semenciers viables. Le<br />
creusement devra donc être complété par une étude cartographique<br />
du substrat sous-jacent et une analyse des différents horizons<br />
de sols pour localiser les stocks semenciers et si possible les<br />
utiliser pour restaurer la végétation.<br />
La gestion des ligneux<br />
La colonisation des ligneux autour et dans les mares <strong>temporaires</strong><br />
entraîne des problèmes d’ombrage (compétition) et d’accumulation<br />
de litière, et, par suite, des difficultés d’émergence et de développement<br />
pour les espèces héliophiles* (Chapitre 4). L’ouverture<br />
du milieu diminue la compétition pour la lumière et les apports de<br />
litière. En fonction de la superficie de la zone à débroussailler, la<br />
coupe pourra être manuelle (cisaille) ou mécanique (tronçonneuse,<br />
débroussailleuse). Un entretien de la coupe devra ensuite être<br />
assuré, de préférence par des troupeaux qui pourront limiter à la<br />
fois les espèces ligneuses mais aussi les herbacées les plus compétitives.<br />
Selon la nature des espèces que l’on souhaite contrôler, le<br />
choix des herbivores pourra être différent. Par exemple, les caprins<br />
et dans une moindre mesure les ovins seront plus efficaces que les<br />
bovins ou les équins pour contrôler les ligneux.<br />
La gestion par le pâturage doit faire l’objet de convention avec<br />
l’éleveur, où peuvent figurer les périodes éventuelles d’exclusion<br />
du pâturage (sensibilité de certaines espèces à des stades critiques de<br />
leur développement) et les charges maximales à l’hectare (seuil<br />
de risque de surpâturage). L’impact du pâturage peut être mesuré<br />
pour des espèces cibles particulières ou, globalement, pour la<br />
richesse ou la structure des peuplements ou de l’écosystème.<br />
La gestion des hélophytes<br />
La progression des grandes hélophytes (joncs, scirpes, massettes)<br />
dans les mares <strong>temporaires</strong> peut être liée à diverses causes comme<br />
une augmentation de l’épaisseur du sédiment, une élévation et/ou<br />
une stabilisation des niveaux d’eau. Ces espèces fortement compétitives<br />
se développent au détriment des espèces caractéristiques<br />
des mares qui supportent difficilement leur ombrage et l’eutrophisation<br />
du milieu résultant de l’accumulation de leur litière. La gestion<br />
des hélophytes (joncs, scirpes) vise donc, comme pour les ligneux,<br />
à réduire l’ombrage et les apports de litière.<br />
5. Méthodes de gestion et restauration<br />
Encadré 46. Progression des ligneux dans les mares de<br />
Roque-Haute<br />
Dans les mares de la Réserve Naturelle de Roque-Haute (Hérault)<br />
où le pâturage a disparu depuis une cinquantaine d’années, l’expansion<br />
de l’Orme (Ulmus minor) et du Frêne (Fraxinus angustifolia<br />
subsp oxycarpa) semble défavorable aux populations d’Isoetes<br />
setacea 328 . Cette hypothèse a été testée au cours d’une opération<br />
de débroussaillage expérimental. Un an après la coupe des ligneux,<br />
la fréquence des isoètes avait augmenté de 43 % dans la zone<br />
débroussaillée pour une augmentation de 7 % seulement dans la<br />
zone non débroussaillée (effet “année”). De plus, dans les zones<br />
éclaircies, un retrait de la litière augmentait encore de 14 % la fréquence<br />
des isoètes. Une expérimentation complémentaire, en<br />
laboratoire, a montré que la réduction de la lumière affecte la<br />
production de biomasse et la production de spores chez cette<br />
espèce (Fig. 32). Ces résultats suggèrent donc que l’interception<br />
de la lumière par les ligneux, ou plus généralement les espèces<br />
compétitives, suffit pour expliquer la réduction des petites espèces<br />
caractéristiques des mares <strong>temporaires</strong> méditerranéennes. D’autres<br />
effets peuvent s’y associer en particulier ceux associés à la décomposition<br />
de la matière organique ou la modification des sols mais<br />
ils n’ont pas été testés.<br />
Rhazi M.<br />
Dans le cas des hélophytes, la coupe mécanique (débroussailleuse),<br />
suivie de l’évacuation des produits de coupe, pourra être complétée<br />
par l’étrépage*, technique qui consiste à décaper le mat racinaire<br />
pour éliminer radicalement les plantes (équivalent du<br />
dessouchage pour les ligneux) et faciliter la reprise des espèces<br />
exigeantes en lumière (héliophiles). Cette seconde action de gestion<br />
doit être assez précise, et donc souvent manuelle, pour ne pas<br />
décaper une banque de semences sous-jacente qui aurait éventuellement<br />
subsisté sous les hélophytes. L’entretien des coupes<br />
devra être assuré manuellement et/ou par un pâturage raisonné.<br />
Figure 32. Impact de la lumière sur la production de biomasse et<br />
de spores chez Isoetes setacea<br />
Production moyenne de biomasse<br />
souterraine (bulbe en g+/-E.S.)<br />
0.18<br />
0.16<br />
0.14<br />
0.12<br />
0.10<br />
0.08<br />
0.06<br />
0.04<br />
0.02<br />
0.00<br />
0 15 50 75<br />
Réduction de lumière (%)<br />
85