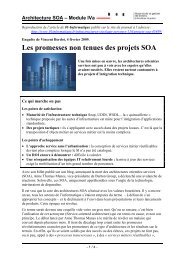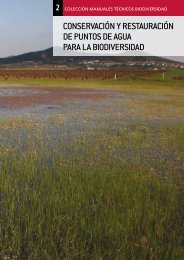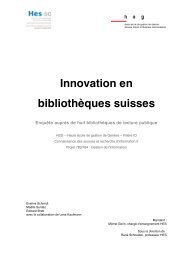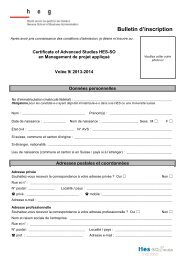Mares temporaires
Mares temporaires
Mares temporaires
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Instabilité du milieu physique et exigences des espèces<br />
pour leur cycle annuel<br />
L’hydropériode* est d’une grande importance pour la reproduction<br />
et la persistance des espèces dans le temps. Elle conditionne largement<br />
le succès de la reproduction et, par là, quelles espèces sont<br />
présentes sur un site donné. Au sein des communautés batrachologiques*<br />
méditerranéennes, les espèces sont plus ou moins flexibles<br />
quant à la date et à la durée de mise en eau (Encadré 20). Certaines<br />
espèces utilisent les mares dès la mise en eau, en automne, pour<br />
s’alimenter (Triton marbré, Triton crêté) ou s’y reproduire (Pélobate<br />
cultripède), d’autres à la sortie de l’hiver seulement (Crapaud commun,<br />
Grenouille agile) et d’autres, enfin, à la fin du printemps (Rainette,<br />
grenouilles vertes). A ces trois catégories, on peut ajouter<br />
les espèces opportunistes comme le Pélodyte ou le Discoglosse, qui<br />
se reproduisent dès qu’il pleut, hormis en plein hiver et au cœur de<br />
l’été.<br />
La grande variabilité entre années des dates de mise en eau des<br />
mares endoréiques* méditerranéennes peut provoquer l’absence de<br />
reproduction une année donnée pour les espèces automnales ou<br />
de fin d’hiver (Encadré 21 et Tab. 1, Chapitre 2a). Le succès de reproduction<br />
peut donc varier selon les années, ce qui diffère assez nettement<br />
des situations observées hors région méditerranéenne où<br />
Encadré 21. Variabilité pluviométrique (1997-2000) et<br />
reproduction des amphibiens dans les mares de Roque-<br />
Haute (Hérault, France).<br />
En 1999, une mise en eau tardive des 198 mares de la Réserve<br />
Naturelle de Roque-Haute (en mai au lieu d’octobre/novembre)<br />
a provoqué, dans la communauté d’amphibiens, une situation<br />
quasi inversée par rapport aux autres années 198 . Les espèces qui<br />
colonisaient le plus de mares en 1997, 1998 et 2000, n’ont pas<br />
pu se reproduire cette année-là. A l’inverse, les espèces qui occupaient<br />
d’habitude un petit nombre de mares, ont pu se reproduire<br />
plus largement (Tab.12). Les espèces précoces comme le Triton<br />
marbré et le Triton palmé, ainsi que l’espèce tardive, la Grenouille<br />
verte, n’ont pas pu ajuster leur date de ponte à une mise en eau<br />
tardive. En revanche, les espèces flexibles comme le Crapaud<br />
calamite ont eu, cette année-là, un succès de reproduction bien<br />
meilleur.<br />
Jakob C.<br />
Tableau 12. Nombre de mares peuplées par des larves de tritons<br />
et des têtards entre 1997 et 2000 sur le site de la Réserve<br />
Naturelle de Roque-Haute.<br />
Nom scientifique Nom commun 1997 1998<br />
année<br />
1999 2000<br />
Bufo calamita Crapaud calamite 2 0 24 2<br />
Hyla meridionalis Rainette méridionale 42 29 39 35<br />
Pelobates cultripes Pélobate 16 1 4 0<br />
Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué 23 17 10 0<br />
Rana perezi Grenouille de Perez 9 10 0 1<br />
Triturus helveticus Triton palmé 40 39 0 27<br />
Triturus marmoratus Triton marbré 37 33 0 34<br />
3. Fonctionnement et dynamique de l’écosystème et des populations<br />
Encadré 22. Durée et plasticité du développement larvaire<br />
En région méditerranéenne, la durée du développement larvaire<br />
conditionne largement le succès reproductif. On y rencontre des<br />
espèces à cycle larvaire long (tritons, Pélobate, alytes), des espèces<br />
à cycle court (Crapaud calamite, discoglosses) et des espèces<br />
intermédiaires (Pélodyte ponctué, Rainette méridionale, grenouilles<br />
vertes). Comme le temps de mise en eau est fonction de<br />
la pluviométrie, l’assèchement du site de reproduction peut se<br />
produire plus tôt une année de faibles précipitations, ce qui<br />
entraîne un échec de la reproduction chez les espèces à cycle long<br />
ou à reproduction tardive. En réponse à ces aléas, les amphibiens<br />
sont capables, dans une certaine mesure (norme de réaction<br />
propre à chaque espèce), d’adapter leur durée de développement<br />
larvaire à la durée de mise en eau 110 . Les années favorables, des<br />
jeunes de grande taille seront produits et les années défavorables,<br />
des jeunes de plus petite taille. L’abaissement du niveau de l’eau<br />
a également pour effet d’accroître la température de l’eau, ce<br />
qui permet aux larves d’accélérer leur développement. Tous ces<br />
mécanismes concourent à une bonne adaptation des amphibiens<br />
au caractère aléatoire du climat méditerranéen.<br />
Jakob C.<br />
la reproduction des amphibiens est le plus souvent annuelle.<br />
En général, ceci ne met pas en danger la survie de la population à<br />
long terme du fait de la longue durée de vie de la plupart des<br />
espèces.<br />
La durée de mise en eau peut également varier entre années avec<br />
un impact important sur le succès reproductif des espèces<br />
(Encadré 22). Une espèce bien adaptée aux mares méditerranéennes<br />
pourra finir ou accélérer son développement jusqu’à la<br />
métamorphose pour échapper à un assèchement précoce, tandis<br />
qu’une espèce à cycle larvaire long ne pourra pas pondre ou sera<br />
condamnée à l’échec cette année-là. Enfin, les remises en eau<br />
occasionnelles ont une grande importance pour les espèces peu<br />
compétitives comme le Crapaud calamite, qui recherche surtout<br />
les mares dépourvues de prédateurs invertébrés et d’autres<br />
espèces d’amphibiens.<br />
Une ponte desséchée de Pelodytes punctatus dans une mare précocement<br />
asséchée<br />
49<br />
Cheylan M.