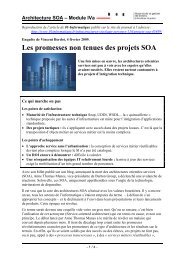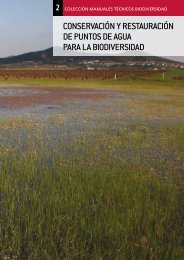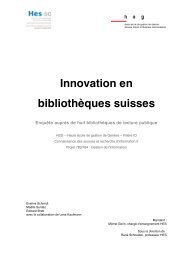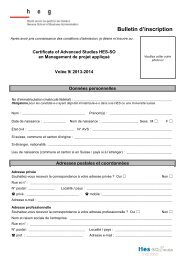Mares temporaires
Mares temporaires
Mares temporaires
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Encadré 31. Espèces rares ou menacées<br />
Il existe plusieurs façons d’être rare (Tab. 13). Pour les habitats très<br />
spécifiques comme les mares <strong>temporaires</strong>, la rareté des espèces<br />
sera plus particulièrement liée à celle de leur habitat (rareté de<br />
distribution plus que de nombre). Isoetes setacea, par exemple,<br />
colonise des sites peu nombreux et épars, mais souvent en grands<br />
effectifs 328 . On trouve toutefois, dans les mares <strong>temporaires</strong>, des<br />
espèces rares en effectifs réduits (par exemple Marsilea à Roque-<br />
Haute) qui, outre le peu de sites potentiels, doivent faire face à des<br />
problèmes démographiques et génétiques liés au nombre restreint<br />
d’individus. Les espèces rares ou menacées présentent souvent une<br />
Taille<br />
des populations<br />
Espèce à grande<br />
aire de répartition<br />
3. Fonctionnement et dynamique de l’écosystème et des populations<br />
Espèce à petite<br />
aire de répartition<br />
diversité génétique faible ou nulle qui résulte généralement du<br />
passage des populations par des goulots d’étranglement limitant<br />
la diversité intra-population et de l’absence de flux de gènes entre<br />
populations résiduelles. On considère généralement qu’une espèce<br />
spécialiste, très adaptée à un milieu particulier, est plus vulnérable<br />
qu’une espèce généraliste. Cependant, la raréfaction de ce milieu<br />
favorable (isolement) sélectionne les gènes induisant une moindre<br />
capacité de dispersion, ce qui, en retour, a de fortes chances de<br />
favoriser une bonne adaptation locale.<br />
Gauthier P.<br />
Tableau 13. Types de rareté chez quelques végétaux présents dans les mares <strong>temporaires</strong> (d’après Rabinowitz et al. 317 )<br />
Habitat peu spécifique Habitat très spécifique<br />
Espèce à grande<br />
aire de répartition<br />
Localement élevée Espèces communes Illecebrum verticillatum<br />
Ranunculus ophioglossifolius<br />
Isoetes velata<br />
Callitriche brutia<br />
Artemisia molinieri<br />
Ranunculus rodiei<br />
Apium crassipes<br />
Espèce à petite<br />
aire de répartition<br />
Partout faible Knickxia commutata Marsilea batardae<br />
Pilularia minuta Teucrium aristatum<br />
Morisia monanthos Damasonium bourgaei<br />
Marsilea strigosa<br />
Laurenbergia tetranda<br />
potentiellement reproducteurs. En dessous de ce seuil, les populations<br />
courent un risque important d’extinction au bout de 50 à<br />
100 générations en raison de la probabilité élevée de l’apparition<br />
de mutations délétères. La protection de populations avec des<br />
effectifs inférieurs à ces seuils est incertaine et les efforts de gestion<br />
devront porter vers l’augmentation des effectifs.<br />
Le critère de taille est souvent déterminant pour décider si une<br />
population requiert ou non un renforcement. Cette estimation sera<br />
facilitée si l’on connaît : l’isolement géographique, l’histoire de la<br />
population, le système de reproduction de l’espèce étudiée, la dispersion<br />
des semences et du pollen, l’histoire évolutive de l’espèce<br />
et de ses populations (expansion ou régression), et l’existence<br />
d’une banque de semences.<br />
Des connaissances sur la diversité génétique de la population peuvent<br />
aussi s’avérer importantes. A long terme, un faible niveau de<br />
variation génétique (dérive) peut diminuer le potentiel d’adaptation<br />
de la population aux changements du milieu. Toutefois, des populations<br />
génétiquement peu diverses localement peuvent être importantes<br />
pour maintenir le niveau de variation global d’une espèce,<br />
en particulier si elles correspondent à des adaptations locales.<br />
Selon les cas, différents principes de gestion devront être appliqués<br />
pour le renforcement des populations des mares <strong>temporaires</strong>.<br />
Dans le cas de populations résiduelles, le renforcement par des<br />
individus issus du même site (après multiplication ex-situ c’està-dire<br />
hors-site) ou de sites très proches doit être favorisé pour<br />
maintenir les adaptations locales et surtout éviter les échecs liés à<br />
la mauvaise adaptation des populations introduites. Le renforcement<br />
par des populations plus lointaines peut, néanmoins, s’avérer nécessaire<br />
si les populations locales sont trop appauvries génétiquement<br />
ou ne peuvent pas être produites ex-situ (effectifs trop réduits,<br />
culture ou élevage non maîtrisée).<br />
Dans le cas de métapopulations* (par exemple Triton, voir Encadré 33),<br />
des échanges peuvent être envisagés plus facilement, particulièrement<br />
entre sites de la métapopulation.<br />
Lors de projets de réintroduction faisant suite à une extinction<br />
locale, les populations sources devront être sélectionnées avec soin,<br />
notamment en fonction des paramètres du milieu, de la proximité<br />
géographique et écologique.<br />
En terme de conservation globale des espèces, il faut tenir compte<br />
du fort niveau d’isolement des populations. Le plus grand nombre<br />
possible de populations devra être préservé pour assurer une représentation<br />
maximale de la diversité génétique et phénotypique des<br />
espèces. Si des populations doivent inévitablement disparaître, il<br />
semble primordial de protéger celles présentant un bon état de<br />
fonctionnement, c’est-à-dire une taille suffisante, une reproduction<br />
régulière et, pour les plantes, une banque de semences viables.<br />
59