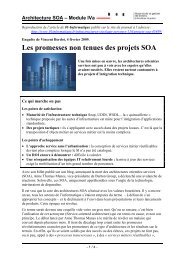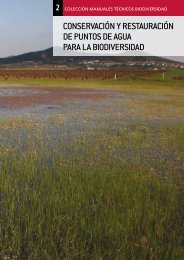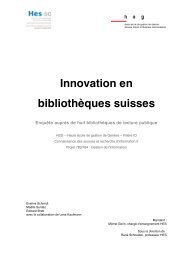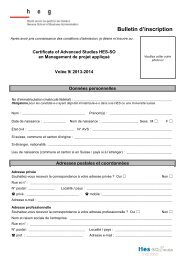Mares temporaires
Mares temporaires
Mares temporaires
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
4. Menaces sur les mares<br />
<strong>temporaires</strong> méditerranéennes<br />
Gauthier P., P. Grillas & M. Cheylan<br />
Les mares <strong>temporaires</strong> sont souvent dispersées dans l’espace et, du<br />
fait de leur faible surface, sont potentiellement faciles à détruire.<br />
Cependant, dans une perspective historique, l’action de l’homme<br />
sur les mares est contrastée : d’une part les pressions anthropiques<br />
multiples les détruisent ou les dégradent, d’autre part de nombreuses<br />
mares ont une origine artificielle, créées pour remplir diverses<br />
fonctions, dont celle d’abreuvoir pour le bétail 373 (Encadré 34).<br />
Aujourd’hui, malgré l’absence de données précises, il est évident<br />
que la dégradation et la destruction des mares <strong>temporaires</strong> méditerranéennes<br />
l’emportent largement sur la création.<br />
Les caractéristiques hydrologiques (durée, hauteur, dates) et la<br />
faible productivité (peu de nutriments*, sécheresse estivale) des<br />
mares <strong>temporaires</strong> sont les facteurs les plus importants pour la<br />
conservation de leurs espèces et de leurs communautés caractéristiques<br />
(Chapitre 3). Lorsqu’elles affectent ces facteurs, les activités<br />
humaines ont un impact sur la conservation des espèces<br />
qu’elles hébergent. Il convient de distinguer les atteintes conduisant<br />
à la destruction directe des mares (urbanisation, comblement,<br />
etc.) des dégradations ou perturbations (par exemple drainage<br />
partiel, pollution), moins irrémédiables, mais qui modifient leur<br />
fonctionnement écologique. L’introduction d’espèces envahissantes,<br />
la fermeture du milieu ou l’atterrissement* naturel perturbent<br />
aussi l’équilibre fragile de ces habitats et de leurs espèces.<br />
Même si la plupart des menaces qui pèsent sur les mares <strong>temporaires</strong><br />
sont communes à l’ensemble du pourtour méditerranéen, on<br />
constate un contraste entre les pays du Nord et ceux du Sud. Utiles<br />
pour une économie agricole basée sur une exploitation extensive, les<br />
mares présentent aujourd’hui un intérêt limité dans la plupart des<br />
régions européennes où elles sont abandonnées ou détruites 284, 373 .<br />
Dans les pays du Sud, elles conservent au contraire une utilité dans<br />
leur contexte économique actuel. Leur importance risque, cependant,<br />
de diminuer à la faveur du développement économique.<br />
Destruction des sites<br />
Au cours des cinquante dernières années, l’urbanisme a subi un<br />
essor très important sur le pourtour méditerranéen, en rapport<br />
avec la croissance démographique et le développement du tourisme.<br />
Les zones humides <strong>temporaires</strong> en milieu périurbain sont confrontées<br />
à des menaces de comblements lors d’aménagements locatifs<br />
ou routiers. Dans la région Languedoc-Roussillon, la majorité des<br />
régressions et des extinctions locales de plantes rares ont été provoquées<br />
par la destruction directe des habitats (urbanisation) et<br />
par l’intensification de l’utilisation des terres 228 . Près d’Agde, les<br />
mares de Rigaud ont disparu lors de la construction d’un lotissement<br />
260 et celles de Notre-Dame de l’Agenouillade (Agde, Hérault)<br />
sont encerclées par l’urbanisation. Les mares du Plateau de Vendres<br />
(Hérault) et de Rodié (Var) ont été dégradées ou partiellement<br />
détruites par des infrastructures routières. A Malte comme au Maroc,<br />
la disparition des mares consécutivement à l’urbanisation est fréquente<br />
près des villes 21, 222, 322 .<br />
La raréfaction des sites a des conséquences importantes sur les<br />
populations, notamment d’amphibiens, en réduisant les échanges<br />
Encadré 34. <strong>Mares</strong> <strong>temporaires</strong> dans le sud de la France :<br />
un bilan parfois positif en nombre mais toujours négatif<br />
en qualité<br />
Aucune étude ne permet aujourd’hui de mesurer le déclin des<br />
milieux <strong>temporaires</strong>. Cependant, si dans certains secteurs du sud<br />
de la France comme le massif des Maures (Var) ou le causse<br />
d’Aumelas (Hérault), les créations sont certainement supérieures<br />
aux disparitions, elles ne leur sont pas équivalentes en qualité.<br />
Dans le massif et la plaine des Maures, les créations ont deux<br />
fonctions principales : des petites retenues d’eau pour la défense<br />
des forêts contre les incendies (DFCI) et des mares à vocation<br />
cynégétiques. Certaines accueillent de belles populations d’amphibiens,<br />
surtout des espèces pionnières* (Crapaud calamite, Crapaud<br />
commun, Pélodyte) mais aussi des espèces rares (Pélobate). En<br />
revanche, elles présentent un faible intérêt sur le plan botanique,<br />
car souvent creusées dans la terre et donc boueuses. Sur le causse<br />
d’Aumelas, de nombreuses mares à vocation cynégétique, également<br />
attractives pour certains amphibiens, ont été créées au cours<br />
des vingt dernières années sans que l’on constate des destructions<br />
de mares anciennes (type lavognes, voir Chapitre 2a).<br />
En Languedoc, Chaline 72 reprenant en 2001 des inventaires de<br />
mares réalisés en 1974 par Gabrion 153 , a constaté une disparition<br />
de 6 mares sur les 94 étudiées. Dans le même temps, les<br />
créations de mares étaient bien plus nombreuses parmi lesquelles<br />
Chaline distingue :<br />
• les mares abreuvoirs, de plus en plus souvent bâchées et donc<br />
peu intéressantes pour la faune et la flore (sur les causses<br />
essentiellement),<br />
• les mares à but cynégétique, petites, souvent cimentées, en<br />
général assez profondes et plus ou moins dépourvues de végétation,<br />
• les retenues collinaires à but de DFCI, alimentées par des ruisselets,<br />
en général profondes et d’assez grande taille.<br />
Ces nouveaux types de mares attirent quelques amphibiens pionniers*<br />
des milieux instables (Crapaud calamite, Pélodyte) ou généralistes<br />
(Crapaud commun, Triton palmé, Rainette méridionale)<br />
mais sont globalement bien plus pauvres que les mares traditionnelles<br />
de cette région.<br />
Cheylan M.<br />
Dans la plaine des Maures, la construction d’un golf a détruit de nombreux<br />
ruisselets <strong>temporaires</strong> à Isoetes duriei<br />
63<br />
Roché J.