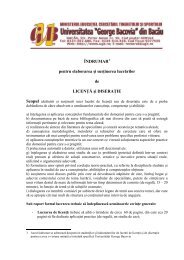BULETIN ÄTIIN IFIC - Universitatea George Bacovia
BULETIN ÄTIIN IFIC - Universitatea George Bacovia
BULETIN ÄTIIN IFIC - Universitatea George Bacovia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Ontos et logos dans une page de „La Peste“ de Camus 105<br />
victoire du rocher”. “Mais [si] les vérités écrasantes périssent d’être reconnues”, 1 seules la<br />
vigilance et la lucidité sont la prophylaxie du mal, tandis que la révolte solidaire en est la<br />
thérapeutique. La première évidence que la catastrophe apporte est que “cette histoire nous<br />
concerne tous”. Telle est d’ailleurs la leçon qu’on tire du texte de la quatrième partie du<br />
roman-chronique de Camus. Si Rieux, par son métier et par conviction, et Tarrou, par<br />
principe, s’engagent dans l’action combattive, Rambert, le journaliste parisien arrivé à Oran<br />
pour y faire un reportage, emploie tous les moyens pour s’en évader et rejoindre sa bien<br />
aimée. Son trajet, du Nord continental (Paris) vers le Sud maritime (Oran), équivaut à une<br />
descensus ad inferos. Il se voit éloigné de son moi, ce qui est associé à une perte, à une<br />
diminution au cours de cette catabase. 2 Et pourtant, la descente s’avère nécessaire prenant<br />
des allures de trajet initiatique pour mieux accomplir son parcours anagogique. Au début<br />
d’octobre, une chance d’évasion s’offre au journaliste. Le jour fixé il se rend à l’hôpital et<br />
demande à Tarrou de le conduire auprès de Rieux et c’est au cours de cette visite que<br />
Rambert annoce sa décision de ne plus quitter la ville pestiférée.<br />
Les événements sont racontés par un narrateur situé en dehors de l’histoire, semblet-il,<br />
ce qui en fait l’objectivité et l’allure de chronique. Ce ne sera qu’en fin de roman que le<br />
narrateur quitte l’anonymat et se dévoile dans la personne du docteur Rieux. Ce système<br />
cryptographique ne vise pas à piquer la curiosité du lecteur, il répond au souci délicat de<br />
réduire la part des éléments personnels dans un témoignage qui reste cependant direct.<br />
Camus réussit à “donner une voix au Nous”, à ne pas tomber dans le “On” car “le véritable<br />
héros de ces pages n’est pas le moi, mais le nous élevé à la dignité de l’être particulier”.<br />
(Rachel Bespaloff, Esprit, janvier 1950, article intitulé Le monde du condamné à mort)<br />
Dans le texte étudié, la vision “du dehors” cède la place à la vision “par derrière”: une<br />
fois pour communiquer l’état de malaise de Rambert dans la salle d’hôpital, et une<br />
seconde fois pour enregistrer brièvement l’épuisement du docteur: ”Rieux semblait<br />
incapable d’émerger de sa fatigue”. (La Peste, p. 89)<br />
Rien de nouveau et pourtant on y perçoit “un geste moderne”, celui par lequel “le<br />
texte domine le sens”. Son tissu privilégie la scène, préparée par la description du décor,<br />
les répliques du dialogue étant séparées (ou réunies) par des silences réflexifs (pour les<br />
locuteurs comme pour le lecteur), par de brèves descriptions (“chaque fois que l’un d’eux<br />
parlait, le masque de gaze se gonflait et s’humidifiait à l’endroit de la bouche’) ou par des<br />
sommaires (“Le silence dura longtemps”) Certains brefs commentaires, entrecroisant le<br />
dialogue, ont l’air des didascalies, indications scéniques ou enregistrenments des états de<br />
Rieux: épuisement accompagné d’une “voix sourde”; redressement et “voix ferme”; effort<br />
de soulèvement; abandon sur son coussin. Cette courbe de l’effort physique et psychique<br />
du docteur semble tracer les moments du combat avec le mal.<br />
Il faut parler mais pour “se mettre sur le bon chemin” (La Peste, p.113) sa parole doit<br />
être claire. Et en effet, ces prises de parole sont en fait des prises de position.<br />
Discours direct et discours indirect alternent presque tout le long du dialogue afin<br />
peut-être d’éviter la monotonie textuelle ou pour limiter le subjectivisme et glisser un<br />
souffle de doute dans les interstices de la liberté de pensée et d’expression du locuteur.<br />
La substitution de la personne subjective “je” par la non-personne “il” 3 et l’introduction du<br />
subordonnant “que”, traits du discours indirect, suggèrent l’impossibilité des trois<br />
personnages de secouer l’oppression du mal. Même en s’en éloignant spatialement<br />
(substitution de la salle d’hôpital par l’espace fermé de la voiture du docteur), celui-ci<br />
continue de les guetter subversivement. À mesure que la distance s’accroît,<br />
l’indépendance discursive s’affermit, vu l’impératif du témoignage de la solidarité mais<br />
aussi parce que l’action se fait pressante et la décision imminente.<br />
<br />
<br />
<br />
1 Camus, Albert (1967): La peste, Gallimard, p.164.<br />
2 Anabase / catabase, termes utilisés par Francis Pruner (1977) dans son livre L’ésotérisme de Saint-John<br />
Perse, Klinksiek, p. 32.<br />
3 Adam, Jean-Michel et Goldenstein, Jean-Pierre (1976): Linguistique et discours littéraire, Larousse, p.42.