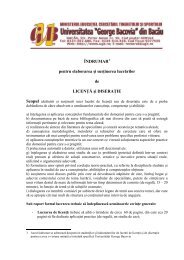BULETIN ÄTIIN IFIC - Universitatea George Bacovia
BULETIN ÄTIIN IFIC - Universitatea George Bacovia
BULETIN ÄTIIN IFIC - Universitatea George Bacovia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ontos et logos dans une page de „La Peste“ de Camus 107<br />
perspective. En amont il avait déclaré: “Je ne crois pas à l’héroïsme…Ce qui m’intéresse<br />
c’est qu’on vive et qu’on meure de ce qu’on aime”. (II-e chapitre, p.80), mais entre temps il<br />
a coopéré avec les équipes sanitaires et la perspective de la fuite lui fait honte maintenant.<br />
Il a appris que le bonheur d’être auprès de sa bien-aimée ne pourrait être complet et il se<br />
sentirait comme un lâche parce que les remords, la honte et les images de la souffrance<br />
finiraient par assombrir l’amour.<br />
Face à ce nouveau problème, la générosité, la compréhension et le devoir animent le<br />
docteur qui se redresse pour plaider d’une “voix ferme” en faveur du bonheur. Cependant, la<br />
réaction de Rambert sera prompte: tout en affirmant, théoriquement, son accord, il avance<br />
l’éventualité d’une opposition, perceptible linguistiquement aussi, par la succession<br />
immédiate du connecteur “mais” à l’affirmatif “oui” et par la distinction entre le terme<br />
“bonheur”, employé par le docteur, nom générique se rapportant à l’espèce humaine, et<br />
“heureux”, employé par Rambert, adjectif descendant au niveau de l’individu et passant de<br />
la notion abstraite à l’état concret de l’être humain. Ce qui, quelques pages auparavant, était<br />
encore valable pour le journaliste, “le bien public est fait du bonheur de chacun” (p.54),<br />
maintenant ne l’est plus:”il peut y avoir de la honte à être heureux tout seul”.<br />
C’est le tour de Tarrou, qui n’ayant manifesté jusque là aucun désir langagier,<br />
prononce une phrase indépendante, fermée sur elle, sans objet ni direct ni indirect,<br />
expression parfaite, la plus nette de la maîtrise de soi, de ce qui semble être l’incarnation<br />
de la direction, de l’autorité. La phrase qui prépare son intervention discursive renforce<br />
cette impression en permettant la lecture du syntagme “s’était tu” [sete ty] comme “[c’]est<br />
têtu” [sete ty], confirmée par la présence du mot tête. On pourrait substituer à la fois le<br />
definiendum (conduire) par le definiens (sa définition) 5 ce qui certifie l’hypothèse avancée<br />
en amont: “Tarrou menait en étant à la tête “ (= conduisait). Il ne déclare pas, comme ses<br />
interlocuteurs, mais “fait remarquer”, révèle, voix de la vérité (discours indirect). Tout en<br />
gardant son immobilité, son inflexibilité (“sans tourner la tête”) (“J’ai entendu tant de<br />
raisonnements qui ont failli me tourner la tête…”, déclare Tarrou à la page 112) – statue<br />
du logicien, du prophète qui regarde tout droit –, il attire l’attention de son interlocuteur,<br />
sans le ménager, sur l’essence du problème, qui ne consiste pas à opposer le bonheur<br />
collectif au bonheur individuel mais “le malheur des hommes”, de la majorité, au bonheur<br />
de l’homme, de l’un. Tarrou récuse le compromis, l’idée d’hybride et, servant sans<br />
défaillance le principe du tiers exclu, il n’accepte pas les demi-mesures. C’est son devoir<br />
d’avertir le journaliste une fois sur l’obligation de choisir soit le service de l’humanité<br />
calamitée et son propre malheur, soit la joie personnelle et encore une fois sur ce moment<br />
de “crise” au sens de “décision”.<br />
Face à cette situation, Rambert se met à l’écart de l’interprétation de Tarrou et<br />
condense en quelques phrases (aperçu de la connaissance en neuf verbes et cinq<br />
phrases) cette évolution irréversible qu’il a vécue du solitaire au solidaire. Il s’y agit de<br />
l’évolution dont parle Camus dans sa Lettre à Roland Barthes sur La Peste (publiée<br />
dans Club, février 1955): “S’il y a évolution de L’ Étranger à La Peste, elle s’est faite dans<br />
le sens de la solidarité et de la participation”. 6<br />
Cet épicuréen qu’était le journaliste se croyait, dans son aveuglement égoïste,<br />
étranger à la ville infernale. Et quoi de plus propice à la prolifération du mal que<br />
l’indifférence Car le danger est de s’habituer à côtoyer le mal et d’en garder le silence,<br />
d’y consentir. La prise de conscience de Rambert n’a été possible qu’après l’expérience<br />
du malheur, de la souffrance humaine, à laquelle se sont superposés la force persuasive<br />
des deux combattants et leur exemple. Il a compris que le combat du fléau, quel que soit<br />
son nom, n’est pas le faire d’un individu ou d’un autre mais de tous. La seule chance<br />
d’exister au monde est celle exprimée par ce raisonnement camusien: “Je me révolte,<br />
<br />
<br />
<br />
5 Emanuel Vasiliu, op. cit., p.101<br />
6 Notice sur La Peste par Louis Faucon, Larousse, 1978, p.28