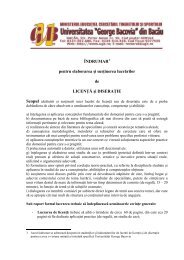BULETIN ÄTIIN IFIC - Universitatea George Bacovia
BULETIN ÄTIIN IFIC - Universitatea George Bacovia
BULETIN ÄTIIN IFIC - Universitatea George Bacovia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
108<br />
Emilia MUNTEANU<br />
donc nous sommes”. Car si le fait d’habiter le mal est indépendant de la volonté de l’être<br />
humain, le fait de le combattre en dépend exclusivement. On y trouve également une<br />
leçon de philosophie qui nous apprend qu’il n’y a pas de savoir a priori; il faut avoir<br />
traversé la connaissance sensorielle pour arriver à la connaissance rationnelle et qu’il faut<br />
apprendre à regarder pour voir. En effet, ce n’est qu’après avoir vu (étape achevée,<br />
exprimée à l’aide du passé composé) que le journaliste sait (indicatif présent) qu’il<br />
appartient volens nolens à ce hic et nunc urgent. “J’ai toujours pensé que j’étais étranger à<br />
cette ville et que je n’avais rien à faire avec vous. Mais maintenant que j’ai vu ce que j’ai<br />
vu, je sais que je suis d’ici, que je le veuille ou non.” Le trajet initiatique ne fait que<br />
préparer son ascension à la solidarité. Le moment n’est plus à la décision mais à l’action<br />
solidaire. Cette conclusion est exprimée avec concision dans une phrase simple à valeur<br />
d’aphorisme et de devise: “Cette histoire nous concerne tous”. Les constituants en sont<br />
modestes: un adjectif démonstratif, un nom commun, “histoire”, qui renvoie d’une part à<br />
l’événement, au référent et d’autre part au récit écrit; un embrayeur personnel, “nous”; un<br />
verbe exprimant l’évidence par sa conjugaison à l’indicatif présent, “concerne”; un pronom<br />
indéfini “tous”. Celui-ci élargit la portée du message en l’éclaircissant. Le pronom<br />
personnel “nous” serait passé presqu’inaperçu (désignant uniquement les personnages)<br />
s’il n’y avait pas eu le pronom indéfini qui implique également le lecteur en tant que témoin<br />
et possible écrivain. Comme une pyramide défiant le temps, cette phrase est séparée du<br />
reste par “un néant” (selon Sartre) où l’on peut lire et penser, néant animé par l’impatience<br />
de Rambert qui répond à la place (le connecteur transitif le permet) des interrogés dont<br />
l’engagement est pourtant la meilleure réponse. Quelque paradoxal que cela puisse<br />
paraître, en se solidarisant avec eux, le journaliste sauve son bonheur car veiller à la<br />
santé des autres pourrait engendrer le contentement du devoir accompli. Mais il attend la<br />
confirmation ou l’infirmation de son espoir inavoué de la part de ceux qui ont l’expérience<br />
de la révolte. Cependant, le silence introspectif se prolonge rendant difficile le retour à<br />
l’ontologie. C’est toujours Rieux qui tourne son soi vers l’autre, comme pour s’offrir tel qu’il<br />
est: un homme nullement omniscient et qui ne peut instruire parce qu’il vit paradoxalement<br />
dans le renoncement et le risque tout en étant convaincu qu’aucune idée ne vaut qu’on lui<br />
sacrifie le bonheur.<br />
Le rythme s’accélère vers la fin de la scène, les phrases sont brèves, composées<br />
d’impératifs traduisant la transformation de la déontologie médicale en programme<br />
d’action. La leçon de Rieux est qu’il faut faire ce qu’il y a de plus urgent à un moment<br />
donné et la générosité de sa pensée cède la place à la fermeté d’action. Tandis que le<br />
commencement du dialogue était centré sur le mode du vouloir, la suite est construite sur<br />
le mode du savoir (dont la fréquence d’occurrences est six).<br />
Les trois personnages se situent sur des positions différentes: Rambert le sentimental,<br />
a acquis un savor partiel, celui d’une expérience limitée du mal; Tarrou, le cérébral, est le<br />
possesseur d’un savoir global, abstrait; Rieux, le docteur humanitaire, possède un savoirfaire<br />
nécessaire pour guérir. Séparés en philosophie, ils se rejoignent dans l’action.<br />
On a déjà remarqué le changement de contexte communicationnel au cours du<br />
dialogue. Le premier se prête à une description plus ample que le second, vu l’importance<br />
de la salle d’hôpital: lieu de la souffrance, de la mort ou de la guérison. La description de<br />
celle-ci est préparée par une profusion d’actes (Tarrou tire deux masques de gaze<br />
hydrophile, en tend un à Rambert, l’invite à s’en couvrir, le journaliste demande, Tarrou<br />
répond) et par l’éveil de la curiosité: “on voyait un curieux mouvement d’ombres”. (p. 88)<br />
Franchir le seuil de la salle est déjà un acte invitant à l’activation de la perception et<br />
forcément à la description. L’embrayeur personnel “ils”, désignant un agent pluriel, est<br />
éloquent pour la concomitance des gestes et pour l’union dans l’action à venir (acte<br />
prémonitoire) préparée par celle consistant à déplacer un obstacle concret: la porte vitrée<br />
qui permet l’accès à la salle d’hôpital. Pour ce qui est de l’embrayeur verbal, le narrateur<br />
préfère “pousser” à “ouvrir” vu que le premier fait référence à “une force agissante qui met