VERS UNE MEMOIRE QUANTIQUE AVEC DES IONS PIEGES
VERS UNE MEMOIRE QUANTIQUE AVEC DES IONS PIEGES
VERS UNE MEMOIRE QUANTIQUE AVEC DES IONS PIEGES
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
tel-00430795, version 1 - 9 Nov 2009<br />
156 CHAPITRE 6. REFROIDISSEMENT DU NUAGE<br />
Comme expliqué à la page 48, le profil en de fluorescence en plateau aux flancs raides est la<br />
marque du régime cristallin. Cela permet de définir sans ambiguïté le volume du cristal. En<br />
considérant, par exemple, les dimensions correspondantes à une chute de 50% de la fluorescence<br />
maximale, elles valent 12 mm dans l’axe du piège et 0.83 mm dans le plan vertical. On<br />
peut évaluer la population atomique présente avec la densité maximale, établie à partir de<br />
la raideur du pseudo-potentiel. La fréquence du mouvement radial est de 46 kHz. On trouve<br />
alors nmax = 8.3 × 10 12 ions/m 3 . Le volume vaut 8.7 mm 3 et le nombre d’ions vaut alors<br />
7.1 × 10 4 .<br />
La forme du cristal est globalement ellipsoïdale, mais on observe en bas à droite du cristal<br />
une zone plus sombre (cette zone est entourée sur la figure 6.16, cliché de droite). La zone<br />
sombre correspond à la présence d’ions non fluorescents, comme par exemple les isotopes 86<br />
et 87 du Strontium ou bien un produit de réaction chimique. Elle est nettement visible sur<br />
le profil axial de la fluorescence. On a tracé des zones grisées correspondant à la zone de<br />
présence de ces ions non fluorescents : elles sont déduites du niveau maximal de fluorescence<br />
mesuré et de la symétrie des bords du profil. A partir de cette lacune de fluorescence, on<br />
peut estimer la fraction des espèces non fluorescentes à 20%. La position apparente de ces<br />
espèces sombres sur les clichés dépend de l’alignement du laser de refroidissement. La figure<br />
6.16 présente deux images où on a précisé le domaine des ions non fluorescents : à droite le<br />
cristal déjà présenté à la figure 6.14, et à gauche un second cristal pour lequel l’alignement du<br />
laser de refroidissement a été modifié et la tension des endcaps augmentée. On observe que<br />
le cristal y adopte une symétrie axiale. Il semble que les ions non fluorescents se répartissent<br />
selon un cylindre aligné sur l’axe du piège au centre du cristal et que les ions fluorescents se<br />
situent, eux, dans un cylindre plus large à la périphérie. La position différent des espèces non<br />
fluorescents sur ces clichés est interprétée par deux effets : d’une part la pression de radiation<br />
et d’autre part le fait que la section des faisceaux lasers est plus faible que celle du cristal.<br />
La pression de radiation pousse les ions fluorescents ce qui tend à les séparer spatialement<br />
des autres ions non fluorescents (l’effet a déjà été observé dans des cristaux contenant deux<br />
isotopes du Barium [161]). Sur le cliché 6.14, le sens du laser de refroidissement est de la<br />
droite vers la gauche, poussant donc les ions fluorescents vers la gauche du nuage. Pour le<br />
second effet, on s’attend à ce que la répartition des ions respecte la symétrie axiale, et selon<br />
l’alignement du laser on excite différentes zones du cristal donnant l’impression sur les clichés<br />
d’un déplacement des espèces.<br />
Notons que les électrodes endcaps ont un effet inattendu sur la forme du cristal : il s’est avéré<br />
au cours des expériences que les électrodes endcaps n’agissaient pas toujours de manière<br />
symétrique. En particulier, lorsqu’elles sont alimentées par une même tension de quelques<br />
volts, le nuage d’ions est décentré, repoussé plus fortement par une des électrodes endcap que<br />
par l’autre. Il s’agit probabalement d’imperfections mécaniques dont les effets deviennent<br />
négligeables pour une tension supérieure à la dizaine de Volts.<br />
Les ions non fluorescents présents dans le piège proviennent du chargement comme les ions<br />
86 Sr + et 87 Sr + , ou bien d’une réaction chimique (voir page 137) comme les ions SrH + 2 ou<br />
SrH + . A partir du cliché gauche de la figure 6.16 on peut extraire des informations sur la<br />
composition du nuage. Pour les cristaux d’ions contenant deux ou davantage d’espèces, on<br />
s’attend à trouver les ions les plus légers au centre et, à mesure que l’on s’en éloigne, à trouver<br />
les espèces de masse de plus en plus importante. D’après cette image, les ions non fluorescents<br />
seraient une espèce chimique plus légère que l’ion 88 Sr + . Il pourrait donc s’agir des ions 86 Sr +<br />
ou 87 Sr + , et d’une petite partie des ions SrH + ( lorsque Sr est un isotope 86 la molécule SrH +<br />
est plus légère que l’ion 88 Sr + ). D’après le rayon des cylindres central et périphérique, le


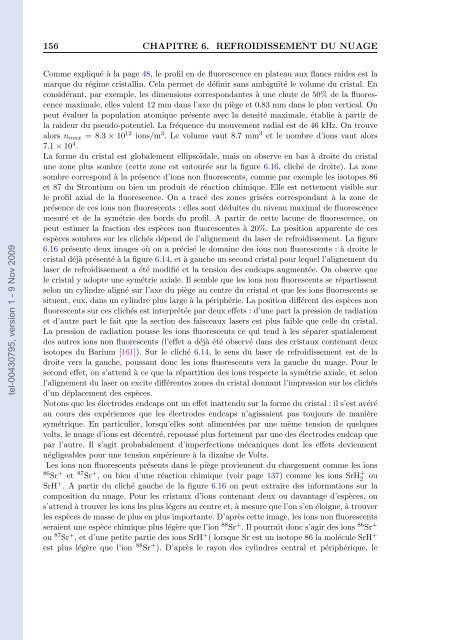













![[tel-00433556, v1] Relation entre Stress Oxydant et Homéostasie ...](https://img.yumpu.com/19233319/1/184x260/tel-00433556-v1-relation-entre-stress-oxydant-et-homeostasie-.jpg?quality=85)