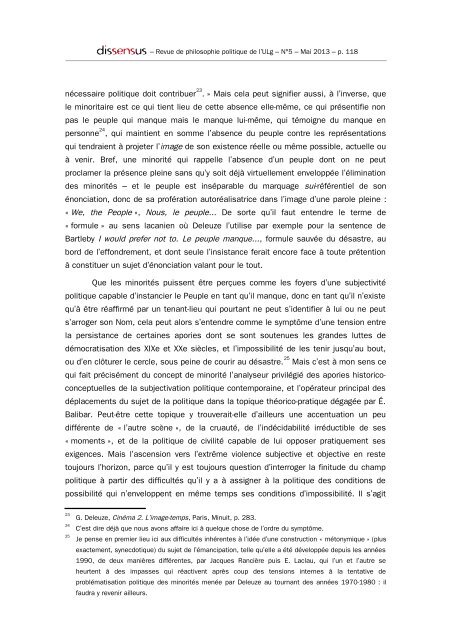Subjectivations politiques et économie des savoirs - Service de ...
Subjectivations politiques et économie des savoirs - Service de ...
Subjectivations politiques et économie des savoirs - Service de ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
– Revue <strong>de</strong> philosophie politique <strong>de</strong> l’ULg – N°5 – Mai 2013 – p. 118<br />
nécessaire politique doit contribuer 23 . » Mais cela peut signifier aussi, à l’inverse, que<br />
le minoritaire est ce qui tient lieu <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te absence elle-même, ce qui présentifie non<br />
pas le peuple qui manque mais le manque lui-même, qui témoigne du manque en<br />
personne 24 , qui maintient en somme l’absence du peuple contre les représentations<br />
qui tendraient à proj<strong>et</strong>er l’image <strong>de</strong> son existence réelle ou même possible, actuelle ou<br />
à venir. Bref, une minorité qui rappelle l’absence d’un peuple dont on ne peut<br />
proclamer la présence pleine sans qu’y soit déjà virtuellement enveloppée l’élimination<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> minorités – <strong>et</strong> le peuple est inséparable du marquage sui-référentiel <strong>de</strong> son<br />
énonciation, donc <strong>de</strong> sa profération autoréalisatrice dans l’image d’une parole pleine :<br />
« We, the People », Nous, le peuple... De sorte qu’il faut entendre le terme <strong>de</strong><br />
« formule » au sens lacanien où Deleuze l’utilise par exemple pour la sentence <strong>de</strong><br />
Bartleby I would prefer not to. Le peuple manque..., formule sauvée du désastre, au<br />
bord <strong>de</strong> l’effondrement, <strong>et</strong> dont seule l’insistance ferait encore face à toute prétention<br />
à constituer un suj<strong>et</strong> d’énonciation valant pour le tout.<br />
Que les minorités puissent être perçues comme les foyers d’une subjectivité<br />
politique capable d’instancier le Peuple en tant qu’il manque, donc en tant qu’il n’existe<br />
qu’à être réaffirmé par un tenant-lieu qui pourtant ne peut s’i<strong>de</strong>ntifier à lui ou ne peut<br />
s’arroger son Nom, cela peut alors s’entendre comme le symptôme d’une tension entre<br />
la persistance <strong>de</strong> certaines apories dont se sont soutenues les gran<strong><strong>de</strong>s</strong> luttes <strong>de</strong><br />
démocratisation <strong><strong>de</strong>s</strong> XIXe <strong>et</strong> XXe siècles, <strong>et</strong> l’impossibilité <strong>de</strong> les tenir jusqu’au bout,<br />
ou d’en clôturer le cercle, sous peine <strong>de</strong> courir au désastre. 25 Mais c’est à mon sens ce<br />
qui fait précisément du concept <strong>de</strong> minorité l’analyseur privilégié <strong><strong>de</strong>s</strong> apories historicoconceptuelles<br />
<strong>de</strong> la subjectivation politique contemporaine, <strong>et</strong> l’opérateur principal <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
déplacements du suj<strong>et</strong> <strong>de</strong> la politique dans la topique théorico-pratique dégagée par É.<br />
Balibar. Peut-être c<strong>et</strong>te topique y trouverait-elle d’ailleurs une accentuation un peu<br />
différente <strong>de</strong> « l’autre scène », <strong>de</strong> la cruauté, <strong>de</strong> l’indécidabilité irréductible <strong>de</strong> ses<br />
« moments », <strong>et</strong> <strong>de</strong> la politique <strong>de</strong> civilité capable <strong>de</strong> lui opposer pratiquement ses<br />
exigences. Mais l’ascension vers l’extrême violence subjective <strong>et</strong> objective en reste<br />
toujours l’horizon, parce qu’il y est toujours question d’interroger la finitu<strong>de</strong> du champ<br />
politique à partir <strong><strong>de</strong>s</strong> difficultés qu’il y a à assigner à la politique <strong><strong>de</strong>s</strong> conditions <strong>de</strong><br />
possibilité qui n’enveloppent en même temps ses conditions d’impossibilité. Il s’agit<br />
23<br />
24<br />
25<br />
G. Deleuze, Cinéma 2. L’image-temps, Paris, Minuit, p. 283.<br />
C’est dire déjà que nous avons affaire ici à quelque chose <strong>de</strong> l’ordre du symptôme.<br />
Je pense en premier lieu ici aux difficultés inhérentes à l’idée d’une construction « métonymique » (plus<br />
exactement, synecdotique) du suj<strong>et</strong> <strong>de</strong> l’émancipation, telle qu’elle a été développée <strong>de</strong>puis les années<br />
1990, <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux manières différentes, par Jacques Rancière puis E. Laclau, qui l’un <strong>et</strong> l’autre se<br />
heurtent à <strong><strong>de</strong>s</strong> impasses qui réactivent après coup <strong><strong>de</strong>s</strong> tensions internes à la tentative <strong>de</strong><br />
problématisation politique <strong><strong>de</strong>s</strong> minorités menée par Deleuze au tournant <strong><strong>de</strong>s</strong> années 1970-1980 : il<br />
faudra y revenir ailleurs.