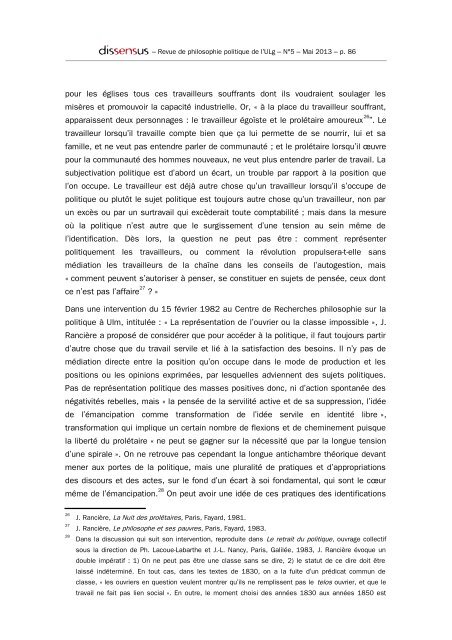Subjectivations politiques et économie des savoirs - Service de ...
Subjectivations politiques et économie des savoirs - Service de ...
Subjectivations politiques et économie des savoirs - Service de ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
– Revue <strong>de</strong> philosophie politique <strong>de</strong> l’ULg – N°5 – Mai 2013 – p. 86<br />
pour les églises tous ces travailleurs souffrants dont ils voudraient soulager les<br />
misères <strong>et</strong> promouvoir la capacité industrielle. Or, « à la place du travailleur souffrant,<br />
apparaissent <strong>de</strong>ux personnages : le travailleur égoïste <strong>et</strong> le prolétaire amoureux 26 ”. Le<br />
travailleur lorsqu’il travaille compte bien que ça lui perm<strong>et</strong>te <strong>de</strong> se nourrir, lui <strong>et</strong> sa<br />
famille, <strong>et</strong> ne veut pas entendre parler <strong>de</strong> communauté ; <strong>et</strong> le prolétaire lorsqu’il œuvre<br />
pour la communauté <strong><strong>de</strong>s</strong> hommes nouveaux, ne veut plus entendre parler <strong>de</strong> travail. La<br />
subjectivation politique est d’abord un écart, un trouble par rapport à la position que<br />
l’on occupe. Le travailleur est déjà autre chose qu’un travailleur lorsqu’il s’occupe <strong>de</strong><br />
politique ou plutôt le suj<strong>et</strong> politique est toujours autre chose qu’un travailleur, non par<br />
un excès ou par un surtravail qui excè<strong>de</strong>rait toute comptabilité ; mais dans la mesure<br />
où la politique n’est autre que le surgissement d’une tension au sein même <strong>de</strong><br />
l’i<strong>de</strong>ntification. Dès lors, la question ne peut pas être : comment représenter<br />
politiquement les travailleurs, ou comment la révolution propulsera-t-elle sans<br />
médiation les travailleurs <strong>de</strong> la chaîne dans les conseils <strong>de</strong> l’autogestion, mais<br />
« comment peuvent s’autoriser à penser, se constituer en suj<strong>et</strong>s <strong>de</strong> pensée, ceux dont<br />
ce n’est pas l’affaire 27 ? »<br />
Dans une intervention du 15 février 1982 au Centre <strong>de</strong> Recherches philosophie sur la<br />
politique à Ulm, intitulée : « La représentation <strong>de</strong> l’ouvrier ou la classe impossible », J.<br />
Rancière a proposé <strong>de</strong> considérer que pour accé<strong>de</strong>r à la politique, il faut toujours partir<br />
d’autre chose que du travail servile <strong>et</strong> lié à la satisfaction <strong><strong>de</strong>s</strong> besoins. Il n’y pas <strong>de</strong><br />
médiation directe entre la position qu’on occupe dans le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> production <strong>et</strong> les<br />
positions ou les opinions exprimées, par lesquelles adviennent <strong><strong>de</strong>s</strong> suj<strong>et</strong>s <strong>politiques</strong>.<br />
Pas <strong>de</strong> représentation politique <strong><strong>de</strong>s</strong> masses positives donc, ni d’action spontanée <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
négativités rebelles, mais « la pensée <strong>de</strong> la servilité active <strong>et</strong> <strong>de</strong> sa suppression, l’idée<br />
<strong>de</strong> l’émancipation comme transformation <strong>de</strong> l’idée servile en i<strong>de</strong>ntité libre »,<br />
transformation qui implique un certain nombre <strong>de</strong> flexions <strong>et</strong> <strong>de</strong> cheminement puisque<br />
la liberté du prolétaire « ne peut se gagner sur la nécessité que par la longue tension<br />
d’une spirale ». On ne r<strong>et</strong>rouve pas cependant la longue antichambre théorique <strong>de</strong>vant<br />
mener aux portes <strong>de</strong> la politique, mais une pluralité <strong>de</strong> pratiques <strong>et</strong> d’appropriations<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> discours <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> actes, sur le fond d’un écart à soi fondamental, qui sont le cœur<br />
même <strong>de</strong> l’émancipation. 28 On peut avoir une idée <strong>de</strong> ces pratiques <strong><strong>de</strong>s</strong> i<strong>de</strong>ntifications<br />
26<br />
27<br />
28<br />
J. Rancière, La Nuit <strong><strong>de</strong>s</strong> prolétaires, Paris, Fayard, 1981.<br />
J. Rancière, Le philosophe <strong>et</strong> ses pauvres, Paris, Fayard, 1983.<br />
Dans la discussion qui suit son intervention, reproduite dans Le r<strong>et</strong>rait du politique, ouvrage collectif<br />
sous la direction <strong>de</strong> Ph. Lacoue-Labarthe <strong>et</strong> J.-L. Nancy, Paris, Galilée, 1983, J. Rancière évoque un<br />
double impératif : 1) On ne peut pas être une classe sans se dire, 2) le statut <strong>de</strong> ce dire doit être<br />
laissé indéterminé. En tout cas, dans les textes <strong>de</strong> 1830, on a la fuite d’un prédicat commun <strong>de</strong><br />
classe, « les ouvriers en question veulent montrer qu’ils ne remplissent pas le telos ouvrier, <strong>et</strong> que le<br />
travail ne fait pas lien social ». En outre, le moment choisi <strong><strong>de</strong>s</strong> années 1830 aux années 1850 est