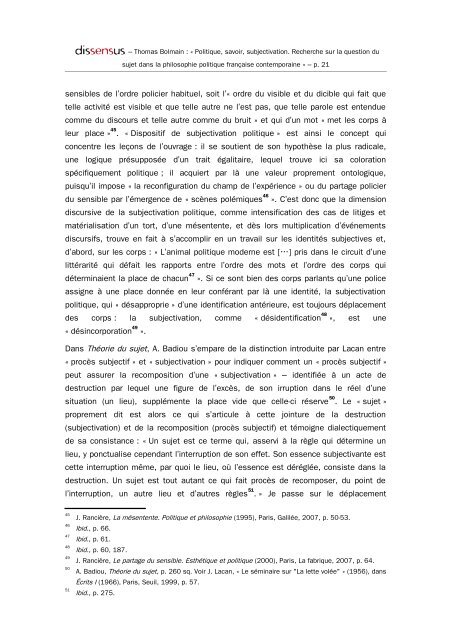Subjectivations politiques et économie des savoirs - Service de ...
Subjectivations politiques et économie des savoirs - Service de ...
Subjectivations politiques et économie des savoirs - Service de ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
– Thomas Bolmain : « Politique, savoir, subjectivation. Recherche sur la question du<br />
suj<strong>et</strong> dans la philosophie politique française contemporaine » – p. 21<br />
sensibles <strong>de</strong> l’ordre policier habituel, soit l’« ordre du visible <strong>et</strong> du dicible qui fait que<br />
telle activité est visible <strong>et</strong> que telle autre ne l’est pas, que telle parole est entendue<br />
comme du discours <strong>et</strong> telle autre comme du bruit » <strong>et</strong> qui d’un mot « m<strong>et</strong> les corps à<br />
leur place » 45 . « Dispositif <strong>de</strong> subjectivation politique » est ainsi le concept qui<br />
concentre les leçons <strong>de</strong> l’ouvrage : il se soutient <strong>de</strong> son hypothèse la plus radicale,<br />
une logique présupposée d’un trait égalitaire, lequel trouve ici sa coloration<br />
spécifiquement politique ; il acquiert par là une valeur proprement ontologique,<br />
puisqu’il impose « la reconfiguration du champ <strong>de</strong> l’expérience » ou du partage policier<br />
du sensible par l’émergence <strong>de</strong> « scènes polémiques 46 ». C’est donc que la dimension<br />
discursive <strong>de</strong> la subjectivation politique, comme intensification <strong><strong>de</strong>s</strong> cas <strong>de</strong> litiges <strong>et</strong><br />
matérialisation d’un tort, d’une mésentente, <strong>et</strong> dès lors multiplication d’événements<br />
discursifs, trouve en fait à s’accomplir en un travail sur les i<strong>de</strong>ntités subjectives <strong>et</strong>,<br />
d’abord, sur les corps : « L’animal politique mo<strong>de</strong>rne est […] pris dans le circuit d’une<br />
littérarité qui défait les rapports entre l’ordre <strong><strong>de</strong>s</strong> mots <strong>et</strong> l’ordre <strong><strong>de</strong>s</strong> corps qui<br />
déterminaient la place <strong>de</strong> chacun 47 ». Si ce sont bien <strong><strong>de</strong>s</strong> corps parlants qu’une police<br />
assigne à une place donnée en leur conférant par là une i<strong>de</strong>ntité, la subjectivation<br />
politique, qui « désapproprie » d’une i<strong>de</strong>ntification antérieure, est toujours déplacement<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> corps : la subjectivation, comme « dési<strong>de</strong>ntification 48 », est une<br />
« désincorporation 49 ».<br />
Dans Théorie du suj<strong>et</strong>, A. Badiou s’empare <strong>de</strong> la distinction introduite par Lacan entre<br />
« procès subjectif » <strong>et</strong> « subjectivation » pour indiquer comment un « procès subjectif »<br />
peut assurer la recomposition d’une « subjectivation » – i<strong>de</strong>ntifiée à un acte <strong>de</strong><br />
<strong><strong>de</strong>s</strong>truction par lequel une figure <strong>de</strong> l’excès, <strong>de</strong> son irruption dans le réel d’une<br />
situation (un lieu), supplémente la place vi<strong>de</strong> que celle-ci réserve 50 . Le « suj<strong>et</strong> »<br />
proprement dit est alors ce qui s’articule à c<strong>et</strong>te jointure <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>s</strong>truction<br />
(subjectivation) <strong>et</strong> <strong>de</strong> la recomposition (procès subjectif) <strong>et</strong> témoigne dialectiquement<br />
<strong>de</strong> sa consistance : « Un suj<strong>et</strong> est ce terme qui, asservi à la règle qui détermine un<br />
lieu, y ponctualise cependant l’interruption <strong>de</strong> son eff<strong>et</strong>. Son essence subjectivante est<br />
c<strong>et</strong>te interruption même, par quoi le lieu, où l’essence est déréglée, consiste dans la<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong>truction. Un suj<strong>et</strong> est tout autant ce qui fait procès <strong>de</strong> recomposer, du point <strong>de</strong><br />
l’interruption, un autre lieu <strong>et</strong> d’autres règles 51 . » Je passe sur le déplacement<br />
45<br />
46<br />
47<br />
48<br />
49<br />
50<br />
51<br />
J. Rancière, La mésentente. Politique <strong>et</strong> philosophie (1995), Paris, Galilée, 2007, p. 50-53.<br />
Ibid., p. 66.<br />
Ibid., p. 61.<br />
Ibid., p. 60, 187.<br />
J. Rancière, Le partage du sensible. Esthétique <strong>et</strong> politique (2000), Paris, La fabrique, 2007, p. 64.<br />
A. Badiou, Théorie du suj<strong>et</strong>, p. 260 sq. Voir J. Lacan, « Le séminaire sur "La l<strong>et</strong>te volée" » (1956), dans<br />
Écrits I (1966), Paris, Seuil, 1999, p. 57.<br />
Ibid., p. 275.