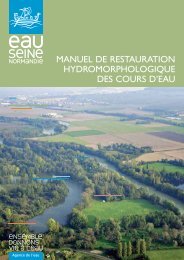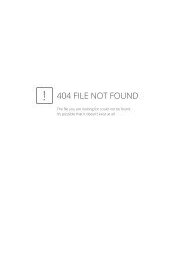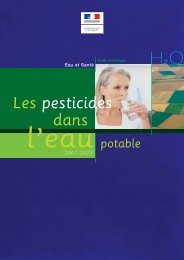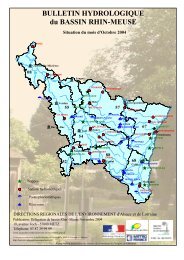Accès au document PDF - Eaufrance
Accès au document PDF - Eaufrance
Accès au document PDF - Eaufrance
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
RéférenceS mai 2011 Environnement littoral et marin<br />
Estimation de la population et du nombre de logements<br />
à moins de 250 m des côtes en recul<br />
Population<br />
Nombre<br />
de logements<br />
1999 138 832<br />
2006 142 811<br />
Évolution 1999-2006 2,9 %<br />
1999 143 783<br />
2006 153 377<br />
Évolution 1999-2006 6,7 %<br />
Source : Eurosion database, 2004 – UE-SOeS CORINE Land Cover, 2006 – © IGN BD Carto®,<br />
occupation des sols, 2000 – Insee, Contours Iris 1999 et 2006. Traitements : SOeS.<br />
Les façades littorales les plus concernées sont les Alpes-Maritimes,<br />
le Finistère, le Pas-de-Calais et le Var pour la population et les Alpes-<br />
Maritimes, la Charente-Maritime, le Var et la Vendée pour le nombre<br />
de logements.<br />
Érosion et milieux naturels<br />
Avec 200 km², les milieux naturels (forêts, dunes, landes…), les surfaces<br />
en e<strong>au</strong> et les zones humides couvrent près de 50 % des terres situées<br />
à moins de 250 m des côtes en recul du fait de l’érosion marine. Les<br />
façades littorales du Pas-de-Calais, de la Manche, du Finistère, de la<br />
Vendée à la Gironde et des Bouches-du-Rhône sont particulièrement<br />
concernées. La disparition de ces espaces naturels peut être la c<strong>au</strong>se<br />
de dommages écologiques importants. En effet, les systèmes dunaires<br />
et les zones humides littorales limitent la force érosive de la mer et<br />
leur destruction peut emballer le phénomène de recul. Malgré cet<br />
intérêt, la protection artificielle de ces linéaires côtiers irait à l’encontre<br />
de leur fonctionnement écologique et il est nécessaire de maintenir<br />
les fluctuations du trait de côte et de préserver des espaces de liberté<br />
pour les interactions entre la terre et la mer.<br />
Les submersions marines concernent de nombreux territoires<br />
Le phénomène de submersion marine<br />
La submersion marine est « une inondation temporaire de la zone<br />
côtière par la mer dans des conditions météorologiques et marégraphiques<br />
sévères » 5 . Il s’agit d’un phénomène brutal, généralement né<br />
de la conjonction de phénomènes extrêmes (dépression atmosphérique,<br />
vent, houle, pluie) et de forts coefficients de marée provoquant une<br />
importante surcote du plan d’e<strong>au</strong> (différence entre le nive<strong>au</strong> marin<br />
observé et le nive<strong>au</strong> prédit de la marée).<br />
Une submersion a lieu lorsque le nive<strong>au</strong> du plan d’e<strong>au</strong> dépasse la<br />
cote des ouvrages de protection ou des terrains en bord de mer,<br />
lorsque la mer crée des brèches et rompt les ouvrages ou les cordons<br />
naturels, ou quand des paquets de mer franchissent les barrages naturels<br />
ou artificiels suite <strong>au</strong> déferlement de vagues de taille importante.<br />
Retour sur la catastrophe Xynthia<br />
Fin février 2010, la tempête Xynthia a été à l’origine d’une<br />
submersion marine dévastatrice. La surcote engendrée par son<br />
passage a été exceptionnelle. Dans les ports de La Pallice à<br />
La Rochelle ou des Sables-d’Olonne, les nive<strong>au</strong>x d’e<strong>au</strong> observés<br />
étaient supérieurs <strong>au</strong>x nive<strong>au</strong>x extrêmes observés en moyenne<br />
une fois par siècle (source : Shom).<br />
Cette submersion est née de la conjonction entre une marée<br />
de coefficient assez élevé (102) et une surcote météorologique<br />
due à la tempête et <strong>au</strong>x très basses pressions atmosphériques<br />
(une chute de la pression de 1 hPa provoque une élévation du<br />
plan d’e<strong>au</strong> de 1 cm).<br />
Des relevés effectués par le BRGM appuyé par l’ONF ont montré<br />
une érosion moyenne des cordons dunaires de 3 à 5 m avec un<br />
maximum de 22 m sur l’île de Ré. Les dunes ont globalement joué<br />
leur rôle de protection. Quelques-unes ont tout de même cédé, la<br />
principale à proximité de La F<strong>au</strong>te-sur-Mer. Les digues et <strong>au</strong>tres<br />
ouvrages de protection ont parfois été submergés par les paquets<br />
de mer. Be<strong>au</strong>coup ont été abimés par la formation de brèches ou<br />
de renards hydr<strong>au</strong>liques (érosion interne de l’ouvrage).<br />
Estimation des nive<strong>au</strong>x d’e<strong>au</strong> le 28 février 2010<br />
à 04 h 30 dans les pertuis charentais<br />
0 10 20 km<br />
En m NGF<br />
5,00<br />
4,80<br />
4,60<br />
4,40<br />
4,20<br />
4,00<br />
3,80<br />
3,60<br />
3,40<br />
3,20<br />
3,00<br />
Source : D’après l’étude du BRGM : « Tempête Xynthia, compte rendu de mission<br />
préliminaire », BRGM/RP-58261-FR, mars 2010.<br />
Les méthodes d’estimation des territoires concernés sont encore<br />
peu précises<br />
La délimitation précise des zones soumises à l’aléa « submersion<br />
marine » est complexe. Elle dépend de nombreux paramètres et ne peut<br />
être définie que localement à partir d’études et de relevés de terrain<br />
importants, sur terre et en mer. Il est par exemple nécessaire de connaître :<br />
– la morphologie des côtes et la bathymétrie : elles permettent de<br />
caractériser les vagues, leur mode de propagation et de déferlement<br />
et les nive<strong>au</strong>x marins extrêmes atteints. Le déferlement des vagues<br />
provoque une surélévation du plan d’e<strong>au</strong> appelée setup, variable<br />
suivant les conditions locales ;<br />
5<br />
D'après la Direction générale de la prévention des risques (DGPR).<br />
– l’altimétrie précise des territoires en c<strong>au</strong>se ;<br />
– l’existence d’ouvrages de protection, leur état et leur h<strong>au</strong>teur.<br />
Il est par contre plus aisé de délimiter l’emprise maximale des zones<br />
basses susceptibles d’être inondées lors de submersions marines. Il<br />
s’agit des territoires littor<strong>au</strong>x dont l’altitude est inférieure <strong>au</strong>x nive<strong>au</strong>x<br />
atteints par la mer lors de conditions extrêmes. Leur délimitation est<br />
globale et ne tient pas compte des particularités locales ayant une<br />
influence sur la h<strong>au</strong>teur exacte du plan d’e<strong>au</strong>. Les ouvrages de protection<br />
du littoral ne sont par ailleurs pas pris en compte. Ils sont « effacés ».<br />
Ce travail de cartographie a été réalisé par le Centre d’études techniques<br />
maritimes et fluviales (Cetmef) et les Cete de l’Ouest et de<br />
Méditerranée pour l’ensemble du littoral métropolitain pour le compte<br />
Les risques naturels<br />
et industriels sur le littoral<br />
Commissariat général <strong>au</strong> développement durable • Service de l'observation et des statistiques<br />
141