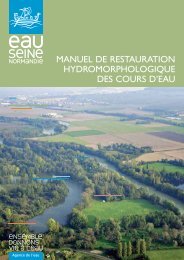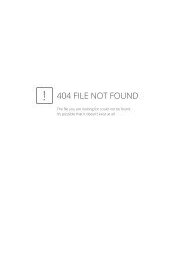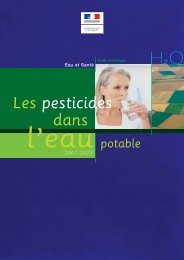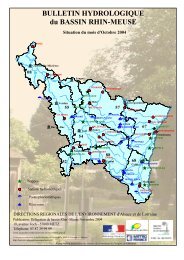Accès au document PDF - Eaufrance
Accès au document PDF - Eaufrance
Accès au document PDF - Eaufrance
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
RéférenceS mai 2011 Environnement littoral et marin<br />
squelette avec une vitesse 50 % plus faible (Laboratoire d’océanographie<br />
de Villefranche-sur-Mer, 2009).<br />
Enfin, la modification des régimes de pluie en réponse <strong>au</strong> changement<br />
climatique provoque de nettes évolutions de la salinité de surface des<br />
océans. Elle <strong>au</strong>gmente dans l’Atlantique et diminue dans le Pacifique.<br />
Impact de la h<strong>au</strong>sse du nive<strong>au</strong> de la mer sur les risques littor<strong>au</strong>x<br />
L’élévation du nive<strong>au</strong> de la mer modifie les aléas « érosion côtière »<br />
et « submersion marine ». Des étendues littorales pourraient être<br />
submergées de manière permanente et des terrains définitivement<br />
perdus.<br />
La houle atteindrait des zones de plus en plus h<strong>au</strong>tes sur les côtes<br />
basses et y arriver avec plus d’énergie. Pour les côtes sableuses, une<br />
élévation du nive<strong>au</strong> de 1 cm pourrait correspondre à un recul de 1 m<br />
(règle de Bruun). Elles pourraient donc reculer de plusieurs dizaines de<br />
mètres en un siècle alors qu’elles représentent 2 400 kilomètres de<br />
rivages en métropole. Pour les côtes rocheuses, l’impact serait plus<br />
limité. Les falaises de roche tendre pourraient tout de même être<br />
sapées plus souvent lors des tempêtes. Pour les estuaires, la situation<br />
est complexe à estimer. L’impact de l’élévation du nive<strong>au</strong> de la mer<br />
dépend de leur configuration, de leur nive<strong>au</strong> d’artificialisation mais<br />
<strong>au</strong>ssi des modifications hydrologiques dues <strong>au</strong> changement climatique<br />
(intensité et saisonnalité des pluies, flux de matière).<br />
Concernant l’évolution de l’aléa « submersion marine », les zones<br />
basses littorales pourraient être submergées de manière plus fréquente<br />
et les submersions centennales atteindre des territoires qui étaient<br />
jusqu’à présent épargnés.<br />
En faisant l’hypothèse d’une élévation de la mer d’un mètre, les<br />
nouve<strong>au</strong>x territoires susceptibles d’être inondés lors de submersions<br />
marines centennales, sans tenir compte de l’évolution du trait de côte<br />
actuel, ont une surface de près de 1 500 km² d’après les trav<strong>au</strong>x<br />
réalisés par le Cetmef et les Cete. En 2006, leur population était estimée<br />
à 340 000 personnes et le nombre de logements à 280 000.<br />
Changement climatique et submersion permanente<br />
des zones basses : le cas du Languedoc-Roussillon<br />
Un important travail de calcul des enjeux a été réalisé sur le<br />
littoral du Languedoc-Roussillon dans le cadre du groupe de travail<br />
« Risques Naturels, Assurances et Adaptation <strong>au</strong> Changement<br />
Climatique » mis en œuvre en application du Plan Climat français<br />
de 2006.<br />
En utilisant les méthodes d’estimation des enjeux développées<br />
par le SOeS présentées précédemment, on estime que plus de<br />
60 000 personnes et 100 000 logements se trouvent dans les<br />
territoires susceptibles d’être submergés de manière permanente<br />
en 2100, surtout sur les rivages hér<strong>au</strong>ltais.<br />
Ainsi, les enjeux liés <strong>au</strong> changement climatique sont importants sur<br />
le littoral métropolitain. Ils pourraient l’être encore plus en Polynésie<br />
française qui compte 84 atolls dont l’altitude moyenne n’excède pas<br />
3 ou 4 mètres et qui pourraient subir des inondations plus fréquemment.<br />
Ces territoires pourraient par ailleurs connaître des cyclones plus<br />
puissants alors que les barrières de corail peineront à se maintenir dans<br />
des e<strong>au</strong>x plus ch<strong>au</strong>des et plus acides. Ces prévisions sont d’<strong>au</strong>tant<br />
plus alarmantes que l’économie polynésienne est dépendante de ses<br />
ressources naturelles : tourisme, pêche, perliculture.<br />
Changement climatique et sites du Conservatoire<br />
du littoral<br />
Une étude a été menée par le Conservatoire du littoral entre<br />
2002 et 2005 pour estimer quel pourrait être l’impact du changement<br />
climatique sur ses sites ou ceux qui sont susceptibles d’être<br />
acquis en 2100 (environ 175 000 ha).<br />
L’érosion du trait de côte pourrait concerner 1,2 % du patrimoine<br />
actuel (650 ha,) surtout dans le Nord – Pas-de-Calais, et<br />
1 % du patrimoine futur (1 500 ha), principalement en Aquitaine<br />
et en Normandie.<br />
Concernant les espaces non endigués, 1 350 ha du patrimoine<br />
actuel pourraient être submergés en 2100, surtout en Normandie et<br />
en Paca. Un peu plus de 3 000 ha du patrimoine futur seraient <strong>au</strong>ssi<br />
concernés, essentiellement en Normandie et en Centre Atlantique.<br />
Pour les territoires poldérisés, les chiffres sont plus importants :<br />
27 500 ha du patrimoine futur du Conservatoire pourraient être<br />
submergés, soit 17 % des prévisions d’acquisition. Ces territoires<br />
sont principalement situés en Normandie et en Centre Atlantique.<br />
La politique de gestion des risques<br />
La politique de gestion des risques est fondée sur deux grands axes<br />
complémentaires :<br />
– en amont des événements, la prévention regroupe l’ensemble des<br />
dispositifs visant à réduire l’impact des aléas sur les personnes et les<br />
biens. Cela comprend la connaissance des événements, leur surveillance,<br />
l’éducation et l’information, la prise en compte des risques dans<br />
l’aménagement par l’intermédiaire de plans de prévention des<br />
risques et la mitigation, ensemble des actions réduisant l’intensité<br />
de certains aléas ou la vulnérabilité des enjeux. Dans les cas les plus<br />
sensibles, il peut <strong>au</strong>ssi être nécessaire de se replier face à la dangerosité<br />
des aléas. C’est une hypothèse retenue sur le littoral face à la<br />
montée des océans et <strong>au</strong> recul de la côte (recul stratégique) ;<br />
– durant et après les événements, la protection comprend les systèmes<br />
d’alerte et la gestion d’après crise.<br />
Sont présentés ici les outils de connaissance, de surveillance et<br />
d’alerte, de prise en compte des risques dans les règles d’urbanisme<br />
ainsi que le principe de recul stratégique.<br />
La connaissance des phénomènes et leur surveillance<br />
La connaissance des territoires à enjeux, leur localisation et leur<br />
caractérisation, la compréhension des aléas, de leur formation, de leur<br />
survenue et de leurs conséquences sont des points importants de la<br />
prévention des risques. Elles permettent d’orienter les règles locales<br />
d’urbanisme et de protection des biens et de mettre en place une surveillance<br />
régulière et optimale des événements prévisibles comme les<br />
tsunamis ou les inondations.<br />
L’évolution du trait de côte est suivie par de nombreux organismes<br />
comme le BRGM, le Cetmef, les universités, les services déconcentrés<br />
de l’État et certaines collectivités locales. Ces suivis sont disparates et<br />
peu coordonnées. C’est pourquoi dans le cadre de la stratégie de<br />
gestion du trait de côte mise en œuvre dans le cadre du Grenelle de<br />
la mer et pilotée par le ministère de l’Écologie, un travail de recensement<br />
des expériences a été réalisé afin de mettre en place progressivement<br />
la centralisation des informations produites localement. En parallèle,<br />
des trav<strong>au</strong>x sont menés sur les côtes françaises pour construire une<br />
Les risques naturels<br />
et industriels sur le littoral<br />
Commissariat général <strong>au</strong> développement durable • Service de l'observation et des statistiques<br />
151