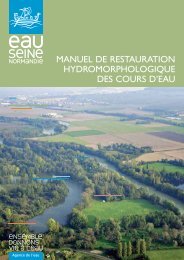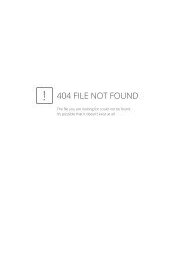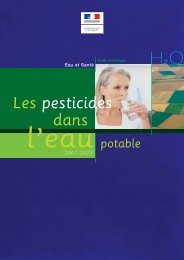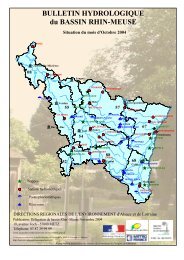Accès au document PDF - Eaufrance
Accès au document PDF - Eaufrance
Accès au document PDF - Eaufrance
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
RéférenceS mai 2011 Environnement littoral et marin<br />
La sédimentation est due <strong>au</strong>x excréments des poissons et coquillages<br />
élevés, <strong>au</strong> surplus de l’alimentation des poissons et <strong>au</strong> blocage des<br />
flux sédimentaires par les tables ostréicoles. Elle peut altérer la biodiversité<br />
du benthos sur un périmètre limité et dans des cas extrêmes,<br />
lorsque le brassage de l’e<strong>au</strong> n’est pas suffisant, provoquer des anoxies<br />
de la colonne d’e<strong>au</strong> ou des fonds marins. Des trav<strong>au</strong>x sont en cours sur<br />
cette problématique dans le cadre de la directive-cadre sur l’e<strong>au</strong> et de<br />
l’évaluation des pressions exercées sur les masses d’e<strong>au</strong> côtières et de<br />
transition.<br />
Les rejets des cheptels peuvent <strong>au</strong>ssi <strong>au</strong>gmenter les concentrations<br />
des e<strong>au</strong>x en nutriments et favoriser les organismes à croissance rapide.<br />
Ce phénomène est peu cité, il est généralement évité lorsque la<br />
dispersion des rejets est rapide, dans des e<strong>au</strong>x suffisamment<br />
renouvelées.<br />
Concernant les zones conchylicoles, certains secteurs du domaine<br />
public maritime concédé sont gagnés par des friches. Elles peuvent<br />
concerner des surfaces importantes et proviennent d’une exploitation<br />
insuffisante des concessions voire de leur abandon. Cela peut provoquer<br />
des reh<strong>au</strong>ssements des fonds, des envasements <strong>au</strong>tour d’anciennes<br />
tables ou de blocs de béton gagnés par les naissains et avoir un impact<br />
sur les paysages ou sur l’hydr<strong>au</strong>lique des bassins de production et donc<br />
sur le rendement des <strong>au</strong>tres parcelles exploitées. Le coût de nettoyage<br />
de ces terrains est généralement élevé et rend difficile l’installation de<br />
nouve<strong>au</strong>x exploitants.<br />
Enfin, la pisciculture intensive en mer peut avoir des conséquences<br />
sur son environnement du fait de l’utilisation de produits chimiques<br />
(médicaments, compléments alimentaires, désinfectants…) et des<br />
risques de transmission de pathogènes ou d’hybridation des espèces<br />
élevées avec des souches s<strong>au</strong>vages. S’il est possible de gérer tous ces<br />
risques pour les structures en bassin, cela devient plus compliqué pour<br />
les élevages en cages.<br />
Vers une pêche durable<br />
Des stocks de poissons fortement exploités<br />
La production mondiale de poissons, mollusques et crustacés était<br />
de 145 millions de tonnes en 2009, issues de la pêche (62 %) et de<br />
l’aquaculture (38 %). Elle a fortement <strong>au</strong>gmenté ces dernières décennies<br />
du fait de la croissance de la population mondiale et de l’<strong>au</strong>gmentation<br />
de la consommation moyenne par personne de produits de la mer.<br />
En métropole, elle est de 34 kg/pers./an. Elle a plus que doublé depuis<br />
trente ans. Elle est plus faible en Guyane (19 kg) et à la Réunion<br />
(18 kg) mais est plus forte dans les Antilles (40 kg) 10 . Parmi les<br />
145 millions de tonnes produites, 118 sont destinées à l’alimentation<br />
humaine, soit une consommation moyenne mondiale d’environ 17 kg<br />
par habitant et par an. À l’horizon de 2020-2030, la FAO estime qu’elle<br />
devrait atteindre 130 à 150 millions de tonnes.<br />
Plus de 80 % des stocks 11 mondi<strong>au</strong>x de poissons sont pleinement<br />
exploités ou surexploités (FAO, 2009) alors que la ressource a longtemps<br />
été estimée inépuisable. Les e<strong>au</strong>x européennes n’y échappent pas et<br />
une part importante des stocks est trop exploitée.<br />
Les captures françaises en Atlantique du Nord-Est ont atteint un pic<br />
dans les années 70. Elles ont diminué depuis de plus de 30 % en<br />
passant de 600 à 700 000 tonnes à un peu plus de 400 000 tonnes<br />
en 2008.<br />
En milliers de tonnes<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
Évolution des captures des navires français depuis 1950<br />
Atlantique Nord-Est<br />
Méditerranée<br />
Autres secteurs<br />
Moyenne mobile à 5 ans<br />
1950<br />
1954<br />
1958<br />
1962<br />
1966<br />
1970<br />
1974<br />
1978<br />
1982<br />
1986<br />
1990<br />
1994<br />
1998<br />
2002<br />
Source : Eurostat, 2009. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).<br />
En 2006, l’essentiel des captures des navires européens est opéré<br />
<strong>au</strong> nord de la Scandinavie, sur les côtes groenlandaises, en mer du<br />
Nord, dans les e<strong>au</strong>x baltes et en mer d’Écosse. Les quantités capturées<br />
dans les e<strong>au</strong>x méditerranéennes sont moins importantes. Be<strong>au</strong>coup<br />
des stocks en question font l’objet de suivis scientifiques en Atlantique<br />
du Nord-Est. Cette part est plus faible en Méditerranée.<br />
La part des stocks exploités <strong>au</strong>-delà des limites biologiques est<br />
variable suivant les zones de pêche. Elle est généralement forte en<br />
Méditerranée et un peu plus faible dans les différentes zones de pêche<br />
de l’Atlantique du Nord-Est.<br />
En Atlantique du Nord-Est, la situation est plutôt bonne pour les<br />
espèces pélagiques (espèces vivant dans la colonne d’e<strong>au</strong> comme les<br />
maquere<strong>au</strong>x ou les harengs). Seulement 13 % de leurs stocks ont une<br />
biomasse inférieure <strong>au</strong> seuil de préc<strong>au</strong>tion en 2006. La situation est<br />
plus critique pour les espèces benthiques vivant sur les fonds marins<br />
(poissons plats, crustacés et coquillages). Après une amélioration<br />
entre 2000 et 2004, la part des stocks sous le seuil de préc<strong>au</strong>tion <strong>au</strong>gmente<br />
de nouve<strong>au</strong> pour atteindre 42 % en 2006. La situation est sensiblement<br />
la même pour les espèces démersales (vivant près du fond),<br />
à forte valeur commerciale, comme le cabill<strong>au</strong>d et l’églefin. Plus d’un<br />
stock sur deux est pêché en dehors des limites biologiques de sécurité<br />
depuis plusieurs années.<br />
2006<br />
2008<br />
Économie et environnement<br />
littoral et marin<br />
10<br />
Données du Conseil économique et social, 2007.<br />
11<br />
Un stock est la partie exploitable de la population d’une espèce dans une zone maritime<br />
donnée.<br />
Commissariat général <strong>au</strong> développement durable • Service de l'observation et des statistiques<br />
87