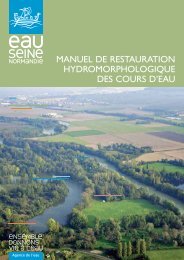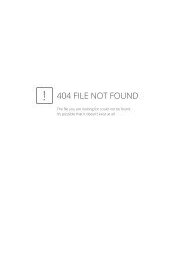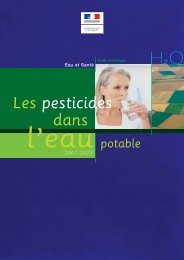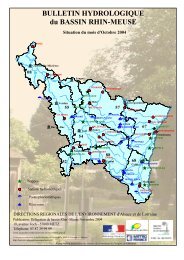Accès au document PDF - Eaufrance
Accès au document PDF - Eaufrance
Accès au document PDF - Eaufrance
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
RéférenceS mai 2011 Environnement littoral et marin<br />
– énergie potentielle : barrages (marémotrice de la Rance, plus puissante<br />
unité <strong>au</strong> monde) sur les estuaires ou dans des lagons artificiels ;<br />
– énergie thermique : différence de température entre les couches<br />
superficielles et profondes, surtout en zone intertropicale ;<br />
– biomasse à partir de culture de microalgues lipidiques.<br />
Les énergies marines renouvelables (EMR) devront faire partie du<br />
bouquet énergétique français. Le Grenelle de la mer a fixé un objectif<br />
de 6 000 MW en 2020, objectif réaffirmé par la programmation pluriannuelle<br />
des investissements de juin 2009. Les technologies sont<br />
actuellement disponibles pour les éoliennes, les houlomoteurs et les<br />
marémotrices. Concernant l’utilisation de la différence de température<br />
– énergie thermique des mers (ETM), des premiers trav<strong>au</strong>x ont été réalisés<br />
par l’Ifremer à Tahiti durant les années 80. Ils n’ont pas abouti <strong>au</strong><br />
stade industriel, le coût du kWh produit était trop élevé alors que le<br />
prix du pétrole diminuait. Un projet de démonstrateur est prévu à la<br />
Réunion avec l’appui de la société DCNS. Pour les éoliennes flottantes,<br />
la production industrielle est prévue dans quelques années. Pour la<br />
biomasse, un premier prototype de production d’algues lipidiques<br />
existe à la Réunion. Différentes études montrent que les rendements<br />
en lipides des algues sont nettement supérieurs à ceux des productions<br />
terrestres comme les palmiers à huile ou le colza.<br />
Les engagements du Grenelle de la mer prévoient le financement<br />
de démonstrateurs (éolien flottant, houlomoteur, hydrolien, énergie<br />
thermique), mais <strong>au</strong>ssi de réfléchir sur des prix de rachat de l’électricité<br />
attractifs tout en s’appuyant sur l’initiative Ipanema (Initiative partenariale<br />
nationale pour l’émergence des énergies marines)<br />
rassemblant de très nombreux acteurs. Les démonstrateurs seront mis<br />
en œuvre dans le cadre d’une plate-forme basée à Brest. Ils seront installés<br />
sur toutes les côtes en fonction de leur potentiel d’exploitation.<br />
Le montage de ce projet est assuré par l’Ifremer.<br />
Du fait de la diversité de ses côtes et de leur climat, et de l’importance<br />
des e<strong>au</strong>x sous juridiction, la France dispose d’un gisement impor-<br />
tant pour la production d’énergie en mer. Elle dispose par exemple de<br />
20 % de la ressource hydrolienne en Europe et d’un potentiel intéressant<br />
en énergie thermique dans les territoires d’outre-mer. Pour les<br />
territoires insulaires ultramarins, l’objectif sera d’assurer dès que possible<br />
leur <strong>au</strong>tonomie énergétique, ils constitueront donc des zones<br />
d’action prioritaires pour les EMR.<br />
Des contraintes d’installation assez fortes<br />
Localisation des projets en mer<br />
Comme pour l’exploitation de granulat, de très nombreux paramètres<br />
sont à prendre en compte pour configurer et localiser les nouve<strong>au</strong>x<br />
projets d’EMR. Ils sont tout d’abord d’ordre technique. Les hydroliennes<br />
nécessitent plus de 20 m de profondeur et des courants d’<strong>au</strong> moins<br />
2 m/s. Les éoliennes sont envisageables pour des profondeurs inférieures<br />
à 30 m et des vents moyens supérieurs à 7 m/s et les houlomoteurs pour<br />
des houles ayant une puissance moyenne supérieure à 20 kW/m. Tous<br />
ces systèmes doivent par ailleurs être raccordés à des postes électriques,<br />
à terre. Ils ne doivent donc pas être situés trop loin de la côte et des transformateurs.<br />
En métropole, les littor<strong>au</strong>x de la Manche, de l’Atlantique nord<br />
et du golfe du Lion sont les plus intéressants. Le plate<strong>au</strong> continental y est<br />
large, les profondeurs peu importantes et les houles et les vents peuvent<br />
être forts comme en Bretagne nord et dans le Cotentin.<br />
Il est par ailleurs nécessaire de prendre en compte les usages et les<br />
contraintes écologiques dans le périmètre d’exploitation mais <strong>au</strong>ssi<br />
entre le parc et le lieu de raccordement électrique à terre (passage des<br />
câbles sous-marins lorsqu’ils ne sont pas ensouillés) : espaces protégés,<br />
zones de navigation et sécurité maritime, zones de défense (zones<br />
de tir, de mouillage, de vol à basse altitude, de stationnement de sousmarins…),<br />
activités et usages (extraction de granulat, zones de pêche,<br />
concession conchylicole, zones de clapage, bassin de navigation de<br />
plaisance), présence d’enjeux écologiques…<br />
Les éoliennes terrestres dans les communes littorales<br />
La façade Manche – mer du Nord, le nord de la façade<br />
atlantique et la façade méditerranéenne sont intéressantes<br />
pour l’implantation d’éoliennes terrestres.<br />
D’après les données de France énergie éolienne, les<br />
communes littorales disposent de 459 éoliennes, soit<br />
23 % du total, avec une puissance de 260 MW. Elles<br />
sont 187 sur les côtes métropolitaines (11 % des<br />
éoliennes hexagonales) principalement dans le Finistère,<br />
l’Aube, les Bouches-du-Rhône et en H<strong>au</strong>te-Corse<br />
et 272 dans les départements d’outre-mer, surtout en<br />
Guadeloupe. Ces dernières sont adaptées <strong>au</strong> contexte<br />
intertropical. Elles sont de petite taille et développent<br />
une puissance faible à moyenne.<br />
Début novembre 2010, le ministère du Développement<br />
durable a lancé un appel d’offres portant sur la<br />
construction d’ici 2013, d’éoliennes terrestres dans les<br />
quatre départements d’outre-mer, dans les collectivités<br />
antillaises de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et en<br />
Corse.<br />
© L<strong>au</strong>rent Mign<strong>au</strong>x, MEDDTL<br />
Puissance moyenne du vent<br />
en W/m² de section verticale<br />
prise à 50 m du sol<br />
Plaine<br />
> 500<br />
Littoral<br />
> 700<br />
Collines<br />
> 1 800<br />
> 300<br />
> 200<br />
> 100<br />
0-100<br />
> 400<br />
> 250<br />
> 150<br />
0-150<br />
> 1 200<br />
> 700<br />
> 400<br />
0-400<br />
Éoliennes dans le port de Boulogne-sur-Mer..<br />
Source : D’après l’Ademe, Centre d’analyse stratégique,<br />
nov. 2009 : le pari de l’éolien, 49 p.<br />
94 Commissariat général <strong>au</strong> développement durable • Service de l'observation et des statistiques