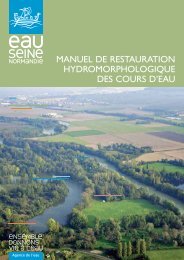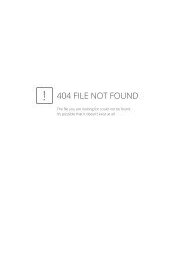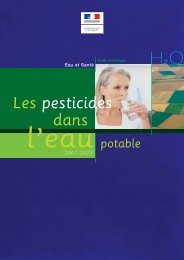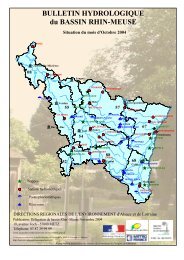Accès au document PDF - Eaufrance
Accès au document PDF - Eaufrance
Accès au document PDF - Eaufrance
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
RéférenceS mai 2011 Environnement littoral et marin<br />
Population des communes littorales dotées d’<strong>au</strong> moins un PPRN approuvé<br />
Population totale Population des communes dotées d’un PPRN approuvé Part de la population<br />
En 2006<br />
Évolution entre 1999<br />
Évolution entre 1999 des communes dotées<br />
En 2006<br />
et 2006 (en %)<br />
et 2006 (en %) d’un PPRN (en %)<br />
Nord – Pas-de-Calais 349 228 -1,4 96 961 0,1 27,8<br />
Picardie 22 738 2,9 6 269 0,6 27,6<br />
H<strong>au</strong>te-Normandie 303 355 -3,1 2 780 -1,8 0,9<br />
Basse-Normandie 274 605 1,9 32 946 2,8 12,0<br />
Façade Manche – mer du Nord 949 926 -0,9 138 956 0,7 14,6<br />
Bretagne 1 158 218 3,9 100 690 4,2 8,7<br />
Pays de la Loire 293 571 8,7 - 0,0 0,0<br />
Poitou-Charentes 226 546 5,4 48 567 5,6 21,4<br />
Aquitaine 311 314 10,2 89 168 9,6 28,6<br />
Façade atlantique 1 989 649 5,7 238 425 6,5 12,0<br />
Languedoc-Roussillon 394 425 13,0 245 543 11,0 62,3<br />
PACA 2 518 633 4,9 2 101 247 4,8 83,4<br />
Corse 230 720 13,6 152 545 13,8 66,1<br />
Façade méditerranéenne 3 143 778 6,4 2 499 335 5,9 79,5<br />
Littoral métropolitain 6 083 353 5,0 2 876 716 5,7 47,3<br />
Guadeloupe 390 234 3,7 241 077 5,4 :61,8<br />
Martinique 351 358 4,3 351 358 4,3 100,0<br />
Guyane 149 784 23,2 139 144 22,3 92,9<br />
Réunion 688 979 10,4 426 249 8,9 61,9<br />
Littoral ultramarin 1 580 355 8,4 1 157 828 8,2 73,3<br />
Ensemble du littoral 7 663 708 5,7 4 034 544 6,4 52,6<br />
Source : MEDDTL-DGPR, base Gaspar, juin 2010. Traitements : SOeS (Observatoire du littoral).<br />
Les deux dernières solutions sont limitées à des zones à faibles<br />
enjeux ou à certaines configurations et la politique de gestion durable<br />
du trait de côte devra passer par les deux premières méthodes. Le<br />
choix se fera en fonction des enjeux, du type de côte et des études<br />
« coûts/avantages » des différentes techniques.<br />
Un premier exemple de recul existe en France. Il s’agit de la route<br />
côtière située à proximité immédiate de la plage sur le lido entre Sète<br />
et Marseillan, dans l’Hér<strong>au</strong>lt. Son maintien nécessitait d’importants<br />
trav<strong>au</strong>x à chaque tempête et entravait le fonctionnement naturel du<br />
système dunaire. Son recul derrière le cordon permettra, une fois la fin<br />
des trav<strong>au</strong>x en 2011, de reconstituer un ensemble de plages et de<br />
cordons dunaires d’une largeur de 70 m.<br />
Le recul stratégique est <strong>au</strong> cœur des réflexions mises en œuvre dans<br />
le cadre du Grenelle de la mer et de la future stratégie nationale de<br />
gestion du trait de côte. Son choix implique de bien connaître les phénomènes<br />
en cours, de localiser le plus précisément possible le futur<br />
trait de côte et les espaces potentiellement concernés, de mettre en<br />
place des politiques de réserves foncières afin de réinstaller les différents<br />
biens en jeu. Il s’agira d’un axe de réflexion majeur pour les<br />
années à venir.<br />
La prise en compte de la directive inondations concernant les risques de submersion<br />
La directive 2007/60/EC du 23 octobre 2007, dite directive inondations,<br />
établit un cadre européen pour l’évaluation et la gestion<br />
des risques d’inondation concernant la santé, l’environnement,<br />
le patrimoine culturel et les activités économiques. Elle prend spécifiquement<br />
en compte les risques de submersion marine.<br />
Sa mise en œuvre requiert trois étapes successives :<br />
– évaluation préliminaire du risque d’inondation (EPRI) : elle a pour<br />
but d’estimer les conséquences potentielles des submersions. Elle<br />
fournit une vision générale et homogène de l’ensemble du territoire<br />
à moyenne échelle (entre 1/50 000 et 1/100 000) avec les<br />
données disponibles et devra être établie pour la fin 2011. Un premier<br />
travail méthodologique a été réalisé <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> national sous<br />
l’égide de la Direction générale pour la Prévention des Risques. Il<br />
précise, entre <strong>au</strong>tre, l’ensemble des zones basses potentiellement<br />
submersibles et présentées précédemment. Ce travail de localisation<br />
des zones d’aléas sera affiné dans chaque région par les services<br />
déconcentrés de l’État à partir des données fournies <strong>au</strong> nive<strong>au</strong><br />
national et des données historiques et <strong>au</strong>tres informations collectées<br />
localement.<br />
– une fois l’EPRI établi, les territoires représentant des risques de submersion<br />
importants (TRI) devront être sélectionnés avec des critères<br />
homogènes pour tout le territoire. Ils feront l’objet de cartes d’aléas<br />
et de risques à des échelles assez grandes fin 2013.<br />
– enfin, des plans de gestion des risques inondation (PGRI) coordonnés<br />
seront à produire sur les TRI pour fin 2015.<br />
Tout ce cheminement s’intègre dans le cadre de la stratégie nationale<br />
de gestion des risques d’inondation prévue par la loi portant<br />
engagement national pour l’environnement (Loi Grenelle II) qui transpose<br />
en droit français la directive Inondations.<br />
154 Commissariat général <strong>au</strong> développement durable • Service de l'observation et des statistiques