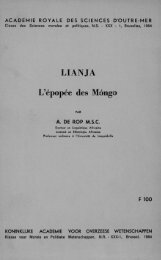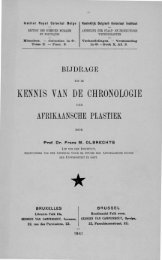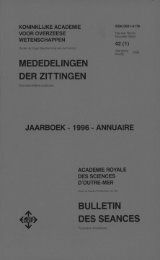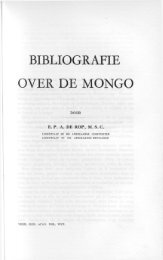KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR OVERZEESE WETENSCHAPPEN ...
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR OVERZEESE WETENSCHAPPEN ...
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR OVERZEESE WETENSCHAPPEN ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
— 306 —<br />
288-1 (moins bien conservé) soit approximative, on peut relativiser, de façon fort<br />
satisfaisante, la position des Australopithèques par rapport à la variabilité des<br />
espèces actuelles. Cette position est très cohérente malgré le temps et la distance<br />
qui séparent les deux fossiles: presque un million d’années et plus de<br />
4 500 km.<br />
4. Cérébralisation<br />
C’est vers deux millions d’années que l’autre grand signe d’hominisation<br />
prend forme. Il s’agit de la cérébralisation.<br />
Un crâne doit être relativement complet pour pouvoir estimer le volume du<br />
cerveau qu’il a contenu. A ce jour, nous avons suffisamment de fossiles permettant<br />
de reconstituer le volume cérébral et d’observer son évolution dans le temps<br />
(O rban-S egebarth 1986).<br />
Depuis les Australopithèques jusqu’aux Néandertaliens, soit sur une période<br />
de près de trois millions d’années, on connaît une bonne soixantaine de capacités<br />
endocrâniennes. L’essentiel des données accessibles a été reporté sur la figure<br />
3 (O rban-S egebarth 1986).<br />
Le cerveau de l’Homme actuel mesure en moyenne près de 1 400 cm’, c’est-<br />
à-dire trois fois celui d’un gorille (archives T w iesselm a n n, L a nnier 2005).<br />
A toute époque et depuis les plus vieux fossiles humains, l’étendue des variations<br />
du volume cérébral est du même ordre de grandeur (fig. 3). Cette variabilité<br />
peut soit être celle d’une unique population menant progressivement à<br />
l’Homme moderne, soit englober la variabilité de deux ou plusieurs espèces<br />
contemporaines d’Homininae. Ainsi, parmi les capacités crâniennes d’il y a deux<br />
millions d’années, se trouvent à la fois des Homo habilis et des Australopithèques<br />
robustes.<br />
Il est cependant ardu d’expliquer les processus évolutifs et de voir comment<br />
les moyennes et les extrêmes se sont déplacés pour que la courbe de Laplace-<br />
Gauss, représentative d’une population initiale, finisse par ne plus recouper la<br />
population «fille» (fig. 4). (cf. modèles de passage d’une espèce (A) à une autre<br />
(B), d’après T intant 1983, in F erembach 1986).<br />
5. Réduction des dimensions dentaires<br />
Parmi les restes fossiles, les dents fournissent un matériel de choix. En effet,<br />
elles résistent particulièrement bien aux dégradations taphonomiques [2] et elles<br />
* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes, p. 318.