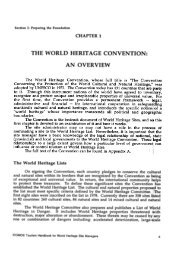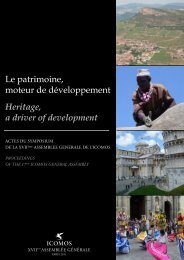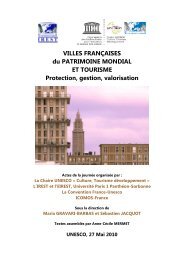PARTIE 2 - Icomos
PARTIE 2 - Icomos
PARTIE 2 - Icomos
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Theme 2<br />
Session 1<br />
Les maisons à patio, modèles d’architectures<br />
bioclimatiques<br />
équipements collectifs), de l’architecte Glorieux.<br />
- La «cité des Andalous» à Bizerte (33 logements), de<br />
l’architecte Le Couteur.<br />
- un groupe de 7 maisons à Tebourba, de l’architecte<br />
Dianoux.<br />
Plusieurs résidences individuelles à cour intérieure<br />
auxquelles collabora - d’une manière ou d’une autre<br />
- Jacques Marmey furent par ailleurs réalisées entre<br />
1945 et les années 1950 à Sidi Bou Saïd.<br />
La construction de la cité Ibn Khaldoun en<br />
périphérie de Tunis décidée en 1968-69 représente<br />
l’un des plus importants projets d’habitation après<br />
l’indépendance. D’une capacité de 5000 logements<br />
ce quartier était destiné au relogement des populations<br />
des «gourbivilles». Conçu par la SCET-Tunisie et<br />
réalisée par la SNIT (Société Nationale Immobilière<br />
de Tunisie), il était structuré en «unités» et «centres»<br />
de voisinage découpés par de larges avenues . La<br />
référence à la tradition «arabo-islamique» devait s’y<br />
concrétiser par des rues piétonnes et des patios (ou<br />
tout au moins des espaces privatifs découverts attenants<br />
aux logements).<br />
Un autre projet, celui de la rénovation du<br />
quartier de la Hafsia dans la Médina de Tunis , fut<br />
entre 1970 et 1973 précédé d’études pluridisciplinaires,<br />
avec notamment la participation d’Arno Heinz,<br />
alors expert de l’UNESCO et de Jellal Abdelkafi, alors<br />
directeur de l’A.S.M. La première tranche de ce projet<br />
exécutée entre 1973 et 1977 par l’architecte Wassim<br />
Ben Mahmoud comportait notamment 95 logements<br />
et un souk d’une centaine de boutiques. Pour la première<br />
fois dans le monde arabe, une rénovation urbaine<br />
tentait de redonner à la ville traditionnelle sa<br />
cohérence perdue en essayant de s’inspirer de certains<br />
traits des maisons urbaines traditionnelles et de<br />
reconstituer la continuité d’anciens axes de circulation.<br />
Seules les plus grandes unités d’habitation disposaient<br />
cependant d’un patio central. En raison de<br />
son intérêt, la réalisation de ce quartier a reçu le Prix<br />
Aga Khan d’Architecture en 1983 .<br />
La seconde tranche du projet de la Hafsia ,<br />
également dû à l’A.S.M. de Tunis fait preuve d’une<br />
volonté encore plus affirmée d’intégration dans le<br />
tissu urbain et social environnant. Les maisons à patio<br />
y reçoivent en particulier des dispositions contemporaines<br />
en I, L et U et s’insèrent dans des îlots contenant<br />
également des boutiques (en périphérie) et de<br />
petits équipements collectifs (au centre).<br />
Ces différents projets restent quand même<br />
apparemment exceptionnels en Tunisie qui, en tout<br />
état de cause, dispose de moyens bien plus réduits<br />
que les deux états du Maghreb précédemment<br />
décrits.<br />
Le cas du Proche-Orient :<br />
On aurait pu croire que moins directement et moins<br />
longtemps soumis au contact direct avec l’occident, le<br />
Proche-Orient saurait mieux préserver l’ensemble de<br />
ses éléments d’authenticité. Il s’avère que la rupture<br />
architecturale y parait paradoxalement davantage<br />
consommée encore avec la tradition des maisons à<br />
patio qu’en Tunisie ou au Maroc.<br />
C’est peut-être qu’une l’empreinte culturelle<br />
étrangère paraît d’autant moins menaçante dans<br />
l’habitat qu’elle n’a pas été associée à une colonisation<br />
de peuplement. Quant à la religion, elle semble,<br />
même pour les fondamentalistes, davantage associée<br />
au mode de vie et à l’accoutrement qu’au cadre<br />
construit.<br />
Il n’est dans ce contexte guère surprenant<br />
que la maison «à cour» soit l’objet d’un certain ostracisme<br />
dans les constructions réalisées en milieu<br />
urbain, même en Egypte, patrie de Hassan Fathy.<br />
Rappelons que celui-ci n’a eu qu’exceptionnellement<br />
l’occasion de réaliser des habitations en nombre important,<br />
comme dans le village du nouveau Gourna à<br />
la fin de années 1940 . Hassan Fathy et son élève Abdel<br />
Wahid el Wakil ont surtout eu ensuite l’occasion<br />
de réaliser des villas individuelles pour des familles<br />
fortunées .<br />
La presse architecturale ne permet qu’assez<br />
rarement de relever certains projets, comme celui<br />
de Kisho Kurokawa pour la ville nouvelle d’As-Sarir<br />
en Libye ou de John Warren en 1982 pour la rénovation<br />
du quartier d’Al Kadhimieh à Bagdad . Ce dernier<br />
exemple tente d’adapter à la vie contemporaine<br />
le modèle des maisons qui préexistaient autrefois au<br />
même endroit. Le problème du stationnement automobile<br />
est notamment résolu en leur réservant un<br />
niveau de parking en sous-sol. Par contre, à As-Sarir<br />
les garages sont individuellement intégrés en rez-dechaussée<br />
dans l’enveloppe des maisons. Malgré l’importance<br />
de ses circulations périphériques, le «patio»<br />
semble un peu marginalisé. Des jeux de terrasse fournissent<br />
un complément d’espace en plein air.<br />
Malgré un rythme de construction frénétique<br />
et un développement sans précédent de l’urbanisation,<br />
les pays pétroliers de la péninsule arabique<br />
ont massivement mis aussi à l’honneur les modèles<br />
occidentaux d’habitat tournés vers l’extérieur. L’utilisation<br />
à grande échelle de la climatisation et le prix<br />
modique de l’énergie n’incite guère à l’économie. Une<br />
partie importante des logements urbains réalisés y<br />
est d’ailleurs destinée à une population étrangère.<br />
La cité du personnel du Ministère des Affaires<br />
Etrangères a été réalisée au tout début des<br />
années 1980 dans le nouveau quartier diplomatique<br />
de la capitale saoudienne Riyadh. Conçu pour 3 600<br />
habitants, par Speerplan , cet ensemble est constitué<br />
293