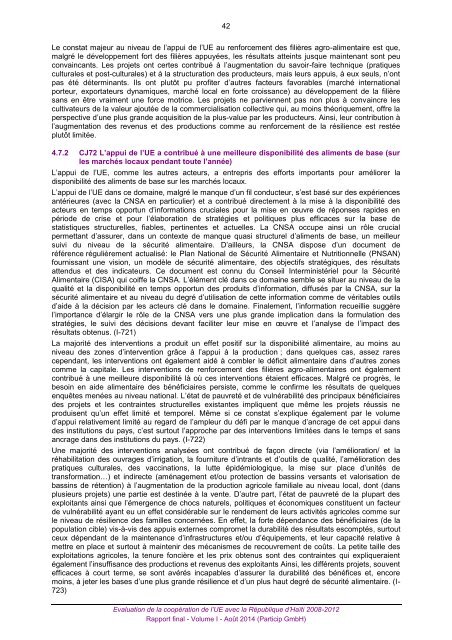1vmIy7T
1vmIy7T
1vmIy7T
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
42Le constat majeur au niveau de l’appui de l’UE au renforcement des filières agro-alimentaire est que,malgré le développement fort des filières appuyées, les résultats atteints jusque maintenant sont peuconvaincants. Les projets ont certes contribué à l’augmentation du savoir-faire technique (pratiquesculturales et post-culturales) et à la structuration des producteurs, mais leurs appuis, à eux seuls, n’ontpas été déterminants. Ils ont plutôt pu profiter d’autres facteurs favorables (marché internationalporteur, exportateurs dynamiques, marché local en forte croissance) au développement de la filièresans en être vraiment une force motrice. Les projets ne parviennent pas non plus à convaincre lescultivateurs de la valeur ajoutée de la commercialisation collective qui, au moins théoriquement, offre laperspective d’une plus grande acquisition de la plus-value par les producteurs. Ainsi, leur contribution àl’augmentation des revenus et des productions comme au renforcement de la résilience est restéeplutôt limitée.4.7.2 CJ72 L’appui de l’UE a contribué à une meilleure disponibilité des aliments de base (surles marchés locaux pendant toute l’année)L’appui de l’UE, comme les autres acteurs, a entrepris des efforts importants pour améliorer ladisponibilité des aliments de base sur les marchés locaux.L’appui de l’UE dans ce domaine, malgré le manque d’un fil conducteur, s’est basé sur des expériencesantérieures (avec la CNSA en particulier) et a contribué directement à la mise à la disponibilité desacteurs en temps opportun d’informations cruciales pour la mise en œuvre de réponses rapides enpériode de crise et pour l’élaboration de stratégies et politiques plus efficaces sur la base destatistiques structurelles, fiables, pertinentes et actuelles. La CNSA occupe ainsi un rôle crucialpermettant d’assurer, dans un contexte de manque quasi structurel d’aliments de base, un meilleursuivi du niveau de la sécurité alimentaire. D’ailleurs, la CNSA dispose d’un document deréférence régulièrement actualisé: le Plan National de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNSAN)fournissant une vision, un modèle de sécurité alimentaire, des objectifs stratégiques, des résultatsattendus et des indicateurs. Ce document est connu du Conseil Interministériel pour la SécuritéAlimentaire (CISA) qui coiffe la CNSA. L’élément clé dans ce domaine semble se situer au niveau de laqualité et la disponibilité en temps opportun des produits d’information, diffusés par la CNSA, sur lasécurité alimentaire et au niveau du degré d’utilisation de cette information comme de véritables outilsd’aide à la décision par les acteurs clé dans le domaine. Finalement, l’information recueillie suggèrel’importance d’élargir le rôle de la CNSA vers une plus grande implication dans la formulation desstratégies, le suivi des décisions devant faciliter leur mise en œuvre et l’analyse de l’impact desrésultats obtenus. (I-721)La majorité des interventions a produit un effet positif sur la disponibilité alimentaire, au moins auniveau des zones d’intervention grâce à l’appui à la production ; dans quelques cas, assez rarescependant, les interventions ont également aidé à combler le déficit alimentaire dans d’autres zonescomme la capitale. Les interventions de renforcement des filières agro-alimentaires ont égalementcontribué à une meilleure disponibilité là où ces interventions étaient efficaces. Malgré ce progrès, lebesoin en aide alimentaire des bénéficiaires persiste, comme le confirme les résultats de quelquesenquêtes menées au niveau national. L’état de pauvreté et de vulnérabilité des principaux bénéficiairesdes projets et les contraintes structurelles existantes impliquent que même les projets réussis neproduisent qu’un effet limité et temporel. Même si ce constat s’explique également par le volumed’appui relativement limité au regard de l’ampleur du défi par le manque d’ancrage de cet appui dansdes institutions du pays, c’est surtout l’approche par des interventions limitées dans le temps et sansancrage dans des institutions du pays. (I-722)Une majorité des interventions analysées ont contribué de façon directe (via l’amélioration/ et laréhabilitation des ouvrages d’irrigation, la fourniture d’intrants et d’outils de qualité, l’amélioration despratiques culturales, des vaccinations, la lutte épidémiologique, la mise sur place d’unités detransformation…) et indirecte (aménagement et/ou protection de bassins versants et valorisation debassins de rétention) à l’augmentation de la production agricole familiale au niveau local, dont (dansplusieurs projets) une partie est destinée à la vente. D’autre part, l’état de pauvreté de la plupart desexploitants ainsi que l’émergence de chocs naturels, politiques et économiques constituent un facteurde vulnérabilité ayant eu un effet considérable sur le rendement de leurs activités agricoles comme surle niveau de résilience des familles concernées. En effet, la forte dépendance des bénéficiaires (de lapopulation cible) vis-à-vis des appuis externes compromet la durabilité des résultats escomptés, surtoutceux dépendant de la maintenance d’infrastructures et/ou d’équipements, et leur capacité relative àmettre en place et surtout à maintenir des mécanismes de recouvrement de coûts. La petite taille desexploitations agricoles, la tenure foncière et les prix obtenus sont des contraintes qui expliqueraientégalement l’insuffisance des productions et revenus des exploitants Ainsi, les différents projets, souventefficaces à court terme, se sont avérés incapables d’assurer la durabilité des bénéfices et, encoremoins, à jeter les bases d’une plus grande résilience et d’un plus haut degré de sécurité alimentaire. (I-723)Evaluation de la coopération de l’UE avec la République d’Haïti 2008-2012Rapport final - Volume I - Août 2014 (Particip GmbH)