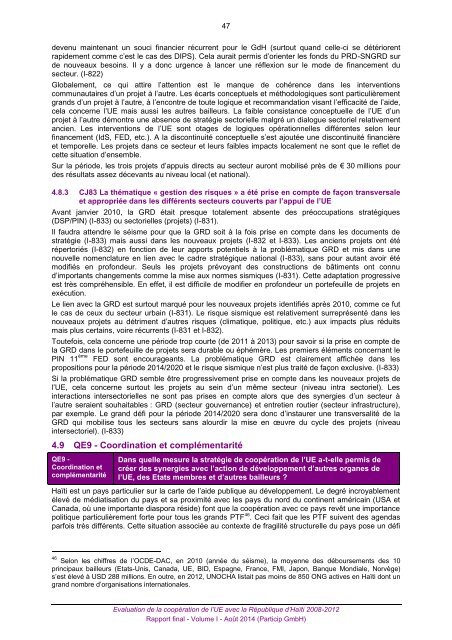46En conclusion, l’échelon national de la DPC est structuré et fonctionnel. Une marge deperfectionnement existe et pourra être comblé par un appui régulier sur le long terme, sans être trèscoûteux, des PTF. Le positionnement de la DPC au sein du MICT peut être questionnable. De même,son statut de simple Direction n’offre pas la visibilité nécessaire à des arbitrages budgétaires favorableset à une attention politique à la hauteur des enjeux. Enfin, il est dommage que le nouveau projet IdS(PRD-SNGRD) doive réparer les errements des projets précédents.4.8.2 CJ82 L’appui de l’UE a contribué au renforcement des capacités de gestion des risquesau niveau localForce est de constater que les interventions de l’UE n’ont eu que peu d’impacts au niveau durenforcement des capacités des acteurs locaux. Les stratégies d’appuis locaux du SNGRD ont variétout au long des appuis de l’UE. Si le PGR a privilégié les acteurs locaux avec la société civile, leséisme a fortement compromis ses acquis. De son côté, le PER-SNGRD a, dans l’ensemble, ignoré lesacteurs locaux. Les méthodologies et concepts d’intervention diamétralement opposés des deux projetsn’ont pas permis une continuité et une consolidation des acquis du premier projet. De plus, chaqueprojet privilégiait un risque différent : climatique, pour le premier, et sismique, pour le second. Lepremier recherchait la qualité par des actions peu reproductibles à travers des ONG internationales. Lesecond s’était lancé dans une course effrénée au quantitatif sans tenir compte des défis logistiques enHaïti et d’un temps d’exécution très réduit. Un troisième projet, le PRD-SNGRD, lui aussi a pour objectifle renforcement du niveau local mais avec une méthodologie encore différente. De plus, une grandepartie de ses actions est destinée à « réparer » les erreurs du PER-SNGRD. Les autres types d’appuispossibles comme le PARSH, AGIL ou ceux de la ligne ANE/AL n’ont que rarement ciblés cetteproblématique de GRD, alors qu’ils auraient pu être complémentaires. (I-821)Pour les besoins de l’évaluation, un Focus Group « GRD » s’est constitué et réuni le vendredi 28 mars2014 (cf. I-821 Vol II). Ce FG était constitué des principaux professionnels de la GRD en Haïti couvrantun large éventail d’institutions (ONG, administrations, PTF, etc.). Les acteurs sont unanimes pouradmettre que l’échelon local (déconcentré et décentralisé) reste le « talon d’Achille » du SNGRD.Beaucoup reste à faire au niveau local. La principale leçon apprise du PER est qu’il vaut mieuxprivilégier une approche par région et par phase successive (sans discontinuité) dans un délai assezlong qu’une intervention nationale durant une courte période. Une telle approche exige du temps maispas forcément un effort financier important, seulement régulier. De même, ce que désire la DPC seraitd’avoir une visibilité des appuis à long terme (12/15 ans) et non de gros projets que la capacitéinstitutionnel de la DPC ne permet pas d’administrer. Cela se traduirait par une nouvelle approche pourl’UE. La mobilisation sur un ou deux FED d’un pourcentage relativement faible (5% par exemple) del’enveloppe A répondrait pleinement aux attentes et aux besoins du secteur. Ces nécessités sont lecontre-pied de l’approche de l’UE à ce jour. (I-821)Les seuls acquis disponibles actuellement sont les DIPS (Dispositif d’Intervention et de premierSecours) qui consiste en un ensemble de (1) 302 containers équipés de matériels de premier secours(dont seulement 20% seraient opérationnels) déployés dans les communes et (2) de 3 031 volontairesformés sommairement aux premiers secours et à l’utilisation des matériels des containers (seulement50% subsisteraient deux ans après le PER-SNGRD). Les containers ne sont pas adaptés auxproblématiques ciblés, peu accessibles, pas opérationnels, etc. Les matériels de premier secours qu’ilscontiennent sont jugés « éphémères » par les évaluateurs du PER-SNGRD. Il est fort probable quedans quelques années, lorsque le besoin existera suite à un séisme ou un cyclone trop important, lesDIPS et ce qu’ils contiennent n’existeront plus. Cela causera un sérieux problème d’image à l’UE, sicette situation (assez probable) venait à se produire. A cela s’ajoute que les volontaires chargésd’utiliser ces matériels connaissent un taux d’érosion (trop) important et ceux qui restent encoredisponibles ne bénéficient pas, a priori, d’une formation continue, laissant à penser que le momentvenu ils seront d’une efficacité très relative. Pour pallier à cela, un nouveau projet avec le PNUD etfinancé par l’IdS (PRD-SNGRD) prévoit de restaurer ces acquis. (I-822)Globalement, si une grande majorité des procédures au niveau local est comprise, leur application,faute de moyens, fait défaut ou laisse à désirer. Le dernier projet de l’IdS, le PRD-SNGRD, ne devraitpas changer la situation ou, du moins, initier une tendance vertueuse dans ce domaine. (I-823)Depuis que le COUN est opérationnel, les canaux de communication verticaux avec les COUD (niveaudépartemental) et COUC (niveau communal) fonctionnent uniquement grâce aux téléphones portables.(I-824)Faute d’avoir pensé à la durabilité de ces infrastructures de secours confiées à une administration sansressources, l’UE doit prendre à sa charge avec le PRD-SNGRD la maintenance du système qu’elle acréé. A l’instar du secteur routier qui a trouvé avec le Fonds d’Entretien Routier une solution aufinancement de l’entretien des routes, il aurait été opportun que les différents projets (PER et PRD) sepenchent sur un mode de financement durable de l’entretien par la DPC de ses infrastructures DIPSEvaluation de la coopération de l’UE avec la République d’Haïti 2008-2012Rapport final - Volume I - Août 2014 (Particip GmbH)
47devenu maintenant un souci financier récurrent pour le GdH (surtout quand celle-ci se détériorentrapidement comme c’est le cas des DIPS). Cela aurait permis d’orienter les fonds du PRD-SNGRD surde nouveaux besoins. Il y a donc urgence à lancer une réflexion sur le mode de financement dusecteur. (I-822)Globalement, ce qui attire l’attention est le manque de cohérence dans les interventionscommunautaires d’un projet à l’autre. Les écarts conceptuels et méthodologiques sont particulièrementgrands d’un projet à l’autre, à l’encontre de toute logique et recommandation visant l’efficacité de l’aide,cela concerne l’UE mais aussi les autres bailleurs. La faible consistance conceptuelle de l’UE d’unprojet à l’autre démontre une absence de stratégie sectorielle malgré un dialogue sectoriel relativementancien. Les interventions de l’UE sont otages de logiques opérationnelles différentes selon leurfinancement (IdS, FED, etc.). A la discontinuité conceptuelle s’est ajoutée une discontinuité financièreet temporelle. Les projets dans ce secteur et leurs faibles impacts localement ne sont que le reflet decette situation d’ensemble.Sur la période, les trois projets d’appuis directs au secteur auront mobilisé près de € 30 millions pourdes résultats assez décevants au niveau local (et national).4.8.3 CJ83 La thématique « gestion des risques » a été prise en compte de façon transversaleet appropriée dans les différents secteurs couverts par l’appui de l’UEAvant janvier 2010, la GRD était presque totalement absente des préoccupations stratégiques(DSP/PIN) (I-833) ou sectorielles (projets) (I-831).Il faudra attendre le séisme pour que la GRD soit à la fois prise en compte dans les documents destratégie (I-833) mais aussi dans les nouveaux projets (I-832 et I-833). Les anciens projets ont étérépertoriés (I-832) en fonction de leur apports potentiels à la problématique GRD et mis dans unenouvelle nomenclature en lien avec le cadre stratégique national (I-833), sans pour autant avoir étémodifiés en profondeur. Seuls les projets prévoyant des constructions de bâtiments ont connud’importants changements comme la mise aux normes sismiques (I-831). Cette adaptation progressiveest très compréhensible. En effet, il est difficile de modifier en profondeur un portefeuille de projets enexécution.Le lien avec la GRD est surtout marqué pour les nouveaux projets identifiés après 2010, comme ce futle cas de ceux du secteur urbain (I-831). Le risque sismique est relativement surreprésenté dans lesnouveaux projets au détriment d’autres risques (climatique, politique, etc.) aux impacts plus réduitsmais plus certains, voire récurrents (I-831 et I-832).Toutefois, cela concerne une période trop courte (de 2011 à 2013) pour savoir si la prise en compte dela GRD dans le portefeuille de projets sera durable ou éphémère. Les premiers éléments concernant lePIN 11 ème FED sont encourageants. La problématique GRD est clairement affichée dans lespropositions pour la période 2014/2020 et le risque sismique n’est plus traité de façon exclusive. (I-833)Si la problématique GRD semble être progressivement prise en compte dans les nouveaux projets del’UE, cela concerne surtout les projets au sein d’un même secteur (niveau intra sectoriel). Lesinteractions intersectorielles ne sont pas prises en compte alors que des synergies d’un secteur àl’autre seraient souhaitables : GRD (secteur gouvernance) et entretien routier (secteur infrastructure),par exemple. Le grand défi pour la période 2014/2020 sera donc d’instaurer une transversalité de laGRD qui mobilise tous les secteurs sans alourdir la mise en œuvre du cycle des projets (niveauintersectoriel). (I-833)4.9 QE9 - Coordination et complémentaritéQE9 -Coordination etcomplémentaritéDans quelle mesure la stratégie de coopération de l’UE a-t-elle permis decréer des synergies avec l’action de développement d’autres organes del’UE, des Etats membres et d’autres bailleurs ?Haïti est un pays particulier sur la carte de l’aide publique au développement. Le degré incroyablementélevé de médiatisation du pays et sa proximité avec les pays du nord du continent américain (USA etCanada, où une importante diaspora réside) font que la coopération avec ce pays revêt une importancepolitique particulièrement forte pour tous les grands PTF 46 . Ceci fait que les PTF suivent des agendasparfois très différents. Cette situation associée au contexte de fragilité structurelle du pays pose un défi46 Selon les chiffres de l’OCDE-DAC, en 2010 (année du séisme), la moyenne des déboursements des 10principaux bailleurs (Etats-Unis, Canada, UE, BID, Espagne, France, FMI, Japon, Banque Mondiale, Norvège)s’est élevé à USD 288 millions. En outre, en 2012, UNOCHA listait pas moins de 850 ONG actives en Haïti dont ungrand nombre d’organisations internationales.Evaluation de la coopération de l’UE avec la République d’Haïti 2008-2012Rapport final - Volume I - Août 2014 (Particip GmbH)