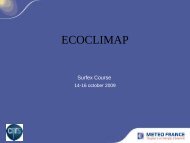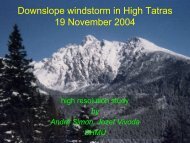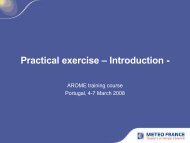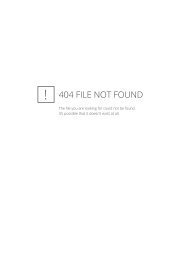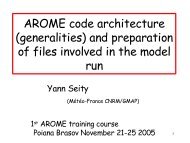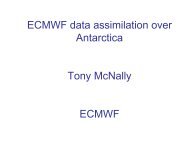mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
90<br />
Concernant la contribution directe <strong>de</strong>s surfaces continentales à la prévisibilité saisonnière,<br />
plusieurs étu<strong>de</strong>s suggèrent qu’elle justifie aujourd’hui d’améliorer l’initialisation et la simulation <strong>de</strong>s<br />
variables lentes <strong>de</strong>s MSC dans les modèles. Les impacts sont essentiellement locaux et dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />
l’amplitu<strong>de</strong> et <strong>de</strong> l’étendue spatiale <strong>de</strong>s anomalies continentales considérées, mais ils semblent pouvoir<br />
compléter utilement l’influence <strong>de</strong>s TSM, notamment lors <strong>de</strong>s saisons et dans les régions où le forçage<br />
océanique a un effet très limité. C’est notamment le cas en Europe, comme le suggère à nouveau une<br />
étu<strong>de</strong> récente <strong>de</strong> Vautard et al. (2007) indiquant que les étés les plus chauds sur l’Europe <strong>de</strong> l’Ouest<br />
sont généralement précédés d’un déficit pluviométrique hivernal sur le pourtour Méditerranéen. La<br />
plupart <strong>de</strong>s expériences <strong>de</strong> sensibilité menées sur ce thème ont cependant été réalisées en mo<strong>de</strong><br />
« hindcast » (TSM observées plutôt que prévues) et les résultats obtenus dépen<strong>de</strong>nt encore largement<br />
<strong>de</strong>s modèles atmosphérique et continental utilisés, ainsi que <strong>de</strong> leur <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> couplage. On est donc<br />
encore loin <strong>de</strong> pouvoir évaluer précisément le gain associé à une meilleure initialisation <strong>de</strong>s réservoirs<br />
continentaux dans un système opérationnel <strong>de</strong> prévision multi-modèles. Un tel objectif aurait pu être<br />
atteint dans le cadre du projet européen ENSEMBLES, mais je n’ai pas eu cette ambition et je ne suis<br />
pas persuadé que la communauté concernée était convaincue <strong>de</strong> l’intérêt d’une telle proposition.<br />
Je compte maintenant élargir et approfondir ce thème <strong>de</strong> recherche selon plusieurs directions.<br />
Premièrement, <strong>de</strong> nouveaux ensembles <strong>de</strong> simulations saisonnières ont été récemment réalisés afin<br />
d’évaluer l’influence <strong>de</strong>s conditions initiales d’HS (à la fin du printemps) plutôt que celle <strong>de</strong> conditions<br />
aux limites parfaitement anticipées. A l’instar <strong>de</strong>s travaux déjà effectués avec les ré-analyses ERA15<br />
(Douville 2004), il s’agit ici d’étudier la persistance <strong>de</strong>s anomalies initiales et <strong>de</strong> se placer dans un cadre<br />
un peu plus proche du contexte <strong>de</strong> la prévision opérationnelle. Ces simulations ont été analysées non<br />
seulement en terme <strong>de</strong> moyennes saisonnières, mais également sous l’angle <strong>de</strong> la distribution<br />
quotidienne <strong>de</strong>s régimes <strong>de</strong> temps, <strong>de</strong>s températures et <strong>de</strong>s précipitations (Conil et al. 2008). L’objectif<br />
in fine est <strong>de</strong> comparer l’influence <strong>de</strong>s TSM et <strong>de</strong> l’hydrologie continentale sur la fréquence, la durée et<br />
la sévérité <strong>de</strong>s événements extrêmes (canicules, sécheresses, fortes précipitations). Les résultats<br />
suggèrent une contribution significative <strong>de</strong> l’initialisation du sol à la prévisibilité <strong>de</strong>s risques <strong>de</strong> canicules<br />
estivales aux moyennes latitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’hémisphère Nord (Conil et al. 2008). Ils indiquent par ailleurs que<br />
le recours à une prévision statistique <strong>de</strong>s anomalies d’HS n’est pas nécessaire dans la mesure où le<br />
modèle Arpège se comporte globalement aussi bien qu’un processus auto-régressif en la matière 3 .<br />
Ainsi, il est temps <strong>de</strong> se lancer dans <strong>de</strong>s travaux plus concrets concernant la mise en œuvre d’une<br />
analyse <strong>de</strong> surface globale en temps réel, en collaboration avec les domaines <strong>de</strong> la prévision<br />
météorologique et hydrologique. Le retour <strong>de</strong> J-F. Mahfouf au CNRM sera l’occasion d’avancer sur ce<br />
sujet, tout en profitant <strong>de</strong>s collaborations extérieures mise en place avec la communauté <strong>de</strong> l’hydrologie<br />
spatiale, par exemple dans le cadre du projet CYMENT 4 . Au plan international, la suite du projet d’intercomparaison<br />
GLACE <strong>de</strong>vrait permettre <strong>de</strong> relativiser les résultats obtenus au CNRM. Elle vise en effet à<br />
comparer dans différents modèles l’impact <strong>de</strong> l’initialisation <strong>de</strong> l’HS sur <strong>de</strong>s prévisions à 2 mois<br />
couvrant la pério<strong>de</strong> GSWP-2. Cette initiative intéressante arrive malheureusement un peu tard et<br />
consiste une fois encore (à l’instar <strong>de</strong> ce que j’ai pu faire jusqu’ici) à maximiser l’impact potentiel <strong>de</strong><br />
l’initialisation continentale puisque l’expérience <strong>de</strong> contrôle préconisée n’utilise aucune observation<br />
directe ou indirecte du cycle hydrologique pour contraindre les états initiaux (dès lors plus ou moins<br />
aléatoires) alors que l’expérience initialisée grâce aux ré-analyses GSWP-2 représente probablement<br />
une version optimiste <strong>de</strong>s états initiaux que l’on est capable <strong>de</strong> produire en temps réel.<br />
Deuxièmement, je souhaite m’intéresser à d’autres sources potentielles <strong>de</strong> prévisibilité climatique à<br />
l’échelle saisonnière. Des expériences supplémentaires ont d’ores et déjà été réalisées afin d’analyser<br />
l’influence <strong>de</strong> la couverture neigeuse <strong>de</strong> l’hémisphère Nord (collaboration possible avec Y. Orsolini en<br />
Norvège). Le protocole suivi est semblable à celui utilisé pour l’HS, c’est à dire basé sur une relaxation<br />
du modèle ISBA vers la climatologie GSWP-2. Les premiers résultats sont encourageants, même s’ils<br />
3 Néanmoins, il serait possible <strong>de</strong> combiner une telle approche statistique à une métho<strong>de</strong> purement dynamique dans les prévisions<br />
opérationnelles, par exemple en maintenant un terme <strong>de</strong> nudging vers <strong>de</strong>s HS prévues <strong>de</strong> manière statistique dans les régions où le couplage<br />
continent-atmosphère induit une dissipation prématurée <strong>de</strong>s anomalies initiales.<br />
4 Cycle <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong> la matière dans les bassins versants : <strong>de</strong> l’observation spatiale à la modélisation en hydrologie, projet RTRA coordonné<br />
par A. Cazenave