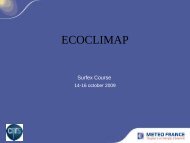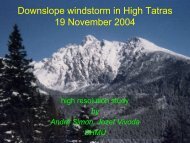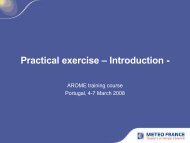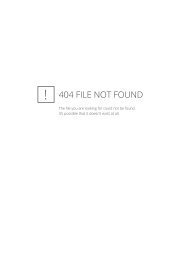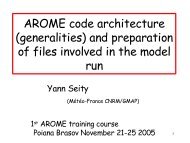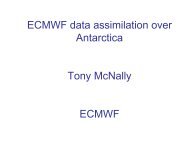mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
36<br />
provoqués par la perturbation <strong>de</strong>s paramètres orbitaux (Royer et al. 1984, Rind et al. 1989). Ces<br />
simulations paléoclimatiques ont néanmoins souligné l’importance <strong>de</strong> l’initialisation <strong>de</strong>s calottes<br />
polaires, qui contribuent largement au maintien d’un climat glaciaire via une rétroaction radiative<br />
positive. D’autres rétroactions ont probablement participé à l’amplification <strong>de</strong>s signaux climatiques<br />
d’origine orbitale. Nous reviendrons sur ce point au chapitre 3.1.3 concernant la végétation.<br />
L’influence <strong>de</strong> la neige dans les simulations climatiques dépend évi<strong>de</strong>mment <strong>de</strong> la<br />
modélisation <strong>de</strong> ses propriétés physiques. A titre d’exemple, la paramétrisation <strong>de</strong> la neige décrite au<br />
paragraphe 2.2.2 a eu <strong>de</strong>s conséquences importantes sur la climatologie actuelle du modèle Arpège-<br />
Climat (Douville et al. 1995b). Au <strong>de</strong>là d’une simulation plus réaliste <strong>de</strong>s albédos et <strong>de</strong>s températures<br />
<strong>de</strong> surface, une amélioration significative <strong>de</strong> la climatologie <strong>de</strong>s précipitations a été constatée, en lien<br />
avec une meilleure restitution <strong>de</strong> la circulation <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> échelle. En hiver, l’enneigement plus important<br />
simulé sur l’Europe permet <strong>de</strong> renforcer la pression <strong>de</strong> surface, réduisant ainsi le caractère trop zonal<br />
<strong>de</strong> la circulation atmosphérique sur l’Atlantique Nord et la surestimation <strong>de</strong>s précipitations sur l’Ouest <strong>de</strong><br />
l’Europe. En été, le réchauffement plus marqué du continent Eurasiatique lié à une fonte plus précoce<br />
<strong>de</strong> la neige (et à l’introduction d’un terme <strong>de</strong> drainage profond dans le schéma ISBA) aboutit à une<br />
simulation plus réaliste du flux <strong>de</strong> mousson et <strong>de</strong>s pluies associées sur le sud <strong>de</strong> l’Asie.<br />
Notons cependant que rien n’est définitivement acquis en modélisation climatique, et que la<br />
couverture neigeuse simulée dans les cycles récents du modèle Arpège-Climat présente à nouveau<br />
certains défauts rencontrés au début <strong>de</strong> ma thèse, en particulier une fonte trop tardive. Si ce biais est<br />
en partie lié à <strong>de</strong>s précipitations soli<strong>de</strong>s excessives, les tests globaux effectués en mo<strong>de</strong> forcé<br />
suggèrent qu’il trouve aussi son origine dans le bilan d’énergie en surface. La fraction du rayonnement<br />
solaire absorbé utilisée pour faire fondre le manteau neigeux est généralement insuffisante lorsque<br />
celui-ci est masqué par un couvert forestier. De ce point <strong>de</strong> vue, la paramétrisation empirique proposée<br />
ne donne pas pleinement satisfaction et semble trop sensible au choix du paramètre décrivant la<br />
fraction <strong>de</strong> la maille recouverte <strong>de</strong> végétation. Une formulation dépendant également <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nsité<br />
verticale et/ou <strong>de</strong> la hauteur du couvert végétal pourrait permettre d’atténuer ce problème, à condition<br />
<strong>de</strong> disposer <strong>de</strong> données physiographiques <strong>de</strong> bonne qualité à l’échelle globale.<br />
3.1.2. Humidité du sol<br />
L’influence <strong>de</strong> l’humidité du sol (HS) sur la climatologie <strong>de</strong>s modèles atmosphériques a d’abord<br />
été mise en évi<strong>de</strong>nce par <strong>de</strong>s simulations académiques. Manabe (1975) a notamment procédé à une<br />
expérience d’irrigation massive et obtenu une modification sensible <strong>de</strong> la circulation atmosphérique<br />
tropicale. Shukla et Mintz (1982) ont également prescrit <strong>de</strong>s valeurs extrêmes <strong>de</strong> l’HS dans les<br />
conditions aux limites <strong>de</strong> simulations atmosphériques pluri-annuelles, montrant ainsi que l’évapotranspiration<br />
(ET) contribue <strong>de</strong> manière importante aux précipitations continentales. Ils ont aussi<br />
souligné la forte dépendance <strong>de</strong>s températures <strong>de</strong> surface à l’HS, sous les Tropiques ainsi qu’aux<br />
moyennes latitu<strong>de</strong>s en été. Walker et Rowntree (1977) ont testé l’influence <strong>de</strong> l’initialisation <strong>de</strong>s sols<br />
dans un modèle tropical à symétrie zonale. Ils ont montré que <strong>de</strong>s anomalies positives du contenu en<br />
eau du sol pouvaient persister <strong>de</strong> manière significative grâce au recyclage <strong>de</strong>s précipitations via l’ET.<br />
Ces premiers tests <strong>de</strong> sensibilité ont incité les modélisateurs du climat à perfectionner la<br />
paramétrisation <strong>de</strong>s surfaces continentales (cf. chapitre 2.1). Le remplacement d’une hydrologie <strong>de</strong> type<br />
« bucket » (Manabe 1969) par un schéma <strong>de</strong> type « SVAT » décrivant plus explicitement le<br />
fonctionnement hydrologique <strong>de</strong> la végétation a concerné la plupart <strong>de</strong>s MCG atmosphériques au cours<br />
<strong>de</strong>s années 80. Cependant, si l’intérêt <strong>de</strong> schémas plus physiques a été mis en évi<strong>de</strong>nce par la plupart<br />
<strong>de</strong>s inter-comparaisons <strong>de</strong> type PILPS, leur apport dans les simulations climatiques globales est en<br />
général beaucoup moins clair. C’est la conclusion à laquelle sont notamment parvenus Manzi et<br />
Planton (1994) en introduisant le schéma ISBA dans le modèle climatique du CNRM. C’est également<br />
ce qui ressort <strong>de</strong>s travaux plus récents <strong>de</strong> Delire et al. (2002) ou d’Alessandri et al. (2007). Ces