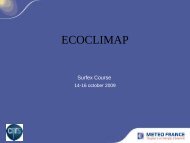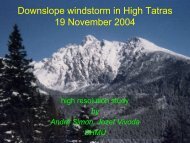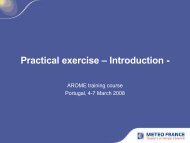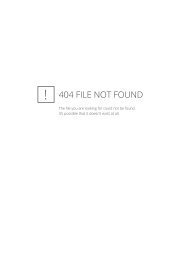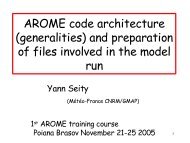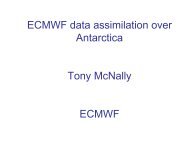mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
12<br />
2.2. Ma contribution au modèle ISBA<br />
Le modèle ISBA a été essentiellement développé au sein <strong>de</strong> l’équipe MC2 du Groupe <strong>de</strong><br />
Modélisation à Méso-Echelle. Son introduction dans les modèles atmosphériques globaux Emerau<strong>de</strong><br />
puis Arpège a été une longue épopée semée d’embûches, dont il serait trop long et surtout trop risqué<br />
<strong>de</strong> dresser ici l’historique. Mentionnons simplement les contributions essentielles d’H. Giordani, d’A.<br />
Manzi, et surtout <strong>de</strong> J-F. Mahfouf qui a finalisé la mise en œuvre du schéma ISBA (on ne parlait pas<br />
encore <strong>de</strong> modèle) au sein du modèle Arpège-Climat (Mahfouf et al. 1995). A côté <strong>de</strong> ces pionniers,<br />
bien d’autres ont participé au développement et à la calibration du modèle ISBA. C’est ma mo<strong>de</strong>ste<br />
contribution à cet effort collectif que je veux ici présenter. Elle repose d’une part sur ma thèse effectuée<br />
sous la direction <strong>de</strong> J-F. Royer, d’autre part sur la thèse <strong>de</strong> B. Decharme que j’ai dirigée <strong>de</strong> 2003 à<br />
2005 après avoir obtenu un financement <strong>de</strong> l’ACI « Observation <strong>de</strong> la Terre ».<br />
2.2.1. Paramétrisation simplifiée du manteau neigeux<br />
Lorsque j’ai amorcé ma thèse au CNRM en 1993, la neige était représentée <strong>de</strong> manière très<br />
sommaire dans le schéma <strong>de</strong> surface ISBA développé par Noilhan et Planton (1989). La<br />
paramétrisation comportait une seule variable historique, la masse ou contenu équivalent en eau du<br />
manteau neigeux, dont l’évolution était régie par les trois contributions classiques que sont les<br />
précipitations soli<strong>de</strong>s, la sublimation et la fonte. Les propriétés thermiques spécifiques à la neige étaient<br />
ignorées. L’albédo <strong>de</strong> la neige était fixé à 0.70. Dans chaque maille continentale, une fraction empirique<br />
<strong>de</strong> couverture neigeuse était diagnostiquée en fonction <strong>de</strong> la masse <strong>de</strong> neige, afin <strong>de</strong> pondérer<br />
l’influence <strong>de</strong> la neige sur la valeur moyenne <strong>de</strong> l’albédo, la rugosité et l’humidité en surface. Enfin, le<br />
terme <strong>de</strong> fonte était diagnostiqué à posteriori, c’est à dire après avoir résolu le bilan d’énergie sans tenir<br />
compte <strong>de</strong> la fonte, en supposant que la température moyenne <strong>de</strong> la maille ne pouvait excé<strong>de</strong>r le seuil<br />
<strong>de</strong> 0°C en présence <strong>de</strong> neige.<br />
A l’époque, <strong>de</strong>s paramétrisations plus ambitieuses commençaient à voir le jour (Loth et al.<br />
1993, Lynch-Stieglitz 1994) incluant un bilan d’énergie spécifique et une résolution explicite <strong>de</strong> la<br />
conduction <strong>de</strong> chaleur au sein du manteau neigeux grâce à une discrétisation sur 3 à 5 couches. J’ai<br />
cependant fait le choix (avais-je alors les moyens d’être plus ambitieux ?) <strong>de</strong> conserver la philosophie<br />
initiale du schéma ISBA, à savoir l’unicité du bilan d’énergie en surface et le maintien d’un nombre limité<br />
<strong>de</strong> variables pronostiques et <strong>de</strong> paramètres empiriques. Je me suis surtout attaché à rendre compte <strong>de</strong><br />
manière plus complète et plus explicite <strong>de</strong>s propriétés physiques originales <strong>de</strong> la neige, en m’inspirant<br />
notamment du schéma CLASS développé au Canada (Verseghy 1991). Un albédo pronostique a<br />
d’abord été introduit afin <strong>de</strong> faire diminuer l’albédo en fonction <strong>de</strong> l’âge <strong>de</strong> la neige, selon un taux<br />
linéaire en pério<strong>de</strong> froi<strong>de</strong> et un taux exponentiel en pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> fonte. Une équation pronostique pour la<br />
<strong>de</strong>nsité a également été mise en oeuvre, selon laquelle la <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> la neige fraîche augmente<br />
exponentiellement par métamorphisme et compaction pour atteindre une valeur maximale <strong>de</strong> 0.3 au<br />
bout <strong>de</strong> quelques jours. A chaque pas <strong>de</strong> temps, la <strong>de</strong>nsité moyenne du manteau neigeux est ainsi<br />
fonction <strong>de</strong>s précipitations et <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nsité du manteau neigeux déjà présent en surface.<br />
Cette <strong>de</strong>nsité moyenne intervient alors dans le calcul <strong>de</strong> la capacité calorifique et <strong>de</strong> la conductivité<br />
thermique <strong>de</strong> la neige, et ainsi dans le calcul du coefficient thermique moyen qui dans ISBA relie les flux<br />
d’énergie en surface à une variation <strong>de</strong> la température (Noilhan et Planton 1989). Enfin, le taux <strong>de</strong> fonte<br />
a été modifié afin <strong>de</strong> permettre à la température <strong>de</strong> surface <strong>de</strong> dépasser le seuil <strong>de</strong> 0°C en présence<br />
d’un enneigement partiel <strong>de</strong> la maille, et ainsi <strong>de</strong> simuler un réchauffement plus progressif pendant la<br />
pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> fonte.