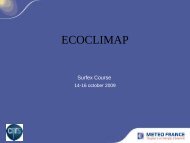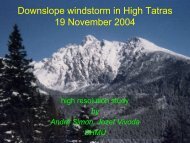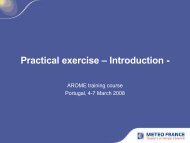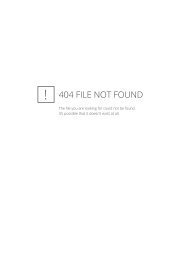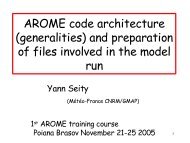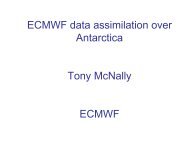mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
52<br />
Ainsi, la réduction globale <strong>de</strong> la cryosphère au 21 ème siècle ne fait guère <strong>de</strong> doute, mais son<br />
amplitu<strong>de</strong> et sa répartition régionale <strong>de</strong>meurent encore incertains. Réciproquement, l’importance <strong>de</strong> la<br />
rétroaction <strong>de</strong> la neige sur la température du globe <strong>de</strong>man<strong>de</strong> également à être précisée. Nous avons vu<br />
au chapitre 3.1.1 que la neige est rapi<strong>de</strong>ment apparue comme une composante déstabilisatrice du<br />
climat en raison <strong>de</strong> son albédo particulièrement élevé, à l’origine d’une rétroaction positive sur la<br />
température <strong>de</strong> surface (Bony et al. 2006). L’importance <strong>de</strong> cette rétroaction est une fois <strong>de</strong> plus difficile<br />
à quantifier à partir <strong>de</strong>s observations et elle reste assez variable d’un modèle à l’autre. De plus, la<br />
comparaison <strong>de</strong>s modèles montrent que l’albédo <strong>de</strong> surface n’est qu’une facette du problème et que le<br />
rôle du rayonnement infra-rouge et <strong>de</strong>s interactions avec la nébulosité ne doit pas être sous-estimé<br />
(Cess et al. 1991). Les analyses <strong>de</strong> Randall et al. (1994) confirment cette remarque, mais soulignent<br />
également l’importance <strong>de</strong> la paramétrisation <strong>de</strong> l’albédo <strong>de</strong> la neige pour expliquer la sensibilité <strong>de</strong>s<br />
modèles. Les résultats <strong>de</strong> l’inter-comparaison Snowmip-2 évoquée au chapitre 3.2 permettent aisément<br />
<strong>de</strong> comprendre la diversité <strong>de</strong>s rétroactions simulées, tant les modèles <strong>de</strong> neige répon<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> manière<br />
contrastée à un même forçage atmosphérique, notamment en présence d’un couvert forestier.<br />
Une étu<strong>de</strong> récente (Hall et Qu 2006) tente <strong>de</strong> contraindre la rétroaction liée à l’albédo <strong>de</strong> la<br />
neige en s’appuyant sur le cycle annuel. Elle montre en effet que le ratio entre la variation <strong>de</strong> l’albédo<br />
<strong>de</strong> surface et la variation <strong>de</strong> la température <strong>de</strong> surface obtenues au printemps dans les scénarios du<br />
GIEC AR4 est effectivement très différent d’un modèle à l’autre, mais qu’il est très corrélé au ratio <strong>de</strong>s<br />
variations saisonnières obtenu à partir du cycle annuel moyen. Ainsi, puisque le ratio saisonnier peutêtre<br />
estimé à partir <strong>de</strong>s observations, il est possible <strong>de</strong> dire quels sont les scénarios les plus crédibles<br />
en matière <strong>de</strong> rétroaction <strong>de</strong> la neige à long terme. De ce point <strong>de</strong> vue, il semble que le modèle CNRM-<br />
CM3 montre une sensibilité insuffisante <strong>de</strong> la température <strong>de</strong> surface à l’albédo. Ceci est cohérent avec<br />
la paramétrisation <strong>de</strong> la fonte décrite au paragraphe 2.2.2, qui permet au schéma ISBA <strong>de</strong> répartir le<br />
rayonnement solaire inci<strong>de</strong>nt entre fonte du manteau neigeux et réchauffement <strong>de</strong> surface, notamment<br />
en présence <strong>de</strong> végétation. Nous avons insisté sur le caractère empirique <strong>de</strong> cette paramétrisation qui<br />
permet cependant <strong>de</strong> calculer un albédo réaliste sur les forêts enneigées et d’éviter un saut abrupt <strong>de</strong> la<br />
température <strong>de</strong> surface au printemps. Les résultats <strong>de</strong> Hall et Qu (2006) sont relativement cohérents<br />
avec le retrait <strong>de</strong> la couverture neigeuse simulé au printemps dans les simulations du GIEC, qui semble<br />
en effet plus proche du retrait observé (fin du 20 ème siècle) pour les modèles i<strong>de</strong>ntifiés comme ayant<br />
une rétroaction « réaliste ». Néanmoins, la concordance est beaucoup moins claire en moyenne<br />
annuelle car les processus radiatifs sont moins importants en hiver et les tendances sur le bilan <strong>de</strong><br />
masse annuel dépen<strong>de</strong>nt non seulement <strong>de</strong> la fonte mais aussi <strong>de</strong>s précipitations.<br />
3.3.2. Humidité du sol<br />
L’impact <strong>de</strong>s forçages anthropiques sur l’HS est un sujet particulièrement difficile en raison <strong>de</strong>s<br />
multiples sources d’incertitu<strong>de</strong>s qui pèsent sur le bilan <strong>de</strong> masse <strong>de</strong>s réservoirs continentaux et du<br />
manque d’observations déjà évoqué au chapitre 3 pour contraindre les modèles. Cette question pourrait<br />
à elle seule faire l’objet d’un rapport <strong>de</strong> HDR et je vais donc <strong>de</strong>voir être particulièrement synthétique et<br />
me contenter <strong>de</strong> citer quelques-uns <strong>de</strong>s travaux les plus importants sur ce thème. Commençons par les<br />
quelques observations in situ disponibles qui, en particulier, ne montrent aucune tendance claire à<br />
l’assèchement en été aux moyennes latitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’hémisphère Nord (Robock et al. 2005), à l’inverse <strong>de</strong><br />
la plupart <strong>de</strong>s scénarios climatiques. Une manière moins directe <strong>de</strong> juger <strong>de</strong> l’évolution du bilan<br />
hydrique continental est <strong>de</strong> s’intéresser au ruissellement continental, dont une reconstruction globale<br />
via les débits <strong>de</strong>s grands fleuves suggère une augmentation en réponse au réchauffement global<br />
observé au cours du 20 ème siècle (Labat et al. 2004). Cet accroissement global en moyenne annuelle<br />
peut toutefois dissimuler <strong>de</strong> nombreux contrastes régionaux, ainsi qu’une amplification du cycle annuel<br />
<strong>de</strong> l’HS comme le suggère les résultats <strong>de</strong> certains scénarios climatiques (Fig. 3.5.b, Douville et al.<br />
2002).