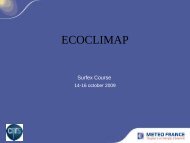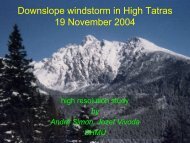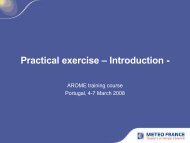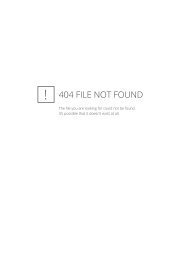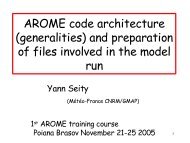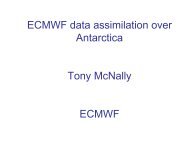mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
4.3. Continents et changement climatique : un rôle surestimé ?<br />
78<br />
Qu’il s’agisse <strong>de</strong>s simulations paléoclimatiques ou <strong>de</strong>s scénarios du 21 ème siècle dont il est ici<br />
question, les a<strong>de</strong>ptes d’une influence importante <strong>de</strong>s surfaces continentales, notamment <strong>de</strong> la<br />
végétation, font également preuve d’une gran<strong>de</strong> pugnacité pour faire passer leur message. Il faudra par<br />
exemple m’expliquer (et me démontrer) en quoi un modèle <strong>de</strong> végétation dynamique est indispensable<br />
à la réalisation <strong>de</strong> scénarios climatiques limités à l’horizon 2030 comme il est aujourd’hui encore<br />
préconisé dans les documents <strong>de</strong> préparation au prochain exercice d’inter-comparaison du GIEC ?<br />
Autre exemple, j’ai récemment eu une discussion houleuse à l’Académie d’Agriculture à l’issue <strong>de</strong><br />
présentations sur l’influence <strong>de</strong> l’utilisation <strong>de</strong>s sols et <strong>de</strong> l’irrigation sur le climat global. J’ai<br />
apparemment créé la surprise en refusant <strong>de</strong> mettre ces forçages anthropiques sur un pied d’égalité<br />
avec la question <strong>de</strong> l’accroissement <strong>de</strong>s émissions <strong>de</strong> gaz à effet <strong>de</strong> serre. Il ne s’agit pas ici <strong>de</strong><br />
minimiser la qualité scientifique <strong>de</strong>s travaux réalisés par mes collègues, mais <strong>de</strong> relativiser l’importance<br />
<strong>de</strong>s processus étudiés au regard <strong>de</strong>s multiples incertitu<strong>de</strong>s qui pèsent sur les projections climatiques et<br />
<strong>de</strong> l’urgence qu’il y a aujourd’hui à préciser les conséquences régionales du réchauffement global,<br />
notamment en terme d’hydrologie et <strong>de</strong> ressources en eau. Il s’agit aussi d’affirmer qu’on ne pourra pas<br />
lutter efficacement contre l’accroissement <strong>de</strong> l’effet serre, même à l’échelle régionale, en tentant<br />
d’optimiser l’utilisation <strong>de</strong>s sols et les pratiques agricoles, tant les ordres <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>ur sont différents en<br />
terme <strong>de</strong> forçage radiatif et malgré les limites <strong>de</strong> ce concept (Davin et al. 2007).<br />
4.3.1. Retour sur les projets LSPCR et CEFIPRA<br />
Le projet européen LSPCR (Land Surface Processes and Climate Response) coordonné par J.<br />
Polcher a déjà été mentionné au chapitre 3.3. Lancé à la fin <strong>de</strong>s années 1990, il visait essentiellement à<br />
évaluer l’influence <strong>de</strong> la paramétrisation <strong>de</strong>s surfaces continentales dans <strong>de</strong>s expériences <strong>de</strong><br />
changement climatique à l’équilibre et à la comparer à l’influence <strong>de</strong>s différents MCG atmosphériques<br />
impliqués dans cette inter-comparaison. Chaque équipe était supposée réaliser <strong>de</strong>ux paires <strong>de</strong><br />
simulations à l’équilibre (climats actuel et futur) en utilisant <strong>de</strong>ux schémas <strong>de</strong> surface ou <strong>de</strong>ux versions<br />
distinctes d’un même schéma. Outre l’analyse <strong>de</strong>s rétroactions potentielles <strong>de</strong> la végétation dans les<br />
simulations Arpège-Climat, j’ai profité <strong>de</strong> ce projet pour étudier la robustesse <strong>de</strong> la réponse <strong>de</strong> la<br />
mousson Indienne dans les 4 modèles ayant participé au projet (Douville et al. 1999). Malgré l’utilisation<br />
d’anomalies <strong>de</strong> TSM i<strong>de</strong>ntiques issues d’un scénario transitoire du Met Office, la réponse <strong>de</strong>s<br />
précipitations <strong>de</strong> mousson est très variable d’une expérience à l’autre et n’est pas fortement contrainte<br />
par le réchauffement continental simulé au printemps (Fig. 4.5a). Au <strong>de</strong>là du choix du modèle<br />
atmosphérique, il semble donc que la paramétrisation <strong>de</strong>s surfaces continentales représente une<br />
incertitu<strong>de</strong> majeure pour prévoir les conséquences régionales d’un doublement <strong>de</strong> CO2.<br />
Lorsqu’on compare les résultats du projet LSPCR avec la réponse <strong>de</strong> la mousson Indienne<br />
simulée par 14 modèles couplés ayant participé aux simulations du GIEC AR4 (Fig. 4.5b), on est frappé<br />
<strong>de</strong> constater que la dispersion <strong>de</strong>s anomalies <strong>de</strong> précipitations est faible au regard <strong>de</strong> celle obtenue<br />
dans les expériences LSPCR, malgré une incertitu<strong>de</strong> beaucoup plus forte sur le réchauffement en<br />
surface. Ceci témoigne à mon sens <strong>de</strong> l’importance <strong>de</strong>s rétroactions océaniques, ignorées dans les<br />
expériences LSPCR, et cependant fondamentales à la compréhension <strong>de</strong> l’ajustement <strong>de</strong> la mousson<br />
aussi bien au forçage radiatif lié aux GES qu’à une modification du MSC et donc <strong>de</strong>s températures<br />
continentales. Les travaux récents <strong>de</strong> Sutton et al. (2007) sur le contraste terre-mer dans le<br />
réchauffement en surface simulé dans les scénarios du GIEC montrent qu’il ne relève pas tant du<br />
différentiel d’inertie thermique entre les océans et les continents que <strong>de</strong> la réponse contrastée du flux<br />
<strong>de</strong> chaleur latente, en raison du contenu en eau limité <strong>de</strong>s sols. Ils indiquent par ailleurs que le ratio Φ<br />
<strong>de</strong>s anomalies <strong>de</strong> température continentale et océanique est relativement stable et ne dépend guère <strong>de</strong><br />
la température moyenne du globe à l’échelle multi-décennale. A plus courte échéance, on pourrait