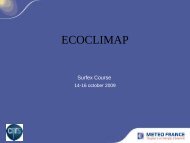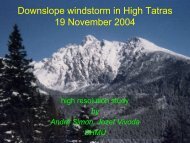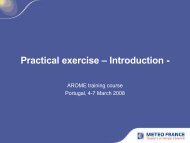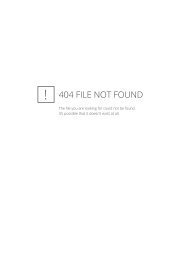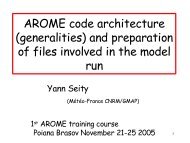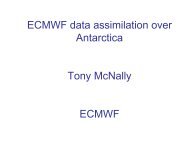mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
44<br />
<strong>de</strong> travaux distincts. Si l’influence <strong>de</strong> ces mo<strong>de</strong>s atmosphériques sur la variabilité inter-annuelle du<br />
manteau neigeux ne fait aucun doute (Iwasaki 1991, Gutzler et Rosen 1992), la réciproque n’est pas<br />
évi<strong>de</strong>nte. Ainsi, Cohen et al. (2005) ont récemment analysé la NAO simulée par 14 modèles<br />
atmosphériques dans <strong>de</strong>s simulations <strong>de</strong> type AMIP et ont conclu à l’absence <strong>de</strong> forçage <strong>de</strong> la NAO par<br />
la couverture neigeuse Eurasiatique (ainsi que par les TSM) à l’échelle interannuelle sur la pério<strong>de</strong><br />
1979-1995. Ce résultat est cependant interprété comme un manque <strong>de</strong> sensibilité <strong>de</strong>s modèles qui ne<br />
seraient pas capables <strong>de</strong> reproduire le lien statistique observé au cours <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rnières décennies (grâce<br />
aux mesures spatiales <strong>de</strong> couverture neigeuse disponibles <strong>de</strong>puis la fin <strong>de</strong>s années 60).<br />
En effet, différentes étu<strong>de</strong>s statistiques suggèrent que l’enneigement observé sur le continent<br />
Eurasiatique <strong>de</strong> l’été à l’automne pourrait être un bon précurseur <strong>de</strong> l’AO/NAO en hiver (Cohen et<br />
Entekhabi 1999, Cohen et Saito 2003, Saun<strong>de</strong>rs et al. 2003). Basée sur les ré-analyses du NCEP, une<br />
étu<strong>de</strong> diagnostique suggère que le mécanisme sous-jacent serait lié à la propagation verticale d’on<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> Rossby dont l’effet sur la moyenne troposphère se ferait via un impact préalable sur la dynamique<br />
stratosphérique (Saito et al. 2001). Cette hypothèse reste cependant très incertaine et il n’est pas exclu<br />
que les corrélations mises en évi<strong>de</strong>nce entre l’enneigement et l’AO/NAO soit un effet purement<br />
aléatoire en raison <strong>de</strong> la durée limitée <strong>de</strong>s séries étudiées (environ 30 ans). Il est donc maintenant<br />
important d’utiliser le laboratoire numérique pour tester un tel scénario (c’était l’un <strong>de</strong>s objectifs que<br />
j’avais fixés à T. Loridan avant qu’il ne déci<strong>de</strong> d’interrompre sa thèse). De telles simulations ont déjà été<br />
réalisées avec le modèle ECHAM3 forcé par <strong>de</strong>s TSM climatologiques (Gong et al. 2002). Deux<br />
ensembles <strong>de</strong> 20 intégrations allant <strong>de</strong> Septembre à Février ont été comparés, dans lesquels la neige<br />
est soit interactive soit prescrite selon la climatologie du modèle. Les résultats suggèrent une<br />
modulation <strong>de</strong> l’AO/NAO lorsque la neige interagit avec l’atmosphère. Toutefois, la taille <strong>de</strong>s ensembles<br />
me paraît insuffisante pour tirer <strong>de</strong>s conclusions robustes d’une telle expérience en raison <strong>de</strong> l’extrême<br />
variabilité du géopotentiel à 500 hPa aux hautes latitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’hémisphère d’hiver. La même critique<br />
peut être adressée à une étu<strong>de</strong> complémentaire consistant à forcer <strong>de</strong>s enneigements contrastés sur la<br />
Sibérie (années 1876 et 1988) dans le même modèle et toujours avec <strong>de</strong>s TSM climatologiques (Gong<br />
et al. 2003). Les résultats obtenus confirment néanmoins la possibilité d’une modulation <strong>de</strong> l’AO/NAO et<br />
sont assez cohérents avec le mécanisme dynamique proposé par Saito et al. (2001).<br />
3.2.2. Humidité du sol<br />
Le contenu en eau du sol représente une autre source potentielle <strong>de</strong> prévisibilité climatique à<br />
la surface <strong>de</strong>s continents. En effet, le réservoir sol est a priori <strong>de</strong> dimension suffisante (quelques<br />
dizaines <strong>de</strong> centimètres à quelques mètres) pour permettre la persistance d’anomalies qui pourront<br />
affecter les flux <strong>de</strong> surface, et par ce biais l’atmosphère, à l’échelle mensuelle voire saisonnière (Walker<br />
et Rowntree 1977, Delworth et Manabe 1989). En pratique, la <strong>mémoire</strong> <strong>de</strong> l’HS est difficile à mettre en<br />
évi<strong>de</strong>nce à partir <strong>de</strong>s observations puisque les mesures in situ sont relativement rares et ne concernent<br />
en général que les premiers centimètres du sol. Néanmoins, D’Odorico et Porporato (2004) soulignent<br />
la possibilité d’une distribution bimodale <strong>de</strong>s humidités observées <strong>de</strong> Mai à Septembre en Amérique du<br />
Nord, suggérant ainsi l’importance <strong>de</strong> la rétroaction évaporation-précipitations à l’échelle saisonnière.<br />
Les observations <strong>de</strong> précipitations peuvent également être utilisées pour analyser leur distribution<br />
conditionnée par les précipitations <strong>de</strong>s mois précé<strong>de</strong>nts et ainsi mettre en évi<strong>de</strong>nce une prévisibilité<br />
potentielle liée à l’HS aux moyennes latitu<strong>de</strong>s (Koster et Suarez 2004). D’autres travaux, portant sur<br />
<strong>de</strong>s mesures d’ET sur 15 sites représentatifs d’un large spectre <strong>de</strong> conditions climatiques, suggèrent<br />
que le temps caractéristique <strong>de</strong> la décroissance exponentielle <strong>de</strong> l’ET est en l’absence <strong>de</strong> précipitations<br />
<strong>de</strong> 15 à 35 jours, un ordre <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>ur qui est plus ou moins bien reproduit par les LSM testés en mo<strong>de</strong><br />
forcé sur la pério<strong>de</strong> 1986-1995 dans le cadre du projet GSWP-2 (Teuling et al. 2006). Le forçage<br />
atmosphérique préparé pour ce projet a par ailleurs été utilisé pour montrer que le modèle semiempirique<br />
<strong>de</strong> Budyko (1974) permettait <strong>de</strong> comprendre la répartition spatiale <strong>de</strong> la variabilité <strong>de</strong> l’ET<br />
annuelle en fonction <strong>de</strong>s précipitations et du rayonnement net (Koster et al. 2006).