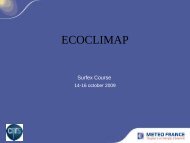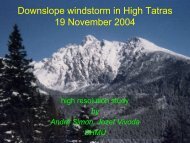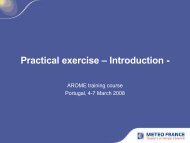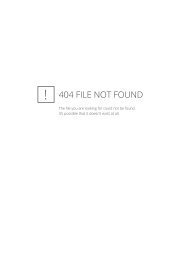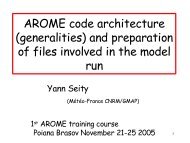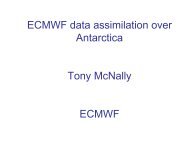mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
68<br />
4.1.2. Nature du couplage avec l’atmosphère<br />
Nous avons au chapitre 2.1 que la variabilité temporelle haute-fréquence <strong>de</strong>s variables<br />
continentales, notamment <strong>de</strong> la température <strong>de</strong> surface, ne permet pas <strong>de</strong> prescrire une climatologie<br />
mensuelle à la limite inférieure <strong>de</strong>s modèles atmosphériques à l’instar <strong>de</strong> ce qui est couramment utilisé<br />
pour les conditions aux limites océaniques. Le mo<strong>de</strong> couplé est donc un passage quasi-obligé pour<br />
gérer les interactions continent-atmosphère <strong>de</strong> manière réaliste. La nature <strong>de</strong>s interactions océanatmosphère<br />
et continent-atmosphère est-elle pour autant fondamentalement différente ?<br />
Pour répondre à cette question, il faut sans doute distinguer l’usage <strong>de</strong> la théorie. En pratique,<br />
rien n’empêche <strong>de</strong> prescrire l’évolution <strong>de</strong>s variables continentales dans un modèle atmosphérique.<br />
Nous avons déjà évoqué le projet d’inter-comparaison GLACE au cours duquel <strong>de</strong> telles expériences<br />
ont été réalisées. Le protocole expérimental initial (Koster et al. 2002) consistait à prescrire à chaque<br />
pas <strong>de</strong> temps l’ensemble <strong>de</strong>s variables <strong>de</strong> surface issues d’une simulation <strong>de</strong> référence. Peut-être à la<br />
suite <strong>de</strong>s remarques que j’avais formulées sur cet article, <strong>de</strong>s expériences complémentaires ont été<br />
proposées dans lesquelles seules les variables lentes sont prescrites. Je n’ai pas été surpris <strong>de</strong><br />
constater que ceux sont les résultats <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rnières expériences qui ont été publiés (Koster et al.<br />
2004). En effet, quel sens y’a t’il à prescrire <strong>de</strong>s variables <strong>de</strong> surface telles que la température ou<br />
l’humidité du sol superficiel qui sont intimement liées au forçage atmosphérique ? Cela revient à<br />
calculer <strong>de</strong>s flux <strong>de</strong> surface aberrants car on supprime alors la cohérence spatio-temporelle entre les<br />
surfaces continentales et la couche limite atmosphérique (Douville 2003, Fig. 4.2). C’est pourquoi la<br />
relaxation <strong>de</strong>s variables hydrologiques « lentes » (humidité <strong>de</strong> sub-surface et/ou contenu équivalent en<br />
eau du manteau neigeux) me paraît une meilleure solution pour contrôler les flux. C’est aussi la raison<br />
pour laquelle le sol superficiel ne fait pas l’objet d’une analyse dans les modèles <strong>de</strong> prévision<br />
numérique. A quoi bon initialiser <strong>de</strong>s variables qui, après quelques pas <strong>de</strong> temps, s’ajusteront <strong>de</strong> toute<br />
façon aux contraintes exercées par l’atmosphère ?<br />
Notons au passage que les problèmes techniques liés au couplage continent-atmosphère ne<br />
sont pas aussi spécifiques qu’il peut sembler <strong>de</strong> prime abord. Ainsi, les TSM montrent également une<br />
variabilité haute-fréquence non négligeable, qui est généralement ignorée lorsqu’un modèle<br />
atmosphérique est forcé avec <strong>de</strong>s températures observées. Ce forçage prend généralement la forme <strong>de</strong><br />
moyennes mensuelles, mais en pratique il est possible d’appliquer un forçage hebdomadaire voire<br />
quotidien (ce protocole a notamment été testé avec Arpège-Climat en collaboration avec F. Chauvin).<br />
Une telle expérience n’a cependant pas plus <strong>de</strong> sens que <strong>de</strong> prescrire les fluctuations haute-fréquence<br />
<strong>de</strong>s variables continentales. Elle tend en effet à augmenter la variabilité <strong>de</strong>s flux <strong>de</strong> surface <strong>de</strong> manière<br />
irréaliste et ne permet pas <strong>de</strong> mieux reproduire la variabilité atmosphérique observée. Dans les MCG<br />
couplés, les TSM sont en général calculées une fois par jour. Certains travaux récents visent<br />
aujourd’hui à accroître la fréquence <strong>de</strong> couplage <strong>de</strong> manière à mieux représenter le cycle diurne <strong>de</strong> la<br />
température dans la couche <strong>de</strong> mélange océanique. Les observations indiquent en effet que l’amplitu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> ce cycle peut atteindre en surface plusieurs dixièmes <strong>de</strong> <strong>de</strong>gré sous les Tropiques (Clayson et<br />
Weitlich 2007). Des tests <strong>de</strong> ce type sont notamment en cours d’analyse au LOCEAN et au CERFACS<br />
et semblent révéler <strong>de</strong>s impacts non négligeables, que ce soit sur la persistance <strong>de</strong>s anomalies <strong>de</strong> TSM<br />
dans l’Atlantique Nord ou sur la variabilité inter-annuelle du Pacifique Tropical. Ainsi, la progression <strong>de</strong>s<br />
moyens <strong>de</strong> calcul et <strong>de</strong> nos exigences quant à leur précision pourrait rapi<strong>de</strong>ment rendre caduque<br />
l’approximation consistant à négliger le cycle diurne du couplage océan-atmosphère, à l’instar <strong>de</strong> ce qui<br />
s’est passé quelques décennies auparavant en ce qui concerne le couplage continent-atmosphère.