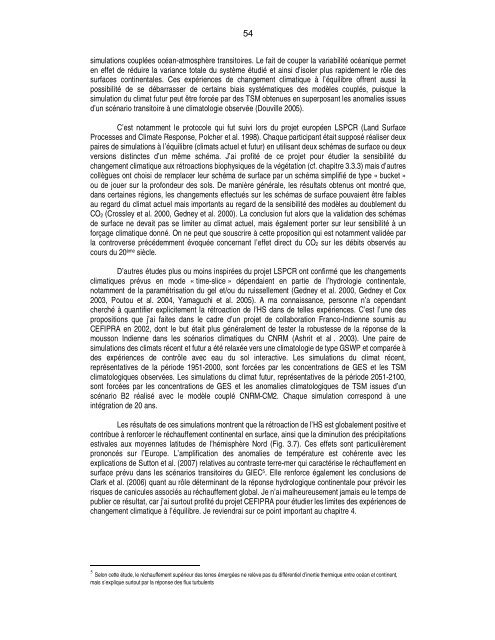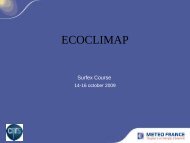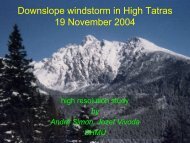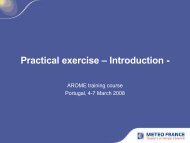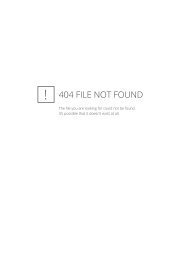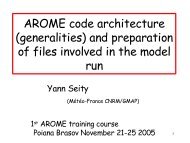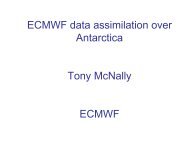mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
mémoire - Centre National de Recherches Météorologiques
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
54<br />
simulations couplées océan-atmosphère transitoires. Le fait <strong>de</strong> couper la variabilité océanique permet<br />
en effet <strong>de</strong> réduire la variance totale du système étudié et ainsi d’isoler plus rapi<strong>de</strong>ment le rôle <strong>de</strong>s<br />
surfaces continentales. Ces expériences <strong>de</strong> changement climatique à l’équilibre offrent aussi la<br />
possibilité <strong>de</strong> se débarrasser <strong>de</strong> certains biais systématiques <strong>de</strong>s modèles couplés, puisque la<br />
simulation du climat futur peut être forcée par <strong>de</strong>s TSM obtenues en superposant les anomalies issues<br />
d’un scénario transitoire à une climatologie observée (Douville 2005).<br />
C’est notamment le protocole qui fut suivi lors du projet européen LSPCR (Land Surface<br />
Processes and Climate Response, Polcher et al. 1998). Chaque participant était supposé réaliser <strong>de</strong>ux<br />
paires <strong>de</strong> simulations à l’équilibre (climats actuel et futur) en utilisant <strong>de</strong>ux schémas <strong>de</strong> surface ou <strong>de</strong>ux<br />
versions distinctes d’un même schéma. J’ai profité <strong>de</strong> ce projet pour étudier la sensibilité du<br />
changement climatique aux rétroactions biophysiques <strong>de</strong> la végétation (cf. chapitre 3.3.3) mais d’autres<br />
collègues ont choisi <strong>de</strong> remplacer leur schéma <strong>de</strong> surface par un schéma simplifié <strong>de</strong> type « bucket »<br />
ou <strong>de</strong> jouer sur la profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong>s sols. De manière générale, les résultats obtenus ont montré que,<br />
dans certaines régions, les changements effectués sur les schémas <strong>de</strong> surface pouvaient être faibles<br />
au regard du climat actuel mais importants au regard <strong>de</strong> la sensibilité <strong>de</strong>s modèles au doublement du<br />
CO2 (Crossley et al. 2000, Gedney et al. 2000). La conclusion fut alors que la validation <strong>de</strong>s schémas<br />
<strong>de</strong> surface ne <strong>de</strong>vait pas se limiter au climat actuel, mais également porter sur leur sensibilité à un<br />
forçage climatique donné. On ne peut que souscrire à cette proposition qui est notamment validée par<br />
la controverse précé<strong>de</strong>mment évoquée concernant l’effet direct du CO2 sur les débits observés au<br />
cours du 20 ème siècle.<br />
D’autres étu<strong>de</strong>s plus ou moins inspirées du projet LSPCR ont confirmé que les changements<br />
climatiques prévus en mo<strong>de</strong> « time-slice » dépendaient en partie <strong>de</strong> l’hydrologie continentale,<br />
notamment <strong>de</strong> la paramétrisation du gel et/ou du ruissellement (Gedney et al. 2000, Gedney et Cox<br />
2003, Poutou et al. 2004, Yamaguchi et al. 2005). A ma connaissance, personne n’a cependant<br />
cherché à quantifier explicitement la rétroaction <strong>de</strong> l’HS dans <strong>de</strong> telles expériences. C’est l’une <strong>de</strong>s<br />
propositions que j’ai faites dans le cadre d’un projet <strong>de</strong> collaboration Franco-Indienne soumis au<br />
CEFIPRA en 2002, dont le but était plus généralement <strong>de</strong> tester la robustesse <strong>de</strong> la réponse <strong>de</strong> la<br />
mousson Indienne dans les scénarios climatiques du CNRM (Ashrit et al . 2003). Une paire <strong>de</strong><br />
simulations <strong>de</strong>s climats récent et futur a été relaxée vers une climatologie <strong>de</strong> type GSWP et comparée à<br />
<strong>de</strong>s expériences <strong>de</strong> contrôle avec eau du sol interactive. Les simulations du climat récent,<br />
représentatives <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> 1951-2000, sont forcées par les concentrations <strong>de</strong> GES et les TSM<br />
climatologiques observées. Les simulations du climat futur, représentatives <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> 2051-2100,<br />
sont forcées par les concentrations <strong>de</strong> GES et les anomalies climatologiques <strong>de</strong> TSM issues d’un<br />
scénario B2 réalisé avec le modèle couplé CNRM-CM2. Chaque simulation correspond à une<br />
intégration <strong>de</strong> 20 ans.<br />
Les résultats <strong>de</strong> ces simulations montrent que la rétroaction <strong>de</strong> l’HS est globalement positive et<br />
contribue à renforcer le réchauffement continental en surface, ainsi que la diminution <strong>de</strong>s précipitations<br />
estivales aux moyennes latitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’hémisphère Nord (Fig. 3.7). Ces effets sont particulièrement<br />
prononcés sur l’Europe. L’amplification <strong>de</strong>s anomalies <strong>de</strong> température est cohérente avec les<br />
explications <strong>de</strong> Sutton et al. (2007) relatives au contraste terre-mer qui caractérise le réchauffement en<br />
surface prévu dans les scénarios transitoires du GIEC 5 . Elle renforce également les conclusions <strong>de</strong><br />
Clark et al. (2006) quant au rôle déterminant <strong>de</strong> la réponse hydrologique continentale pour prévoir les<br />
risques <strong>de</strong> canicules associés au réchauffement global. Je n’ai malheureusement jamais eu le temps <strong>de</strong><br />
publier ce résultat, car j’ai surtout profité du projet CEFIPRA pour étudier les limites <strong>de</strong>s expériences <strong>de</strong><br />
changement climatique à l’équilibre. Je reviendrai sur ce point important au chapitre 4.<br />
5 Selon cette étu<strong>de</strong>, le réchauffement supérieur <strong>de</strong>s terres émergées ne relève pas du différentiel d’inertie thermique entre océan et continent,<br />
mais s’explique surtout par la réponse <strong>de</strong>s flux turbulents