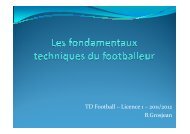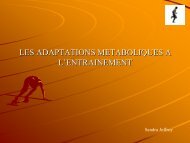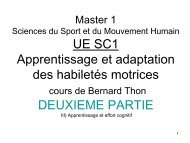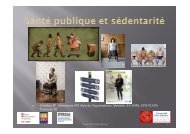Surpoids et obésité de l'adulte - Haute Autorité de Santé
Surpoids et obésité de l'adulte - Haute Autorité de Santé
Surpoids et obésité de l'adulte - Haute Autorité de Santé
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Surpoids</strong> <strong>et</strong> <strong>obésité</strong> <strong>de</strong> l’adulte : prise en charge médicale <strong>de</strong> premier recours<br />
Après la phase <strong>de</strong> lecture externe, l’argumentaire a été mis à jour avec les recommandations<br />
<strong>de</strong> l’OMS 2010, <strong>et</strong> les recommandations relatives à l’activité physique hebdomadaire en<br />
durée <strong>et</strong> en intensité ont été actualisées.<br />
Recommandations<br />
L’activité physique englobe notamment les loisirs, les déplacements (par exemple la marche<br />
ou le vélo), les activités professionnelles, les tâches ménagères, les activités ludiques, les<br />
sports ou l’exercice planifié, dans le contexte quotidien familial ou communautaire.<br />
AE<br />
Une analyse <strong>de</strong>s activités quotidiennes <strong>et</strong> <strong>de</strong>s capacités physiques du patient doit être<br />
systématiquement réalisée avant d’apporter <strong>de</strong>s conseils (cf. fiche annexe 9).<br />
L’éducation thérapeutique vise à encourager les patients à augmenter leur activité physique<br />
même s’ils ne per<strong>de</strong>nt pas <strong>de</strong> poids <strong>et</strong> à réduire le temps consacré à <strong>de</strong>s activités<br />
sé<strong>de</strong>ntaires.<br />
L’activité physique quotidienne doit être présentée comme indispensable au même titre que<br />
le sommeil ou l’hygiène corporelle.<br />
B<br />
AE<br />
L’évaluation du risque cardio-vasculaire global doit être réalisée avant la reprise d’une<br />
activité physique. En fonction <strong>de</strong> son intensité <strong>et</strong> <strong>de</strong>s comorbidités, elle peut justifier un avis<br />
cardiologique.<br />
Les patients doivent être encouragés à effectuer au moins 150 minutes (2 h 30) par semaine<br />
d’activité physique d’intensité modérée (annexe 11). C<strong>et</strong>te activité physique peut être<br />
fractionnée en une ou plusieurs sessions d’au moins 10 minutes.<br />
Pour en r<strong>et</strong>irer un bénéfice supplémentaire pour la santé les adultes <strong>de</strong>vraient augmenter la<br />
durée <strong>de</strong> leur activité physique d’intensité modérée <strong>de</strong> façon à atteindre 300 minutes (5 h)<br />
par semaine ou pratiquer 150 minutes par semaine d’activité physique d’intensité soutenue,<br />
ou une combinaison équivalente d’activité d’intensité modérée <strong>et</strong> soutenue.<br />
Le type d’activité physique doit être expliqué <strong>et</strong> négocié avec le patient en fonction <strong>de</strong> ses<br />
possibilités <strong>et</strong> <strong>de</strong> sa motivation.<br />
Tout nouvel effort par rapport à la situation antérieure doit être valorisé <strong>et</strong> encouragé.<br />
Le mé<strong>de</strong>cin peut avoir recours à un professionnel en activités physiques adaptées en cas<br />
d’objectif thérapeutique initial non atteint ou en cas <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du patient.<br />
5.3.4 Approche psycho-cognitivo-comportementale<br />
Les approches cognitivo-comportementales consistent à diminuer <strong>de</strong>s comportements<br />
symptomatiques notamment par <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> déconditionnement <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />
reconditionnement. Elles tentent <strong>de</strong> modifier entre autres <strong>de</strong>s automatismes réflexes. Elles<br />
interviennent sur les diverses composantes <strong>de</strong>s séquences comportementales, mais aussi<br />
sur la restructuration cognitive qui perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> m<strong>et</strong>tre en lien ce qui se passe entre un<br />
événement précis, une émotion, <strong>de</strong>s pensées <strong>et</strong> un comportement. Ces approches sont<br />
fondées sur <strong>de</strong>s méthodologies précises <strong>et</strong> standardisées selon <strong>de</strong>s protocoles rigoureux<br />
(26).<br />
L’auto-observation <strong>de</strong>s comportements, en particulier <strong>de</strong>s conduites alimentaires, est<br />
l’élément <strong>de</strong> référence <strong>de</strong> l’approche cognitivo-comportementale. Il s’agit d’objectiver les<br />
situations ou cognitions déclenchant <strong>de</strong>s prises alimentaires (26). Certaines personnes<br />
mangent en réaction à <strong>de</strong>s émotions négatives telles que la déception, l’ennui, la nervosité.<br />
D’autres personnes mangent en réaction à <strong>de</strong>s incitants externes tels que l’o<strong>de</strong>ur, la<br />
présentation attrayante, <strong>et</strong> la facilité d’accès <strong>de</strong>s aliments (12).<br />
HAS / Service <strong>de</strong>s bonnes pratiques professionnelles / Septembre 2011<br />
77