Document PDF disponible en téléchargement - INRP
Document PDF disponible en téléchargement - INRP
Document PDF disponible en téléchargement - INRP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
la période2, c'est dans les travaux des spécialistes de la<br />
République, de la laïcité ou de l'école que j'ai décou¬<br />
vert les premières approches de la question qui me<br />
concernait. Claude Nicolet, Pierre Ognier,<br />
Jean-Marie Mayeur, Jean Baubérot illustrai<strong>en</strong>t cette<br />
capacité à pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> compte la d<strong>en</strong>sité philoso¬<br />
phique des textes, sans pour autant perdre de vue le<br />
point de vue de l'histoire, c'est-à-dire tout <strong>en</strong> se<br />
situant dans le cadre sci<strong>en</strong>tifique qui était le leur. Ces<br />
lectures, auxquelles se sont ajoutées celles de<br />
Jean-Louis Fabiani ou Marcel Gauchet m'ont am<strong>en</strong>ée<br />
à un constat : la période de la Troisième République<br />
était, au plan intellectuel, un mom<strong>en</strong>t tout à fait spé¬<br />
cifique, comme une par<strong>en</strong>thèse philosophique, mais<br />
une par<strong>en</strong>thèse paradoxalem<strong>en</strong>t fondatrice. Son¬<br />
geant à ce que Bergson décrit comme une illusion de<br />
la p<strong>en</strong>sée, le mouvem<strong>en</strong>t rétrospectif du vrai, j'ai p<strong>en</strong>sé<br />
que ce n'était finalem<strong>en</strong>t que par un jugem<strong>en</strong>t<br />
"d'après-coup" que l'histoire de la philosophie avait<br />
invalidé la période. L'Histoire de la philosophie<br />
d'Emile Bréhier me semblait, à cet égard, tout à fait<br />
emblématique. Afin de r<strong>en</strong>dre compte de la nature<br />
philosophique de la question du fondem<strong>en</strong>t de la<br />
morale laïque dans les termes où elle s'est posée à ce<br />
mom<strong>en</strong>t-là, j'ai donc décidé de m'<strong>en</strong>fermer dans la<br />
période. En quête de postures rationnelles plutôt que<br />
de systèmes, j'ai dû moi-même adopter une posture<br />
de lecture très empathique ; elle m'a permis de suivre<br />
sans arrière-p<strong>en</strong>sée et sans préjugé les linéam<strong>en</strong>ts<br />
sinueux de l'élan philosophique qui caractérise la<br />
deuxième moitié du XIXe siècle.<br />
Sortie de l'impasse initiale, je n'<strong>en</strong> étais pas quitte<br />
pour autant avec les difficultés méthodologiques.<br />
HISTOIRE, PHILOSOPHIE,<br />
ARCHÉQLQGJE<br />
Ayant pris acte de la spécificité philosophique de la<br />
période, je ne pouvais pas m<strong>en</strong>er une exégèse des<br />
auteurs et des textes à la manière de l'histoire de la<br />
philosophie traditionnelle. Mon projet n'était de<br />
toute façon pas un projet d'histoire de la philosophie,<br />
<strong>en</strong>core moins d'histoire des idées. J'avais à r<strong>en</strong>dre<br />
compte de l'<strong>en</strong>jeu philosophique d'une question à un<br />
mom<strong>en</strong>t donné de l'histoire. Cet <strong>en</strong>jeu était donc<br />
aussi et nécessairem<strong>en</strong>t historico-politique. L'archi¬<br />
tecture de la thèse ainsi que le corpus devai<strong>en</strong>t éclai¬<br />
rer cette ambiguïté intime. Mais plus <strong>en</strong>core, je<br />
s<strong>en</strong>tais que cette ambiguïté devait être prise dans<br />
mon discours lui-même, dans mon langage, <strong>en</strong> un<br />
mot dans mon style. Mon <strong>en</strong>treprise n'étant ni pure¬<br />
m<strong>en</strong>t philosophique, ni purem<strong>en</strong>t historique, mais<br />
plutôt archéologique ou généalogique, je p<strong>en</strong>sais que<br />
mon travail se situait nécessairem<strong>en</strong>t à lafrontière des<br />
g<strong>en</strong>res et que mon style devait r<strong>en</strong>dre compte d'une<br />
démarche intellectuelle et d'un objet de recherche qui<br />
se situai<strong>en</strong>t à la marge.<br />
Cette difficulté a été à l'origine d'un inconfort très<br />
grand, d'un doute que j'ai conservé, de manière<br />
récurr<strong>en</strong>te, jusqu'à la sout<strong>en</strong>ance. À maintes reprises,<br />
j'ai remis <strong>en</strong> question la qualité sci<strong>en</strong>tifique de mon<br />
travail. Mon seul repère dans ces incertitudes était<br />
Claude Lelièvre. Je lui soumettais régulièrem<strong>en</strong>t ce<br />
que j'écrivais ; comme il était satisfait, je poursuivais<br />
mes recherches. Je ne saurais d'ailleurs que trop<br />
conseiller aux futurs impétrants, non seulem<strong>en</strong>t de<br />
comm<strong>en</strong>cer à écrire le plus rapidem<strong>en</strong>t possible,<br />
mais aussi de rester <strong>en</strong> relation régulière avec leur<br />
Directeur de recherche. J'ai regretté aussi, après<br />
coup, de ne pas être allée plus souv<strong>en</strong>t aux séminaires<br />
de thèse organisés par Claude Lelièvre. J'aurais sans<br />
doute pu y évoquer mes difficultés, ou <strong>en</strong> tout cas<br />
avoir des échanges avec des Doctorants et j'aurais<br />
gagné du temps.<br />
Car, il faut bi<strong>en</strong> le dire, j'ai manqué de temps et ce<br />
n'est pas seulem<strong>en</strong>t ma vie personnelle et profession¬<br />
nelle qui <strong>en</strong> est la cause. Je travaillais seule, et je p<strong>en</strong>se<br />
que c'était une erreur. D'autant que la "littérature"<br />
que je sortais de l'ombre était paradoxalem<strong>en</strong>t diffi¬<br />
cile d'accès. Il y aurait beaucoup à dire sur cette ques¬<br />
tion qui laisse perplexe. La période de la Troisième<br />
République est une période réc<strong>en</strong>te de notre histoire.<br />
On pourrait s'att<strong>en</strong>dre, notamm<strong>en</strong>t à la bibliothèque<br />
Depuis, des recherches de plus <strong>en</strong> plus nombreuses t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t à faire sortir la période de son purgatoire : outre les travaux de Patrice<br />
Vermer<strong>en</strong> sur Victor Cousin (L'Harmattan, 1995), citons égalem<strong>en</strong>t la thèse du philosophe espagnol Jordi Riba sur Jean-Marie<br />
Cuyau (L'Harmattan, 1999), celle de Laur<strong>en</strong>t Fédi sur la théorie de la connaissance de R<strong>en</strong>ouvier (L'Harmattan, 1998) el celle de<br />
Marie-Claude Figeat-Blais sur R<strong>en</strong>ouvier philosophe de la République (E.H.E.S.S., 1998, à paraître aux éditions Gallimard).<br />
CHEMINS DE DOCTORANTS 95






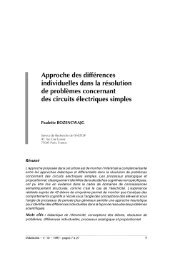




![RH015-016 [Técharger pdf] - Institut français de l'éducation](https://img.yumpu.com/18592417/1/167x260/rh015-016-techarger-pdf-institut-francais-de-leducation.jpg?quality=85)


![RH039-040 [Técharger pdf] - INRP](https://img.yumpu.com/17725763/1/167x260/rh039-040-techarger-pdf-inrp.jpg?quality=85)


