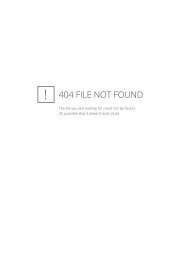Les liaisons fructueuses - RUIG-GIAN
Les liaisons fructueuses - RUIG-GIAN
Les liaisons fructueuses - RUIG-GIAN
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
les projets en partenariat avec un réseau de plusieurs<br />
organisations universitaires et éventuellement<br />
avec les acteurs sur le terrain 5 ;<br />
l’ouverture au monde international (gouvernemental<br />
et non gouvernemental) et l’association<br />
aux recherches menées par les institutions académiques<br />
d’au moins une organisation internationale<br />
présente ou représentée à Genève ;<br />
le financement de la mise en œuvre initiale des<br />
projets, sous réserve que les organismes partenaires<br />
apportent leur contribution complémentaire<br />
(financière ou en nature) à leur réalisation.<br />
L’élaboration d’un projet : le cas du RIBios<br />
Le projet intitulé «Environnement et développement<br />
durable : les enjeux de la biosécurité» déposé par un<br />
groupe de chercheurs de l’IUED qui a pris par la<br />
suite le nom RIBios (Réseau Interdisciplinaire Biosécurité)<br />
était un des premiers projets de recherche<br />
que le <strong>RUIG</strong> a accepté en 2001. L’impulsion initiale<br />
à la présentation du projet RIBios a été donnée par<br />
la signature du Protocole de Cartagena sur la prévention<br />
des risques biotechnologiques (dit Protocole de biosécurité),<br />
au début de 2000. Ce protocole a pour but<br />
de mettre en place des instruments de régulation en<br />
vue d’assurer la biosécurité, c’est-à-dire «de protéger<br />
la diversité biologique ainsi que la santé humaine<br />
face aux risques, présumés ou non, provenant du<br />
transfert, de la manipulation et de l’utilisation<br />
d’organismes vivants modifiés (OVM) disséminés<br />
dans l’environnement ou destinés à l’alimentation<br />
humaine ou animale». Le Protocole prévoit l’application<br />
du principe de précaution dans le commerce<br />
international et autorise ainsi les pays importateurs à<br />
refuser un produit OVM qui pourrait présenter des<br />
risques pour l’environnement et la santé humaine,<br />
et ce, même en l’absence de certitude scientifique<br />
concernant l’existence de ces risques.<br />
A première vue, la construction du projet RIBios<br />
paraissait assez simple. Mais en réalité, tous les<br />
problèmes étudiés étaient sujets de débats, discussions<br />
et controverses à l’échelle nationale et internationale.<br />
<strong>Les</strong> questions abordées dans le projet ont<br />
débordé la notion de biosécurité et ont également<br />
porté sur l’approfondissement du principe de précaution,<br />
sur l’étude des risques ainsi que sur le choix<br />
démocratique des nouvelles technologies (démocratie<br />
technique). <strong>Les</strong> travaux ont par ailleurs compris<br />
un volet de dialogue avec les scientifiques autour des<br />
biotechnologies végétales et des organismes génétiquement<br />
modifiés.<br />
Enfin, un programme de renforcement des capacités<br />
dans les pays en développement (capacity building) –<br />
consistant en l’organisation de deux ateliers de formation<br />
dans les pays en développement et un cours interdisciplinaire<br />
à l’Université de Genève - a été inclus<br />
dans le programme.<br />
L’étude de la «biosécurité» a été justifiée d’abord<br />
par sa nouveauté, mais aussi par le fait qu’elle a<br />
touché aux thèmes débattus au sein de nombreuses<br />
organisations suisses et internationales, gouvernementales<br />
et non gouvernementales. Quand<br />
le projet RIBios a débuté au mois de mars 2002,<br />
la notion de «biosécurité» (biosafety) était pratiquement<br />
inconnue en dehors d’un cercle restreint<br />
5. La méthode d’organisation en réseau, empruntée des entreprises, mais appliquée dans la recherche académique a été préconisée par M. Charles Kleiber, Secrétaire d’Etat à l’éducation<br />
et à la recherche. On peut dire que le <strong>RUIG</strong> était le précurseur de cette nouvelle organisation de l’enseignement et de la recherche académique. En effet, une organisation en réseau «se<br />
présente comme une structure flexible et adaptative mobilisant – et non plus possédant – un ensemble coordonné et stabilisé de compétences (ou savoir-faire)». Cf. PACHE Gilles et<br />
PARAPONARIS Claude, L’entreprise en réseau. Paris, PUF, 1993, p. 7.<br />
Environnement et développement durable : enjeux de la «biosécurité»<br />
Coordinateur : Andràs November<br />
119