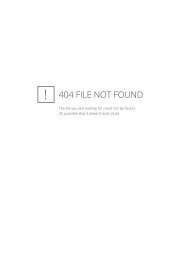Les liaisons fructueuses - RUIG-GIAN
Les liaisons fructueuses - RUIG-GIAN
Les liaisons fructueuses - RUIG-GIAN
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
IV – La portée intellectuelle et opérationnelle du <strong>RUIG</strong><br />
sation internationale. Ne souhaitant pas mettre trop<br />
de barrières devant les requérants potentiels et craignant<br />
qu’une telle exigence résulte en un blocage<br />
du processus, il opta pour un minimum d’une institution<br />
universitaire et d’une organisation internationale<br />
impliquées dans chaque projet. Néanmoins,<br />
l’Appel d’offres indiqua que «le <strong>RUIG</strong> encourage<br />
tout particulièrement des projets qui associent deux<br />
ou trois des institutions académiques fondatrices.»<br />
Sans en faire une grande question de principe, le<br />
<strong>RUIG</strong> eut à se déterminer à la suite des demandes<br />
reçues sur ce qui était considéré comme organisation<br />
internationale. La définition formelle en ce qui<br />
concerne la Suisse, qui comprend la conclusion d’un<br />
accord de siège entre la Confédération et l’organisation,<br />
était plus restrictive que le sens que l’usage<br />
commun lui donne. Une organisation internationale<br />
doit comporter des Etats membres. Certaines<br />
organisations internationales comptent en outre des<br />
membres qui ne sont pas des Etats. L’Union international<br />
pour la conservation de la nature (UICN), par<br />
exemple, compte parmi ses membres des Etats, des<br />
agences gouvernementales et des ONG : le <strong>RUIG</strong> le<br />
considéra comme une organisation internationale.<br />
Pour les fondateurs du <strong>RUIG</strong>, il fut évident d’emblée<br />
que le Comité international de la Croix-Rouge<br />
(CICR) devait également figurer dans la liste ; il fut<br />
d’ailleurs représenté dès le début au Conseil de Fondation<br />
du <strong>RUIG</strong>.<br />
Pour les projets approuvés lors du premier Appel<br />
d’offres annuel, les fonds octroyés par le <strong>RUIG</strong><br />
furent gérés seulement par des institutions académiques<br />
fondatrices à Genève, selon leurs règles,<br />
ou bien là où des règles claires faisaient défaut,<br />
selon le règlement du <strong>RUIG</strong>. Ceci surchargea<br />
d’ailleurs le service de comptabilité de l’IUED<br />
qui administrait plusieurs projets. Le <strong>RUIG</strong> comprit<br />
rapidement qu’une participation réelle des organisations<br />
internationales impliquait qu’elles eussent<br />
la possibilité de prendre part à la gestion des fonds.<br />
La plupart des organisations internationales exigeaient<br />
que 13% du montant de tout subside reçu<br />
soient utilisés pour leurs frais de fonctionnement<br />
(«overheads»), ce que le <strong>RUIG</strong> refusa. Bref, la répartition<br />
que présente le graphique correspondant ne<br />
reflète pas un phénomène spontané, mais une politique<br />
consciente. Ce problème créa d’énormes complications<br />
dans l’administration de plusieurs projets,<br />
mais des solutions créatives et appropriées purent être<br />
trouvées dans la plupart des situations. Dans un cas<br />
particulier cependant, le projet fut approuvé par le<br />
<strong>RUIG</strong>, puis dut être annulé, principalement en raison<br />
de retards liés à la gestion des fonds.<br />
Outre des universités et des organisations internationales,<br />
le partenariat comportait souvent des ONG. Celles-ci<br />
en étaient parfois le moteur intellectuel et dans<br />
certains cas assumèrent la responsabilité administrative<br />
et financière du subside octroyé par le <strong>RUIG</strong>.<br />
La démarche partenariale<br />
La démarche partenariale dans le cadre du <strong>RUIG</strong><br />
impliquait que chaque partenaire dût apporter sa<br />
participation, et notamment contribuer aux ressources<br />
mises à disposition du projet. Le SER<br />
exigea que l’on imputât une valeur monétaire à<br />
ces «cofinancements» et que ces informations lui<br />
fussent communiquées. Le <strong>RUIG</strong> savait que les<br />
institutions qui participaient aux projets étaient<br />
rarement en mesure de verser une contribution<br />
financière ; l’apport des partenaires était normalement<br />
en nature, l’apport du <strong>RUIG</strong> constituant l’essentiel<br />
de l’apport en espèces. Dans de nombreux<br />
cas cependant, un ou plusieurs des partenaires ou<br />
d’autres bailleurs de fonds contribuèrent avec des<br />
fonds parfois très importants. A plusieurs reprises,<br />
le subside du <strong>RUIG</strong> agit comme levier suscitant<br />
le soutien d’une OI ou d’un autre donateur pour<br />
assurer le financement d’un volet du projet ou la<br />
continuation des activités ou des structures mises<br />
en place. Plusieurs bénéficiaires des fonds informèrent<br />
le <strong>RUIG</strong> que le «label de qualité» offert par le <strong>RUIG</strong>,<br />
surtout grâce à l’évaluation de son Comité scientifique,<br />
donna une crédibilité leur permettant d’attirer<br />
des fonds supplémentaires.<br />
Il est essentiel d’insister sur le fait qu’aucun projet<br />
ne constituait un mandat. Le <strong>RUIG</strong>, en tout cas,<br />
68