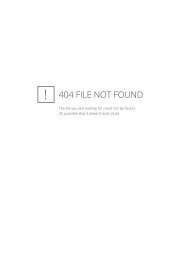Les liaisons fructueuses - RUIG-GIAN
Les liaisons fructueuses - RUIG-GIAN
Les liaisons fructueuses - RUIG-GIAN
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
IV – La portée intellectuelle et opérationnelle du <strong>RUIG</strong><br />
rencontraient à intervalles réguliers pour partager leurs<br />
résultats avec les autres membres de l’équipe. Certaines<br />
recherches aboutirent à des ouvrages avec des volets<br />
séparés, joints par une logique d’ensemble et par une<br />
introduction et une conclusion. Conscient de la difficulté<br />
d’engager une démarche plus intégrée des disciplines,<br />
le <strong>RUIG</strong> a jugé cette méthode appropriée dans<br />
certains cas, estimant qu’elle convenait pour arriver<br />
aux résultats escomptés. Ainsi, le projet «Un langage<br />
commun pour la consolidation de la paix» 13 , qui traita<br />
de la consolidation de la paix et de la reconstruction<br />
post-conflictuelle, réalisa un lexique bilingue, composé<br />
d’une somme d’études thématiques. Suite à des<br />
rencontres de coordination, chaque chapitre fut rédigé<br />
de manière indépendante par un spécialiste d’une discipline.<br />
<strong>Les</strong> contributions individuelles furent ensuite<br />
réunies et organisées dans un ouvrage unique sous la<br />
direction du coordinateur du projet. En raison même<br />
de la nature du projet, l’interaction entre disciplines fut<br />
nécessairement réduite. Il faut cependant ajouter que la<br />
plupart des chapitres concernaient des sujets touchant à<br />
plusieurs disciplines. En effet, le lexique a regroupé des<br />
éclairages spécifiques et distincts sur chaque sujet lié à<br />
la consolidation de la paix afin d’aboutir à un ouvrage<br />
complet et cohérent avec peu d’influence réciproque<br />
d’une discipline sur l’autre.<br />
La deuxième approche, celle appliquée dans la vaste<br />
majorité des projets et que le <strong>RUIG</strong> préconisait en<br />
premier lieu, fut l’approche interdisciplinaire au sens<br />
strict, c’est-à-dire une véritable interaction entre les<br />
disciplines. <strong>Les</strong> chercheurs communiquaient entre eux,<br />
de manière structurée et systématique. Ils mettaient<br />
leurs compétences respectives au service du projet de<br />
recherche, échangeaient leurs points de vue, confrontaient<br />
leurs idées et les logiques de leurs disciplines.<br />
Dans les meilleurs cas, il y eut une forte coopération<br />
et une influence réciproque des disciplines impliquées.<br />
Cette approche permit une analyse plus globale des<br />
sujets d’étude et un véritable enrichissement mutuel<br />
des disciplines. Certains projets soutenus par le <strong>RUIG</strong><br />
surent très bien appliquer cette méthode et débouchèrent<br />
sur d’excellents résultats. De nombreux témoignages<br />
figurant ultérieurement dans cet ouvrage, font état<br />
des joies et des défis des recherches menées de manière<br />
interdisciplinaire.<br />
La troisième approche fut transdisciplinaire. Celle-ci<br />
peut être considérée comme l’intégration aboutie<br />
des disciplines. Elle dépasse le cadre des disciplines<br />
respectives et tend au développement ou au renforcement<br />
de compétences communes transversales.<br />
Elle ne fut que rarement mise en œuvre.<br />
Ces trois approches, pluridisciplinaire, interdisciplinaire<br />
et transdisciplinaire, furent admises par le<br />
<strong>RUIG</strong>. Lors de l’acceptation des projets, le <strong>RUIG</strong><br />
ne chercha pas à creuser la distinction entre ces trois<br />
concepts. Pour lui, l’essentiel était d’encourager les<br />
chercheurs à sortir de leur enclos pour aller à la rencontre<br />
de chercheurs qui abordent les mêmes problèmes<br />
sous un angle différent.<br />
L’interdisciplinarité : quels impacts ?<br />
L’interdisciplinarité, à des niveaux d’intensité différents,<br />
fut mise en pratique avec plus ou moins de facilité<br />
par les partenaires des projets. En effet, les sujets de<br />
recherche étaient souvent très complexes, à cheval sur<br />
plusieurs domaines. <strong>Les</strong> rencontres entre disciplines se<br />
sont avérées fécondes, non seulement grâce à l’apport<br />
distinct de chacune d’entre elles, mais également du<br />
fait que les chercheurs souhaitant travailler de cette<br />
manière eurent sans doute un esprit ouvert. L’interdisciplinarité<br />
eut de nombreux effets bénéfiques sur<br />
les projets de recherche, tant sur leur déroulement que<br />
sur leurs résultats. Enfin, elle suscita non seulement<br />
la formation de nouveaux partenariats, mais aussi de<br />
nouvelles interactions entre disciplines.<br />
Le critère de l’interdisciplinarité imposé par le <strong>RUIG</strong><br />
fut un défi pour les équipes de recherche, mais contribua<br />
également à la richesse des projets de recherche.<br />
<strong>Les</strong> partenaires furent contraints de faire preuve<br />
d’écoute et d’ouverture d’esprit pour comprendre et<br />
manier des concepts relevant de disciplines qu’ils ne<br />
connaissaient ou ne maîtrisaient pas. Ils durent comparer<br />
et confronter leurs points de vue et leurs méthodes<br />
de travail de sorte que les différentes disciplines en<br />
jeu se complètent, pour aboutir à un résultat original<br />
et éviter qu’elles restent imperméables ou s’opposent<br />
les unes aux autres.<br />
90<br />
13. «La consolidation de la paix et la reconstruction post-conflictuelle : élaboration d’un langage commun pour une meilleure prise en compte des besoins» (Chetail 2006).