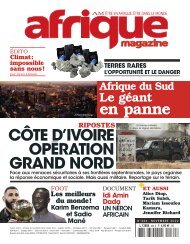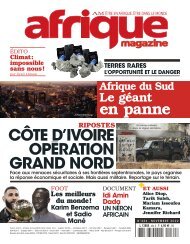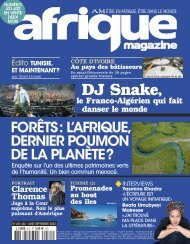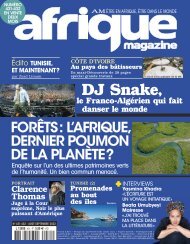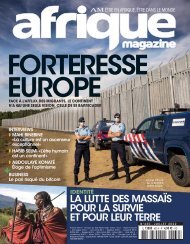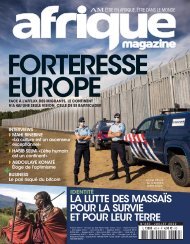You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
DR<br />
animalité et humanité. Cette idée que l’on<br />
forme une communauté entière, les humains<br />
et les non-humains, dans un rapport de négociations,<br />
d’affinités, de discussions et non pas<br />
d’exploitation existe dans les cultures africaines,<br />
amérindiennes. Nous réfléchirons de<br />
quelle manière ces ressources imaginaires,<br />
intellectuelles, peuvent produire des formes<br />
de vie politique, sociale, culturelle, économique<br />
différentes, afin de répondre aux<br />
défis écologiques, aux besoins du vivant, des<br />
liens sociaux.<br />
Le Sénégal est-il une exception<br />
culturelle en matière de politiques<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
SÉLECTIVE<br />
◗ Les Lieux qu’habitent<br />
mes rêves, Gallimard,<br />
2022.<br />
◗ La Saveur des<br />
derniers mètres,<br />
Philippe Rey, 2021.<br />
◗ Restituer le<br />
patrimoine africain,<br />
Philippe Rey/Seuil,<br />
2018.<br />
◗ Afrotopia, Philippe<br />
Rey, 2016.<br />
menées dans ce domaine ?<br />
La créativité de la scène artistique<br />
sénégalaise pallie le déficit de vraies<br />
grandes politiques culturelles. Même si<br />
certaines sont conduites ces dernières<br />
années, avec notamment le Musée des<br />
civilisations noires, la biennale de Dakar,<br />
ou encore certaines infrastructures…<br />
Mais la vitalité vient d’abord de la<br />
scène culturelle. Elle est héritière de<br />
politiques importantes installées dans<br />
les années 1960-1970. Il y a eu un<br />
foisonnement depuis les indépendances,<br />
Léopold Sédar Senghor a inscrit le pays<br />
dans une trajectoire de valorisation de la culture<br />
au sens large. En 1966, le Festival mondial<br />
des arts nègres, organisé à Dakar, a également été<br />
un moment essentiel.<br />
Qu’entendez-vous à travers les productions<br />
des jeunes talents sénégalais ?<br />
Sur le continent, de manière plus globale, on<br />
observe depuis quelques années une richesse dans<br />
la créativité : musique, littérature, arts visuels,<br />
cinéma… Le continent est le lieu d’un bouillonnement artistique<br />
et culturel. Le geste artistique dit notamment le désir<br />
de se réinventer, tout comme le métissage. Ce n’est plus le<br />
temps où les artistes évaluent la profondeur du manque et<br />
de la perte, se guérissent d’un traumatisme. On peut lire le<br />
continent se racontant à lui-même et au monde, à travers ce<br />
geste. Maintenant, les jeunes sont préoccupés par leur avenir<br />
– études, emploi, travail –, par leur place, qui ils sont et<br />
quels rapports articuler avec le monde. Ce sont des inquiétudes<br />
normales de la jeunesse, avec un fort désir de se réaliser,<br />
trouver les opportunités possibles pour se déployer, dans<br />
les lieux où ils vivent. C’est ce que j’entends dans plusieurs<br />
formes d’expression.<br />
Avec Bénédicte Savoy,<br />
vous êtes coauteur de<br />
Restituer le patrimoine<br />
africain. Pourquoi<br />
est-ce essentiel que<br />
ces objets détenus par<br />
la France reviennent<br />
au continent ?<br />
Dans le geste de réinvention<br />
de soi, du présent<br />
et du futur, on a besoin de<br />
reconstruire sa mémoire<br />
et son histoire. Et il nous<br />
a manqué des objets, des œuvres spirituelles,<br />
matérielles, qui disent notre<br />
histoire, notre génie, nos spiritualités,<br />
nos sens artistiques, nos visions<br />
du monde, nos philosophies. Les<br />
groupes humains ont besoin de renégocier<br />
constamment avec leur capital<br />
culturel, de transmettre leur vécu,<br />
leur patrimoine. Pour qu’ainsi, les<br />
nouvelles générations s’en inspirent<br />
et construisent à partir de ça. Si l’on<br />
récupère ces traces, si l’on remet ces<br />
objets dans la forge de la transmission, cela nous<br />
aidera à reconstruire dans le présent et, dans le<br />
futur, à répondre aux défis actuels.<br />
« L’Afrique n’a personne à rattraper »,<br />
écriviez-vous dans votre essai Afrotopia.<br />
Il faut sortir de cette idée que l’on serait en<br />
retard, que l’on devrait rattraper. On n’est en compétition<br />
avec personne. La première bataille à<br />
gagner est de déterminer quelle société nous voulons,<br />
qu’est-ce qu’une bonne vie. Toutes les sociétés<br />
aspirent au bien-être, fait de paix sociale, de rapport<br />
à la culture, à l’écologie, de spiritualité chez<br />
certains… Les sociétés africaines sont les plus anciennes de l’humanité,<br />
elles sont en mesure de définir elles-mêmes leur futur.<br />
Il faut assigner une place juste à l’économie, laquelle est un<br />
moyen et pas une fin, qui doit être en symbiose avec les autres<br />
ordres, sans les diminuer ni les détruire. On peut éventuellement<br />
s’inspirer des autres aventures sociétales, mais également<br />
éviter leurs erreurs, ne pas reproduire ces modèles d’industrialisation<br />
destructeurs pour la planète. Notre problématique n’est<br />
pas fondamentalement économique, mais d’abord culturelle,<br />
civilisationnelle, psychologique. Il faut évidemment répondre<br />
aux besoins économiques, mais nous vivons pour nous remplir<br />
dans des espaces de sens, de significations, qui sont à remettre<br />
au centre. La culture est le début et la fin de ces processus. ■<br />
HORS-SÉRIE AFRIQUE MAGAZINE I FÉVRIER 2022 123