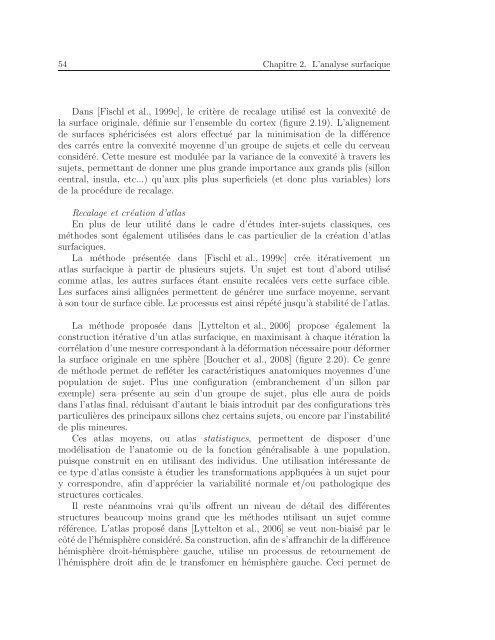TH`ESE Cédric CLOUCHOUX LOCALISATION ET ...
TH`ESE Cédric CLOUCHOUX LOCALISATION ET ...
TH`ESE Cédric CLOUCHOUX LOCALISATION ET ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
54 Chapitre 2. L’analyse surfacique<br />
Dans [Fischl et al., 1999c], le critère de recalage utilisé est la convexité de<br />
la surface originale, définie sur l’ensemble du cortex (figure 2.19). L’alignement<br />
de surfaces sphéricisées est alors effectué par la minimisation de la différence<br />
des carrés entre la convexité moyenne d’un groupe de sujets et celle du cerveau<br />
considéré. Cette mesure est modulée par la variance de la convexité à travers les<br />
sujets, permettant de donner une plus grande importance aux grands plis (sillon<br />
central, insula, etc...) qu’aux plis plus superficiels (et donc plus variables) lors<br />
de la procédure de recalage.<br />
Recalage et création d’atlas<br />
En plus de leur utilité dans le cadre d’études inter-sujets classiques, ces<br />
méthodes sont également utilisées dans le cas particulier de la création d’atlas<br />
surfaciques.<br />
La méthode présentée dans [Fischl et al., 1999c] crée itérativement un<br />
atlas surfacique à partir de plusieurs sujets. Un sujet est tout d’abord utilisé<br />
comme atlas, les autres surfaces étant ensuite recalées vers cette surface cible.<br />
Les surfaces ainsi allignées permettent de générer une surface moyenne, servant<br />
à son tour de surface cible. Le processus est ainsi répété jusqu’à stabilité de l’atlas.<br />
La méthode proposée dans [Lyttelton et al., 2006] propose également la<br />
construction itérative d’un atlas surfacique, en maximisant à chaque itération la<br />
corrélation d’une mesure correspondant à la déformation nécessaire pour déformer<br />
la surface originale en une sphère [Boucher et al., 2008] (figure 2.20). Ce genre<br />
de méthode permet de refléter les caractéristiques anatomiques moyennes d’une<br />
population de sujet. Plus une configuration (embranchement d’un sillon par<br />
exemple) sera présente au sein d’un groupe de sujet, plus elle aura de poids<br />
dans l’atlas final, réduisant d’autant le biais introduit par des configurations très<br />
particulières des principaux sillons chez certains sujets, ou encore par l’instabilité<br />
de plis mineures.<br />
Ces atlas moyens, ou atlas statistiques, permettent de disposer d’une<br />
modélisation de l’anatomie ou de la fonction généralisable à une population,<br />
puisque construit en en utilisant des individus. Une utilisation intéressante de<br />
ce type d’atlas consiste à étudier les transformations appliquées à un sujet pour<br />
y correspondre, afin d’apprécier la variabilité normale et/ou pathologique des<br />
structures corticales.<br />
Il reste néanmoins vrai qu’ils offrent un niveau de détail des différentes<br />
structures beaucoup moins grand que les méthodes utilisant un sujet comme<br />
référence. L’atlas proposé dans [Lyttelton et al., 2006] se veut non-biaisé par le<br />
côté de l’hémisphère considéré. Sa construction, afin de s’affranchir de la différence<br />
hémisphère droit-hémisphère gauche, utilise un processus de retournement de<br />
l’hémisphère droit afin de le transfomer en hémisphère gauche. Ceci permet de