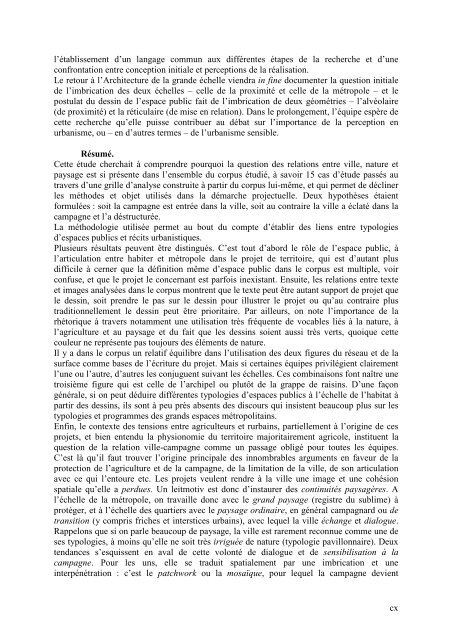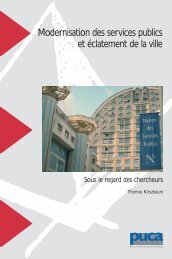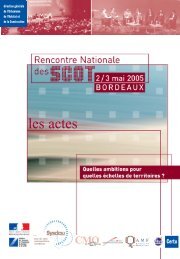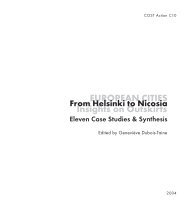i ANNEXE 1 : Organigramme du Ministère de l'Ecologie ... - Urbamet
i ANNEXE 1 : Organigramme du Ministère de l'Ecologie ... - Urbamet
i ANNEXE 1 : Organigramme du Ministère de l'Ecologie ... - Urbamet
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
l’établissement d’un langage commun aux différentes étapes <strong>de</strong> la recherche et d’une<br />
confrontation entre conception initiale et perceptions <strong>de</strong> la réalisation.<br />
Le retour à l’Architecture <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> échelle viendra in fine documenter la question initiale<br />
<strong>de</strong> l’imbrication <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux échelles – celle <strong>de</strong> la proximité et celle <strong>de</strong> la métropole – et le<br />
postulat <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin <strong>de</strong> l’espace public fait <strong>de</strong> l’imbrication <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux géométries – l’alvéolaire<br />
(<strong>de</strong> proximité) et la réticulaire (<strong>de</strong> mise en relation). Dans le prolongement, l’équipe espère <strong>de</strong><br />
cette recherche qu’elle puisse contribuer au débat sur l’importance <strong>de</strong> la perception en<br />
urbanisme, ou – en d’autres termes – <strong>de</strong> l’urbanisme sensible.<br />
Résumé.<br />
Cette étu<strong>de</strong> cherchait à comprendre pourquoi la question <strong>de</strong>s relations entre ville, nature et<br />
paysage est si présente dans l’ensemble <strong>du</strong> corpus étudié, à savoir 15 cas d’étu<strong>de</strong> passés au<br />
travers d’une grille d’analyse construite à partir <strong>du</strong> corpus lui-même, et qui permet <strong>de</strong> décliner<br />
les métho<strong>de</strong>s et objet utilisés dans la démarche projectuelle. Deux hypothèses étaient<br />
formulées : soit la campagne est entrée dans la ville, soit au contraire la ville a éclaté dans la<br />
campagne et l’a déstructurée.<br />
La méthodologie utilisée permet au bout <strong>du</strong> compte d’établir <strong>de</strong>s liens entre typologies<br />
d’espaces publics et récits urbanistiques.<br />
Plusieurs résultats peuvent être distingués. C’est tout d’abord le rôle <strong>de</strong> l’espace public, à<br />
l’articulation entre habiter et métropole dans le projet <strong>de</strong> territoire, qui est d’autant plus<br />
difficile à cerner que la définition même d’espace public dans le corpus est multiple, voir<br />
confuse, et que le projet le concernant est parfois inexistant. Ensuite, les relations entre texte<br />
et images analysées dans le corpus montrent que le texte peut être autant support <strong>de</strong> projet que<br />
le <strong>de</strong>ssin, soit prendre le pas sur le <strong>de</strong>ssin pour illustrer le projet ou qu’au contraire plus<br />
traditionnellement le <strong>de</strong>ssin peut être prioritaire. Par ailleurs, on note l’importance <strong>de</strong> la<br />
rhétorique à travers notamment une utilisation très fréquente <strong>de</strong> vocables liés à la nature, à<br />
l’agriculture et au paysage et <strong>du</strong> fait que les <strong>de</strong>ssins soient aussi très verts, quoique cette<br />
couleur ne représente pas toujours <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> nature.<br />
Il y a dans le corpus un relatif équilibre dans l’utilisation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux figures <strong>du</strong> réseau et <strong>de</strong> la<br />
surface comme bases <strong>de</strong> l’écriture <strong>du</strong> projet. Mais si certaines équipes privilégient clairement<br />
l’une ou l’autre, d’autres les conjuguent suivant les échelles. Ces combinaisons font naître une<br />
troisième figure qui est celle <strong>de</strong> l’archipel ou plutôt <strong>de</strong> la grappe <strong>de</strong> raisins. D’une façon<br />
générale, si on peut dé<strong>du</strong>ire différentes typologies d’espaces publics à l’échelle <strong>de</strong> l’habitat à<br />
partir <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssins, ils sont à peu près absents <strong>de</strong>s discours qui insistent beaucoup plus sur les<br />
typologies et programmes <strong>de</strong>s grands espaces métropolitains.<br />
Enfin, le contexte <strong>de</strong>s tensions entre agriculteurs et rurbains, partiellement à l’origine <strong>de</strong> ces<br />
projets, et bien enten<strong>du</strong> la physionomie <strong>du</strong> territoire majoritairement agricole, instituent la<br />
question <strong>de</strong> la relation ville-campagne comme un passage obligé pour toutes les équipes.<br />
C’est là qu’il faut trouver l’origine principale <strong>de</strong>s innombrables arguments en faveur <strong>de</strong> la<br />
protection <strong>de</strong> l’agriculture et <strong>de</strong> la campagne, <strong>de</strong> la limitation <strong>de</strong> la ville, <strong>de</strong> son articulation<br />
avec ce qui l’entoure etc. Les projets veulent rendre à la ville une image et une cohésion<br />
spatiale qu’elle a per<strong>du</strong>es. Un leitmotiv est donc d’instaurer <strong>de</strong>s continuités paysagères. A<br />
l’échelle <strong>de</strong> la métropole, on travaille donc avec le grand paysage (registre <strong>du</strong> sublime) à<br />
protéger, et à l’échelle <strong>de</strong>s quartiers avec le paysage ordinaire, en général campagnard ou <strong>de</strong><br />
transition (y compris friches et interstices urbains), avec lequel la ville échange et dialogue.<br />
Rappelons que si on parle beaucoup <strong>de</strong> paysage, la ville est rarement reconnue comme une <strong>de</strong><br />
ses typologies, à moins qu’elle ne soit très irriguée <strong>de</strong> nature (typologie pavillonnaire). Deux<br />
tendances s’esquissent en aval <strong>de</strong> cette volonté <strong>de</strong> dialogue et <strong>de</strong> sensibilisation à la<br />
campagne. Pour les uns, elle se tra<strong>du</strong>it spatialement par une imbrication et une<br />
interpénétration : c’est le patchwork ou la mosaïque, pour lequel la campagne <strong>de</strong>vient<br />
cx