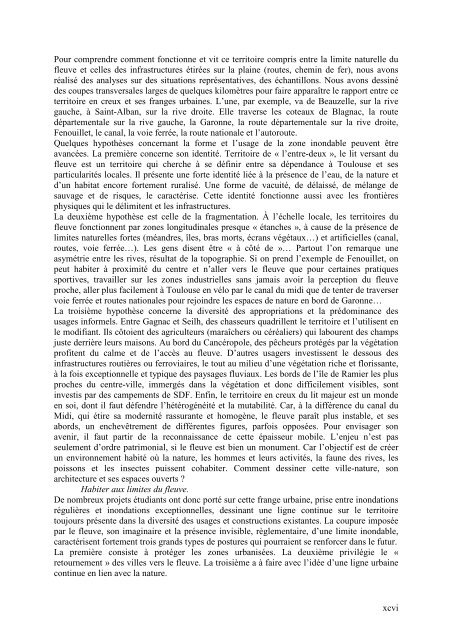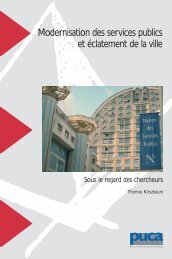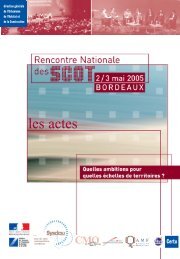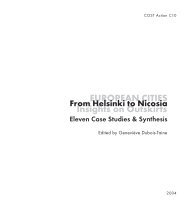i ANNEXE 1 : Organigramme du Ministère de l'Ecologie ... - Urbamet
i ANNEXE 1 : Organigramme du Ministère de l'Ecologie ... - Urbamet
i ANNEXE 1 : Organigramme du Ministère de l'Ecologie ... - Urbamet
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Pour comprendre comment fonctionne et vit ce territoire compris entre la limite naturelle <strong>du</strong><br />
fleuve et celles <strong>de</strong>s infrastructures étirées sur la plaine (routes, chemin <strong>de</strong> fer), nous avons<br />
réalisé <strong>de</strong>s analyses sur <strong>de</strong>s situations représentatives, <strong>de</strong>s échantillons. Nous avons <strong>de</strong>ssiné<br />
<strong>de</strong>s coupes transversales larges <strong>de</strong> quelques kilomètres pour faire apparaître le rapport entre ce<br />
territoire en creux et ses franges urbaines. L’une, par exemple, va <strong>de</strong> Beauzelle, sur la rive<br />
gauche, à Saint-Alban, sur la rive droite. Elle traverse les coteaux <strong>de</strong> Blagnac, la route<br />
départementale sur la rive gauche, la Garonne, la route départementale sur la rive droite,<br />
Fenouillet, le canal, la voie ferrée, la route nationale et l’autoroute.<br />
Quelques hypothèses concernant la forme et l’usage <strong>de</strong> la zone inondable peuvent être<br />
avancées. La première concerne son i<strong>de</strong>ntité. Territoire <strong>de</strong> « l’entre-<strong>de</strong>ux », le lit versant <strong>du</strong><br />
fleuve est un territoire qui cherche à se définir entre sa dépendance à Toulouse et ses<br />
particularités locales. Il présente une forte i<strong>de</strong>ntité liée à la présence <strong>de</strong> l’eau, <strong>de</strong> la nature et<br />
d’un habitat encore fortement ruralisé. Une forme <strong>de</strong> vacuité, <strong>de</strong> délaissé, <strong>de</strong> mélange <strong>de</strong><br />
sauvage et <strong>de</strong> risques, le caractérise. Cette i<strong>de</strong>ntité fonctionne aussi avec les frontières<br />
physiques qui le délimitent et les infrastructures.<br />
La <strong>de</strong>uxième hypothèse est celle <strong>de</strong> la fragmentation. À l’échelle locale, les territoires <strong>du</strong><br />
fleuve fonctionnent par zones longitudinales presque « étanches », à cause <strong>de</strong> la présence <strong>de</strong><br />
limites naturelles fortes (méandres, îles, bras morts, écrans végétaux…) et artificielles (canal,<br />
routes, voie ferrée…). Les gens disent être « à côté <strong>de</strong> »… Partout l’on remarque une<br />
asymétrie entre les rives, résultat <strong>de</strong> la topographie. Si on prend l’exemple <strong>de</strong> Fenouillet, on<br />
peut habiter à proximité <strong>du</strong> centre et n’aller vers le fleuve que pour certaines pratiques<br />
sportives, travailler sur les zones in<strong>du</strong>strielles sans jamais avoir la perception <strong>du</strong> fleuve<br />
proche, aller plus facilement à Toulouse en vélo par le canal <strong>du</strong> midi que <strong>de</strong> tenter <strong>de</strong> traverser<br />
voie ferrée et routes nationales pour rejoindre les espaces <strong>de</strong> nature en bord <strong>de</strong> Garonne…<br />
La troisième hypothèse concerne la diversité <strong>de</strong>s appropriations et la prédominance <strong>de</strong>s<br />
usages informels. Entre Gagnac et Seilh, <strong>de</strong>s chasseurs quadrillent le territoire et l’utilisent en<br />
le modifiant. Ils côtoient <strong>de</strong>s agriculteurs (maraîchers ou céréaliers) qui labourent <strong>de</strong>s champs<br />
juste <strong>de</strong>rrière leurs maisons. Au bord <strong>du</strong> Cancéropole, <strong>de</strong>s pêcheurs protégés par la végétation<br />
profitent <strong>du</strong> calme et <strong>de</strong> l’accès au fleuve. D’autres usagers investissent le <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong>s<br />
infrastructures routières ou ferroviaires, le tout au milieu d’une végétation riche et florissante,<br />
à la fois exceptionnelle et typique <strong>de</strong>s paysages fluviaux. Les bords <strong>de</strong> l’île <strong>de</strong> Ramier les plus<br />
proches <strong>du</strong> centre-ville, immergés dans la végétation et donc difficilement visibles, sont<br />
investis par <strong>de</strong>s campements <strong>de</strong> SDF. Enfin, le territoire en creux <strong>du</strong> lit majeur est un mon<strong>de</strong><br />
en soi, dont il faut défendre l’hétérogénéité et la mutabilité. Car, à la différence <strong>du</strong> canal <strong>du</strong><br />
Midi, qui étire sa mo<strong>de</strong>rnité rassurante et homogène, le fleuve paraît plus instable, et ses<br />
abords, un enchevêtrement <strong>de</strong> différentes figures, parfois opposées. Pour envisager son<br />
avenir, il faut partir <strong>de</strong> la reconnaissance <strong>de</strong> cette épaisseur mobile. L’enjeu n’est pas<br />
seulement d’ordre patrimonial, si le fleuve est bien un monument. Car l’objectif est <strong>de</strong> créer<br />
un environnement habité où la nature, les hommes et leurs activités, la faune <strong>de</strong>s rives, les<br />
poissons et les insectes puissent cohabiter. Comment <strong>de</strong>ssiner cette ville-nature, son<br />
architecture et ses espaces ouverts ?<br />
Habiter aux limites <strong>du</strong> fleuve.<br />
De nombreux projets étudiants ont donc porté sur cette frange urbaine, prise entre inondations<br />
régulières et inondations exceptionnelles, <strong>de</strong>ssinant une ligne continue sur le territoire<br />
toujours présente dans la diversité <strong>de</strong>s usages et constructions existantes. La coupure imposée<br />
par le fleuve, son imaginaire et la présence invisible, règlementaire, d’une limite inondable,<br />
caractérisent fortement trois grands types <strong>de</strong> postures qui pourraient se renforcer dans le futur.<br />
La première consiste à protéger les zones urbanisées. La <strong>de</strong>uxième privilégie le «<br />
retournement » <strong>de</strong>s villes vers le fleuve. La troisième a à faire avec l’idée d’une ligne urbaine<br />
continue en lien avec la nature.<br />
xcvi