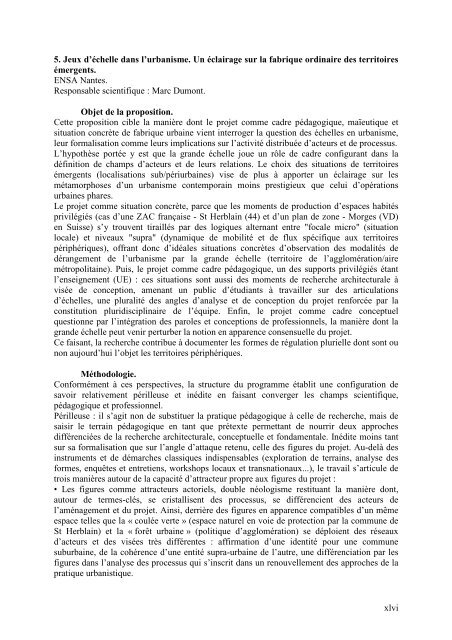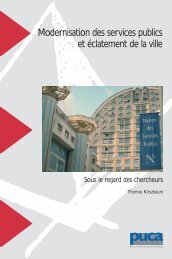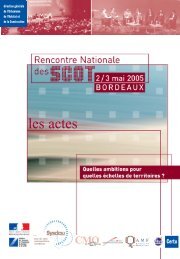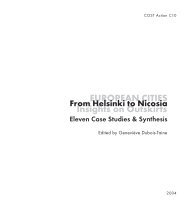i ANNEXE 1 : Organigramme du Ministère de l'Ecologie ... - Urbamet
i ANNEXE 1 : Organigramme du Ministère de l'Ecologie ... - Urbamet
i ANNEXE 1 : Organigramme du Ministère de l'Ecologie ... - Urbamet
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
5. Jeux d’échelle dans l’urbanisme. Un éclairage sur la fabrique ordinaire <strong>de</strong>s territoires<br />
émergents.<br />
ENSA Nantes.<br />
Responsable scientifique : Marc Dumont.<br />
Objet <strong>de</strong> la proposition.<br />
Cette proposition cible la manière dont le projet comme cadre pédagogique, maïeutique et<br />
situation concrète <strong>de</strong> fabrique urbaine vient interroger la question <strong>de</strong>s échelles en urbanisme,<br />
leur formalisation comme leurs implications sur l’activité distribuée d’acteurs et <strong>de</strong> processus.<br />
L’hypothèse portée y est que la gran<strong>de</strong> échelle joue un rôle <strong>de</strong> cadre configurant dans la<br />
définition <strong>de</strong> champs d’acteurs et <strong>de</strong> leurs relations. Le choix <strong>de</strong>s situations <strong>de</strong> territoires<br />
émergents (localisations sub/périurbaines) vise <strong>de</strong> plus à apporter un éclairage sur les<br />
métamorphoses d’un urbanisme contemporain moins prestigieux que celui d’opérations<br />
urbaines phares.<br />
Le projet comme situation concrète, parce que les moments <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction d’espaces habités<br />
privilégiés (cas d’une ZAC française - St Herblain (44) et d’un plan <strong>de</strong> zone - Morges (VD)<br />
en Suisse) s’y trouvent tiraillés par <strong>de</strong>s logiques alternant entre "focale micro" (situation<br />
locale) et niveaux "supra" (dynamique <strong>de</strong> mobilité et <strong>de</strong> flux spécifique aux territoires<br />
périphériques), offrant donc d’idéales situations concrètes d’observation <strong>de</strong>s modalités <strong>de</strong><br />
dérangement <strong>de</strong> l’urbanisme par la gran<strong>de</strong> échelle (territoire <strong>de</strong> l’agglomération/aire<br />
métropolitaine). Puis, le projet comme cadre pédagogique, un <strong>de</strong>s supports privilégiés étant<br />
l’enseignement (UE) : ces situations sont aussi <strong>de</strong>s moments <strong>de</strong> recherche architecturale à<br />
visée <strong>de</strong> conception, amenant un public d’étudiants à travailler sur <strong>de</strong>s articulations<br />
d’échelles, une pluralité <strong>de</strong>s angles d’analyse et <strong>de</strong> conception <strong>du</strong> projet renforcée par la<br />
constitution pluridisciplinaire <strong>de</strong> l’équipe. Enfin, le projet comme cadre conceptuel<br />
questionne par l’intégration <strong>de</strong>s paroles et conceptions <strong>de</strong> professionnels, la manière dont la<br />
gran<strong>de</strong> échelle peut venir perturber la notion en apparence consensuelle <strong>du</strong> projet.<br />
Ce faisant, la recherche contribue à documenter les formes <strong>de</strong> régulation plurielle dont sont ou<br />
non aujourd’hui l’objet les territoires périphériques.<br />
Méthodologie.<br />
Conformément à ces perspectives, la structure <strong>du</strong> programme établit une configuration <strong>de</strong><br />
savoir relativement périlleuse et inédite en faisant converger les champs scientifique,<br />
pédagogique et professionnel.<br />
Périlleuse : il s’agit non <strong>de</strong> substituer la pratique pédagogique à celle <strong>de</strong> recherche, mais <strong>de</strong><br />
saisir le terrain pédagogique en tant que prétexte permettant <strong>de</strong> nourrir <strong>de</strong>ux approches<br />
différenciées <strong>de</strong> la recherche architecturale, conceptuelle et fondamentale. Inédite moins tant<br />
sur sa formalisation que sur l’angle d’attaque retenu, celle <strong>de</strong>s figures <strong>du</strong> projet. Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s<br />
instruments et <strong>de</strong> démarches classiques indispensables (exploration <strong>de</strong> terrains, analyse <strong>de</strong>s<br />
formes, enquêtes et entretiens, workshops locaux et transnationaux...), le travail s’articule <strong>de</strong><br />
trois manières autour <strong>de</strong> la capacité d’attracteur propre aux figures <strong>du</strong> projet :<br />
• Les figures comme attracteurs actoriels, double néologisme restituant la manière dont,<br />
autour <strong>de</strong> termes-clés, se cristallisent <strong>de</strong>s processus, se différencient <strong>de</strong>s acteurs <strong>de</strong><br />
l’aménagement et <strong>du</strong> projet. Ainsi, <strong>de</strong>rrière <strong>de</strong>s figures en apparence compatibles d’un même<br />
espace telles que la « coulée verte » (espace naturel en voie <strong>de</strong> protection par la commune <strong>de</strong><br />
St Herblain) et la « forêt urbaine » (politique d’agglomération) se déploient <strong>de</strong>s réseaux<br />
d’acteurs et <strong>de</strong>s visées très différentes : affirmation d’une i<strong>de</strong>ntité pour une commune<br />
suburbaine, <strong>de</strong> la cohérence d’une entité supra-urbaine <strong>de</strong> l’autre, une différenciation par les<br />
figures dans l’analyse <strong>de</strong>s processus qui s’inscrit dans un renouvellement <strong>de</strong>s approches <strong>de</strong> la<br />
pratique urbanistique.<br />
xlvi