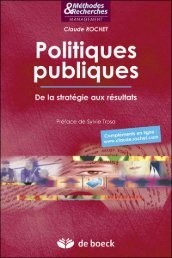Quelle place pour la puissance publique - Claude Rochet
Quelle place pour la puissance publique - Claude Rochet
Quelle place pour la puissance publique - Claude Rochet
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
IHESI – 14 ème SNE – 2002/2003 – GDS n° 1 : "Entreprises et intelligence économique –<br />
<strong>Quelle</strong> <strong>p<strong>la</strong>ce</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>puissance</strong> <strong>publique</strong> ?"<br />
opportunités technologiques 29 : si l’État américain est très protectionniste et<br />
interventionniste, il s’assure simultanément que les entreprises concernées n’abusent<br />
pas de <strong>la</strong> situation aux dépens des consommateurs et maintient <strong>la</strong> compétition qui est à<br />
<strong>la</strong> base de <strong>la</strong> dynamique de l’innovation. A l’opposé, l’État français a créé des marchés<br />
protégés <strong>pour</strong> ses industries nationales, ce qui a été fatal à son industrie informatique ou<br />
à des innovations majeures comme le minitel 30 , alors que de grands programmes<br />
nationaux menés avec intelligence lui ont assuré de pouvoir jouer dans <strong>la</strong> cour des<br />
grands. Brû<strong>la</strong>nt ce qu’il a adoré, il passe aujourd’hui à une ouverture des frontières<br />
imprudente, (confondant abandon de l’interventionnisme direct dans <strong>la</strong> gestion avec<br />
l’abandon tout court de toute intervention dans le cadrage stratégique et le façonnage<br />
des facteurs de compétitivité de l’économie nationale) en nous mettant en position de<br />
vulnérabilité vis-à-vis de nos compétiteurs.<br />
La politique de l’État en matière d’intelligence économique doit donc partir d’une<br />
compréhension des leviers non technologiques permettant de tirer profit des<br />
opportunités technologiques.<br />
Dans ce contexte, quel rôle doit jouer l’État, et quelles re<strong>la</strong>tions avec les entreprises<br />
doit-il entretenir <strong>pour</strong> assurer <strong>la</strong> compétitivité de l’économie française ? <strong>Quelle</strong>s sont ses<br />
pratiques actuelles, les schémas mentaux dominants et en quoi sont-ils adaptés ou<br />
inadaptés aux enjeux actuels ? Quels axes de progrès concrets doivent-ils s’avérer<br />
prioritaires ?<br />
L'intelligence économique, conçue dans un contexte de guerre économique,<br />
actuellement aggravé par les décisions de « boycott » des entreprises françaises prises<br />
par l’administration Bush comme sanction au non-alignement de <strong>la</strong> France sur les<br />
positions américaines lors de l’expédition militaire contre l’Irak, est donc non seulement<br />
une priorité nationale <strong>pour</strong> maintenir <strong>la</strong> France dans le peloton de tête de l’économie<br />
mondiale, mais également un levier de réforme de l’État, concernant autant sa <strong>p<strong>la</strong>ce</strong> au<br />
sein du cercle des <strong>puissance</strong>s que ses modes d’intervention. Avant de procéder à cette<br />
analyse, il convient toutefois de définir <strong>la</strong> <strong>puissance</strong> <strong>publique</strong>.<br />
La notion de <strong>puissance</strong> <strong>publique</strong><br />
Toute société développée s’identifie par une personne morale qui est à <strong>la</strong> source de <strong>la</strong><br />
légitimité des décisions : l’État. Cette légitimité induit un modèle hiérarchique. Une<br />
partie des membres du groupe détient une autorité plus ou moins étendue sur les autres<br />
personnes faisant partie de ce groupe et ayant <strong>la</strong> faculté d’imposer l’exécution de leurs<br />
ordres. Une exécution qui peut s’opérer par <strong>la</strong> contrainte si nécessaire. Mais cette partie<br />
ne détient cette capacité de coercition et ces prérogatives exorbitantes du droit commun,<br />
que parce qu’ils sont au service du bien commun et de l’intérêt général. De Thomas<br />
d’Aquin à Jean de Bodin 31 , les philosophes politiques ont enseigné aux souverains<br />
qu’ils ne devaient pas exercer leur pouvoir à leur profit mais à celui du bien commun.<br />
29<br />
Jacques Stern « L’Europe des occasions perdues », in Géopolitique, <strong>puissance</strong>, science et technologie,<br />
2000<br />
30<br />
Patrick Messerlin, chapitre « France », in « Technological innovation and economic performance »,<br />
Benn Steil, David Victor & Richard Ne lson, Princeton University Press, 2002<br />
31<br />
Jean de Bodin (1529-1596). Il a défini <strong>la</strong> notion de souveraineté dans sa « Ré<strong>publique</strong> ». Il établit une<br />
comparaison entre <strong>la</strong> Rome républicaine et <strong>la</strong> France royale. Il privilégie <strong>la</strong> théorie d’un État où le roi est<br />
le représentant du bien commun et le défenseur des droits de tous ses sujets.<br />
17