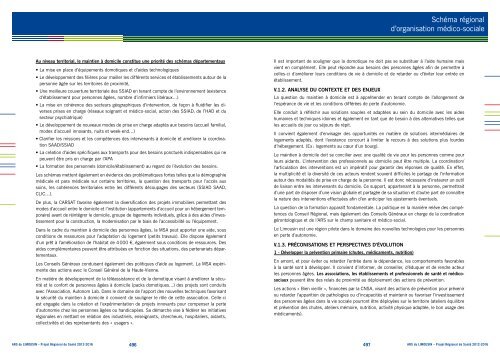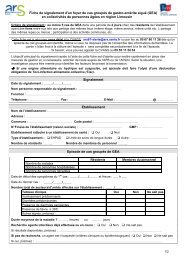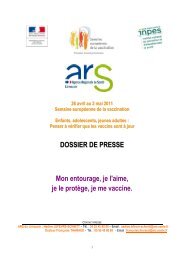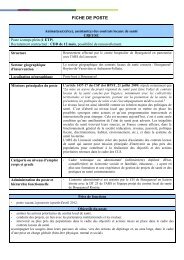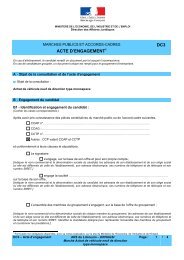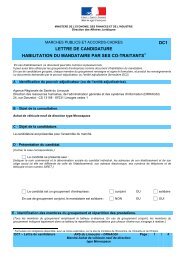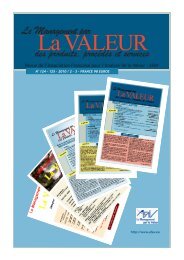Schéma régional d'organiSation médico-Sociale - ARS Limousin
Schéma régional d'organiSation médico-Sociale - ARS Limousin
Schéma régional d'organiSation médico-Sociale - ARS Limousin
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Schéma régionald’organisation médico-socialeAu niveau territorial, le maintien à domicile constitue une priorité des schémas départementaux• La mise en place d’équipements domotiques et d’aides technologiques• Le développement des filières pour mailler les différents services et établissements autour de lapersonne âgée sur les territoires de proximité,• Une meilleure couverture territoriale des SSIAD en tenant compte de l’environnement (existenced’établissement pour personnes âgées, nombre d’infirmiers libéraux…)• La mise en cohérence des secteurs géographiques d’intervention, de façon à fluidifier les diversesprises en charge (réseaux soignant et médico-social, action des SSIAD, de l’HAD et dusecteur psychiatrique)• Le développement de nouveaux modes de prise en charge adaptés aux besoins (accueil familial,modes d’accueil innovants, nuits et week-end…)• Clarifier les missions et les compétences des intervenants à domicile et améliorer la coordinationSAAD/SSIAD• La création d’aides spécifiques aux transports pour des besoins ponctuels indispensables qui nepeuvent être pris en charge par l’APA• La formation des personnels (domicile/établissement) au regard de l’évolution des besoins.Les schémas mettent également en évidence des problématiques fortes telles que la démographiemédicale et para médicale sur certains territoires, la question des transports pour l’accès auxsoins, les cohérences territoriales entre les différents découpages des secteurs (SSIAD SAAD,CLIC…).De plus, la C<strong>ARS</strong>AT favorise également la diversification des projets immobiliers permettant desmodes d’accueil entre le domicile et l’institution (appartements d’accueil pour un hébergement temporaire)avant de réintégrer le domicile, groupe de logements individuels, grâce à des aides d’investissementpour la construction, la modernisation par le biais de l’accessibilité ou l’équipement.Dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées, la MSA peut apporter une aide, sousconditions de ressources pour l’adaptation du logement (petits travaux). Elle dispose égalementd’un prêt à l’amélioration de l’habitat de 4 000 €, également sous conditions de ressources. Desaides complémentaires peuvent être attribuées en fonction des situations, des partenariats départementaux.Les Conseils Généraux conduisent également des politiques d’aide au logement. La MSA expérimentedes actions avec le Conseil Général de la Haute-Vienne.En matière de développement de la téléassistance et de la domotique visant à améliorer la sécuritéet le confort de personnes âgées à domicile (packs domotiques…) des projets sont conduitsavec l’Association, Autonom Lab. Dans le domaine de l’apport des nouvelles techniques favorisantla sécurité du maintien à domicile il convient de souligner le rôle de cette association. Celle-ciest engagée dans la création et l’expérimentation de projets innovants pour compenser la perted’autonomie chez les personnes âgées ou handicapées. Sa démarche vise à fédérer les initiativesrégionales en mettant en relation des industriels, enseignants, chercheurs, hospitaliers, aidants,collectivités et des représentants des « usagers ».Il est important de souligner que la domotique ne doit pas se substituer à l’aide humaine maisvient en complément. Elle peut répondre aux besoins des personnes âgées afin de permettre àcelles-ci d’améliorer leurs conditions de vie à domicile et de retarder ou d’éviter leur entrée enétablissement.V.1.2. ANALYSE DU CONTEXTE ET DES ENJEUXLa question du maintien à domicile est à appréhender en tenant compte de l’allongement del’espérance de vie et les conditions différées de perte d’autonomie.Elle conduit à réfléchir aux solutions souples et adaptées au sein du domicile avec les aideshumaines et techniques idoines et également en tant que de besoin à des alternatives telles queles accueils de jour ou séjours de répit.Il convient également d’envisager des opportunités en matière de solutions intermédiaires delogements adaptés, dont l’existence concourt à limiter le recours à des solutions plus lourdesd’hébergement. (Ex : logements au cœur d’un bourg).Le maintien à domicile doit se concilier avec une qualité de vie pour les personnes comme pourleurs aidants. L’intervention des professionnels au domicile peut être multiple. La coordination/l’articulation des interventions est un impératif pour garantir des réponses de qualité. En effet,la multiplicité et la diversité de ces acteurs rendent souvent difficiles le partage de l’informationautour des modalités de prise en charge de la personne. Il est donc nécessaire d’instaurer un outilde liaison entre les intervenants du domicile. Ce support, appartenant à la personne, permettraitd’une part de disposer d’une vision globale et partagée de sa situation et d’autre part de connaîtrela nature des interventions effectuées afin d’en anticiper les ajustements éventuels.La question de la formation apparaît fondamentale. La politique en la manière relève des compétencesdu Conseil Régional, mais également des Conseils Généraux en charge de la coordinationgérontologique et de l’<strong>ARS</strong> sur le champ sanitaire et médico-social.Le <strong>Limousin</strong> est une région pilote dans le domaine des nouvelles technologies pour les personnesen perte d’autonomie.V.1.3. PRÉCONISATIONS ET PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION1 - Développer la prévention primaire (chutes, médicaments, nutrition)En amont, et pour éviter ou retarder l’entrée dans la dépendance, les comportements favorablesà la santé sont à développer. Il convient d’informer, de conseiller, d’éduquer et de rendre acteurles personnes âgées. Les associations, les établissements et professionnels de santé et médicosociauxpeuvent être des relais de proximité au déploiement des actions de prévention.Les actions « Bien vieillir », financées par la CNSA, visant des actions de prévention pour prévenirou retarder l’apparition de pathologies ou d’incapacités et maintenir ou favoriser l’investissementdes personnes âgées dans la vie sociale pourront être déployées sur le territoire (ateliers équilibreet prévention des chutes, ateliers mémoire, nutrition, activité physique adaptée, le bon usage desmédicaments).<strong>ARS</strong> du LIMOUSIN – Projet Régional de Santé 2012-2016 496 497<strong>ARS</strong> du LIMOUSIN – Projet Régional de Santé 2012-2016