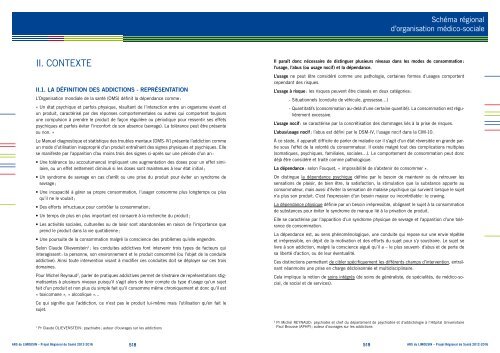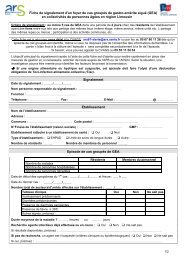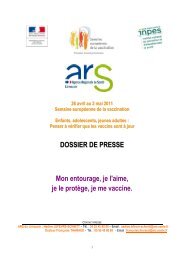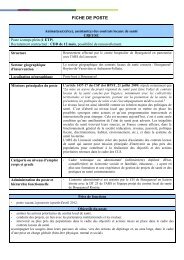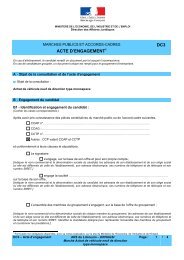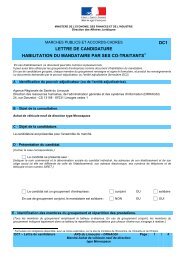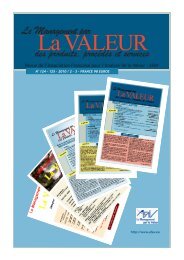Schéma régional d'organiSation médico-Sociale - ARS Limousin
Schéma régional d'organiSation médico-Sociale - ARS Limousin
Schéma régional d'organiSation médico-Sociale - ARS Limousin
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Schéma régionald’organisation médico-socialeII. CONTEXTEII.1. LA DÉFINITION DES ADDICTIONS - REPRÉSENTATIONL’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la dépendance comme :« Un état psychique et parfois physique, résultant de l’interaction entre un organisme vivant etun produit, caractérisé par des réponses comportementales ou autres qui comportent toujoursune compulsion à prendre le produit de façon régulière ou périodique pour ressentir ses effetspsychiques et parfois éviter l’inconfort de son absence (sevrage). La tolérance peut être présenteou non. »Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DMS-IV) présente l’addiction commeun mode d’utilisation inapproprié d’un produit entraînant des signes physiques et psychiques. Ellese manifeste par l’apparition d’au moins trois des signes ci-après sur une période d’un an :• Une tolérance (ou accoutumance) impliquant une augmentation des doses pour un effet similaire,ou un effet nettement diminué si les doses sont maintenues à leur état initial ;• Un syndrome de sevrage en cas d’arrêt ou une prise du produit pour éviter un syndrome desevrage ;• Une incapacité à gérer sa propre consommation, l’usager consomme plus longtemps ou plusqu’il ne le voulait ;• Des efforts infructueux pour contrôler la consommation ;• Un temps de plus en plus important est consacré à la recherche du produit ;• Les activités sociales, culturelles ou de loisir sont abandonnées en raison de l’importance queprend le produit dans la vie quotidienne ;• Une poursuite de la consommation malgré la conscience des problèmes qu’elle engendre.Selon Claude Olievenstein 1 : les conduites addictives font intervenir trois types de facteurs quiinteragissent : la personne, son environnement et le produit consommé (ou l’objet de la conduiteaddictive). Ainsi toute intervention visant à modifier ces conduites doit se déployer sur ces troisdomaines.Pour Michel Reynaud 2 , parler de pratiques addictives permet de s’extraire de représentations stigmatisantesà plusieurs niveaux puisqu’il s’agit alors de tenir compte du type d’usage qu’un sujetfait d’un produit et non plus du simple fait qu’il consomme même chroniquement et donc qu’il est« toxicomane », « alcoolique »…Ce qui signifie que l’addiction, ce n’est pas le produit lui-même mais l’utilisation qu’en fait lesujet.Il paraît donc nécessaire de distinguer plusieurs niveaux dans les modes de consommation :l’usage, l’abus (ou usage nocif) et la dépendance.L’usage ne peut être considéré comme une pathologie, certaines formes d’usages comportentcependant des risques.L’usage à risque : les risques peuvent être classés en deux catégories :- Situationnels (conduite de véhicule, grossesse…)- Quantitatifs (consommation au-delà d’une certaine quantité). La consommation est régulièrementexcessive.L’usage nocif : se caractérise par la concrétisation des dommages liés à la prise de risques.L’abus/usage nocif : l’abus est défini par le DSM-IV, l’usage nocif dans la CIM-10.À ce stade, il apparaît difficile de parler de maladie car il s’agit d’un état réversible en grande partiesous l’effet de la volonté du consommateur. Il existe malgré tout des complications multiples(somatiques, psychiques, familiales, sociales…). Le comportement de consommation peut doncdéjà être considéré et traité comme pathologique.La dépendance : selon Fouquet, « impossibilité de s’abstenir de consommer ».On distingue la dépendance psychique définie par le besoin de maintenir ou de retrouver lessensations de plaisir, de bien être, la satisfaction, la stimulation que la substance apporte auconsommateur, mais aussi d’éviter la sensation de malaise psychique qui survient lorsque le sujetn’a plus son produit. C’est l’expression d’un besoin majeur ou incontrôlable : le craving.La dépendance physique définie par un besoin irrépressible, obligeant le sujet à la consommationde substances pour éviter le syndrome de manque lié à la privation de produit.Elle se caractérise par l’apparition d’un syndrome physique de sevrage et l’apparition d’une tolérancede consommation.La dépendance est, au sens phénoménologique, une conduite qui repose sur une envie répétéeet irrépressible, en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s’y soustraire. Le sujet selivre à son addiction, malgré la conscience aiguë qu’il a – le plus souvent- d’abus et de perte desa liberté d’action, ou de leur éventualité.Ces distinctions permettent de cibler spécifiquement les différents champs d’intervention, entraînantnéanmoins une prise en charge décloisonnée et multidisciplinaire.Cela implique la notion de soins intégrés (de soins de généraliste, de spécialités, de médico-social,de social et de services).1Pr Claude OLIEVENSTEIN : psychiatre ; auteur d’ouvrages sur les addictions2Pr Michel REYNAUD : psychiatre et chef du département de psychiatrie et d’addictologie à l’Hôpital UniversitairePaul Brousse (APHP) ; auteur d’ouvrages sur les addictions<strong>ARS</strong> du LIMOUSIN – Projet Régional de Santé 2012-2016 518 519<strong>ARS</strong> du LIMOUSIN – Projet Régional de Santé 2012-2016