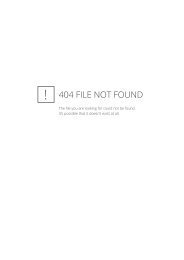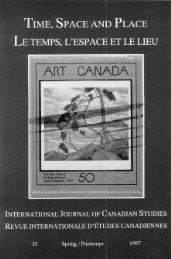Arts and Literature in Canada:Views from Abroad, Les arts et la ...
Arts and Literature in Canada:Views from Abroad, Les arts et la ...
Arts and Literature in Canada:Views from Abroad, Les arts et la ...
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Les</strong> autochtones dans <strong>la</strong> chanson canadienne-françaiseLa facture musicale peut tout d’abord tromper sur le contenu de <strong>la</strong> chanson.L’entraînante mesure à quatre temps, l’accord parfait ascendant du coupl<strong>et</strong> quise répète dans <strong>la</strong> première partie du très long refra<strong>in</strong> <strong>et</strong> l’orchestration qui, dèsle court prélude, ne <strong>la</strong>isse s’élever aucune sentimentalité : l’histoire de l’Indien<strong>et</strong> de sa Mariouche b<strong>la</strong>nche est <strong>in</strong>corporée à de solides structures musicales.L’amour réciproque, le cloître, le suicide du jeune homme <strong>et</strong> le r<strong>et</strong>our de <strong>la</strong>Mariouche dans <strong>la</strong> communauté vil<strong>la</strong>geoise donnent l’impression d’un « faitdivers » raconté à <strong>la</strong> hâte; <strong>et</strong> ce n’est qu’en écoutant très attentivement que l’ondécouvre — dans <strong>la</strong> deuxième partie du refra<strong>in</strong> — une touche plus émouvante,plus <strong>in</strong>time : l’accompagnement recule, <strong>la</strong> voix de <strong>la</strong> civilisation fait p<strong>la</strong>ce àcelle de <strong>la</strong> nature; les canards sauvages, les perdrix <strong>et</strong> les sarcelles répètent lenom de Jack <strong>et</strong> le vent murmure « Monoloy » avant que le dernier vers, trèssc<strong>and</strong>é, « La Mariouche est pour un b<strong>la</strong>nc », ne m<strong>et</strong>te le po<strong>in</strong>t f<strong>in</strong>al.« Monoloy », monologue, « une loi », de nombreuses spécu<strong>la</strong>tions, denombreux jeux de mots peuvent être établis sur ce nom. 17 Le fait est,cependant, que reste un droit du plus fort de même que dom<strong>in</strong>e un modemusical. Le fait est aussi qu’aucun dialogue n’a lieu. Le p<strong>et</strong>it <strong>in</strong>terlude lyriquedu refra<strong>in</strong> tourne sur soi, il est son propre écho <strong>et</strong> demeure sans réponse dans lemonde des « B<strong>la</strong>ncs » qui, de son côté, est présent dans d’<strong>in</strong>nombrables /b/ <strong>et</strong>/d/ comme « b<strong>la</strong>nc » <strong>et</strong> « dest<strong>in</strong> ». 18 La communauté des B<strong>la</strong>ncs est représentéepar les parents, un « on » observateur qui suit les amoureux, <strong>et</strong> par l’Église,particulièrement ambivalente : c’est elle qui « tous les dimanches » célèbrel’amour div<strong>in</strong>, qui, justement, ces dimanches-là, réunit les deux amoureux <strong>et</strong>qui, f<strong>in</strong>alement, détruit l’amour <strong>et</strong> <strong>la</strong> vie huma<strong>in</strong>e. « Jack Monoloy, Dieu aitson âme », ce<strong>la</strong> est dit très ironiquement; « <strong>la</strong> Mariouche », cependant, sesoum<strong>et</strong> à <strong>la</strong> loi.Si « Jack Monoloy » semble donc montrer qu’il existe un droit du plus fort, quele B<strong>la</strong>nc refuse l’égalité à l’Indien <strong>et</strong> que, dans le texte au mo<strong>in</strong>s, <strong>la</strong> m<strong>in</strong>oritéautochtone n’est présente que comme <strong>in</strong>dividu isolé qui sc<strong>and</strong>alise, <strong>la</strong> chansondit aussi que <strong>la</strong> partie opprimée est en fait <strong>la</strong> partie « vivante » à proprementparler. L’Indien, que Vigneault décrit jeune <strong>et</strong> « fr<strong>in</strong>gant », a <strong>la</strong> nature commecomplice, une nature ple<strong>in</strong>e de vie qui parle <strong>et</strong> rayonne <strong>et</strong> dans <strong>la</strong>quelle ils’enfonce avec sa mort pour cont<strong>in</strong>uer, en elle, à observer les nuages. Car, dans<strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue symbolique de Vigneault, ce sont les nuages parmi toutes les« manières d’eau » qui perm<strong>et</strong>tent au mieux à l’homme de connaître savérité. 19 Le monde de <strong>la</strong> civilisation, par contre, a <strong>la</strong>issé passer c<strong>et</strong>te chance.Comment se fait-il donc que Vigneault soit un des premiers à se tourner vers lemonde — ou mieux le « non-monde » — <strong>in</strong>dien ? Vigneault parled’expérience :Comme Montréal, Natashquan a une réserve <strong>in</strong>dienne. Qu<strong>and</strong> ilsentraient dans nos maisons, les Montagnais n’étaient pas <strong>in</strong>vités ausalon sans escale. Ils restaient debout, à <strong>la</strong> porte. S’ils dem<strong>and</strong>aient àboire, on leur donnait à boire. Après, on <strong>la</strong>vait le verre à131