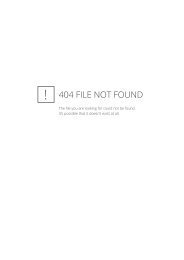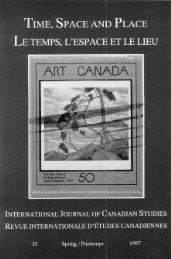Arts and Literature in Canada:Views from Abroad, Les arts et la ...
Arts and Literature in Canada:Views from Abroad, Les arts et la ...
Arts and Literature in Canada:Views from Abroad, Les arts et la ...
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’essai littéraire au Québecétat polymorphe associé à <strong>la</strong> régression, voire à l’homosexualité : « Après tout,le Québec n’est-il pas déjà une sorte de pays « gay », où non seulement leslimites entre les gens ne sont pas bien marquées, <strong>et</strong> pas bien difficiles à sauter,mais sont même une chose presque répréhensible en soi ? Oui, chez nous, il estmal vu de marquer <strong>la</strong> limite entre soi-même <strong>et</strong> les autres! Parlons-en, del’<strong>in</strong>dépendance .. » (227).Ce personnage outré dans l’Épilogue du livre ne poursuit que sous une formeextravagante une argumentation avancée par Larose depuis son premier livre,Le Mythe de Nelligan (Montréal, Boréal, 1981), où c<strong>et</strong>te « déficience virile »figure l’impossibilité des Québécois à résoudre leur problématique nationale.Or, c<strong>et</strong>te conscription d’une prétendue déficience psychosexuelle pour« expliquer » un blocage politique me semble non seulement douteuse (biensûr, je ne <strong>la</strong> littéralise po<strong>in</strong>t, mais l’accepte en toute sa métaphoricité), mais<strong>in</strong>quiétante dans sa capacité, comme toute métaphore, de <strong>la</strong>isser à entendre soncontraire; à savoir que <strong>la</strong> résolution de <strong>la</strong> question nationale serait plutôtsouhaitée en tant que condition préa<strong>la</strong>ble à <strong>la</strong> disparition d’une problématiquedes sexualités « déviantes », comme si celles-ci verraient leur « base » socialedisparaître à <strong>la</strong> suite d’une éventuelle émancipation nationale! Après tout, plusd’une société « post-coloniale » a déjà prétendu autant! De toute façon, <strong>la</strong>négociation des questions de sexualité dans ce recueil semble s’appuyer àl’occasion sur des notions qui ne sont pas <strong>in</strong>terrogées depuis trop longtemps.L’<strong>in</strong>clusion d’un essai comme « L’Image f<strong>in</strong>ale : fém<strong>in</strong>isme <strong>et</strong> vérité chezFriedrich Schlegel », publié pour <strong>la</strong> première fois il y a dix ans, mais présenté<strong>in</strong>évitablement ici sous le signe d’une certa<strong>in</strong>e actualité, s’en prend à unfém<strong>in</strong>isme déjà reconnu dans son historicité <strong>et</strong> en tant qu’acquis. Le débatactuel dans le champ fém<strong>in</strong>iste (<strong>et</strong> dans ce qu’on appelle les « gender studies »dans le monde universitaire anglophone, par exemple) dépasse de lo<strong>in</strong> cesobjections anti essentialistes. Dommage... <strong>et</strong> danger des recueils... !Beaudo<strong>in</strong>, Marcotte, Larose: tous soulèvent le problème de <strong>la</strong> restitution de <strong>la</strong>spécificité du littéraire. Ce problème soustend également Le Romanmémoriel : de l’histoire à l’écriture du hors-lieu de Rég<strong>in</strong>e Rob<strong>in</strong>. Historiennedes enjeux identitaires <strong>et</strong> surtout de leurs manifestations à travers les débatsl<strong>in</strong>guistiques <strong>et</strong> littéraires, Rob<strong>in</strong> r<strong>et</strong>race ici son « it<strong>in</strong>éraire mémoriel » quil’amènera à proposer une « histoire-fiction » qui saura satisfaire à c<strong>et</strong>tecondition <strong>in</strong>contournable de <strong>la</strong> postmodernité, à savoir « le clivage du suj<strong>et</strong>,une parole hétérogène qui ne soit pas une parole provenant d’un suj<strong>et</strong>souvera<strong>in</strong>, d’un suj<strong>et</strong> qui puisse se situer de toutes sortes de façons par rapportà sa <strong>la</strong>ngue <strong>et</strong> à ses <strong>la</strong>ngues » (170). Pour elle, « l’hétérogène <strong>la</strong>ngagier traversele texte littéraire sur une bordure, une frontière... [il] est <strong>la</strong> figure métatextuelledu « littéraire » (171). Le roman sera le lieu privilégié d’une <strong>in</strong>ter<strong>la</strong>ngue quipourra restituer au suj<strong>et</strong> une profondeur <strong>et</strong> une densité de mémoire face auludisme qui caractérise <strong>la</strong> culture médiatique de notre époque, où les signes nerenvoient qu’à eux-mêmes dans une espèce de pseudo-<strong>in</strong>tertextualité.Parallèlement, le caractère lim<strong>in</strong>aire de c<strong>et</strong>te <strong>in</strong>ter<strong>la</strong>ngue, a<strong>in</strong>si que sa re<strong>la</strong>tiond’<strong>in</strong>quiétante étrang<strong>et</strong>é au code l<strong>in</strong>guistique de <strong>la</strong> communauté font d’elle tout167