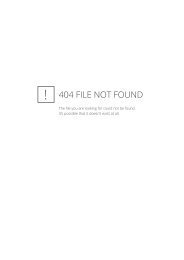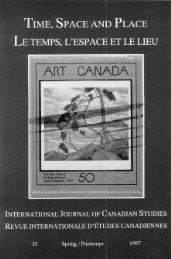Arts and Literature in Canada:Views from Abroad, Les arts et la ...
Arts and Literature in Canada:Views from Abroad, Les arts et la ...
Arts and Literature in Canada:Views from Abroad, Les arts et la ...
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
IJCS/RIÉCmétropole d’autant plus présente que <strong>la</strong> rupture fut violente, n’aura purencontrer c<strong>et</strong>te dérive cosmopolite » (74).À vrai dire, l’apport de Harel n’est pas tant de constater c<strong>et</strong>te ambivalence ni de<strong>la</strong> p<strong>la</strong><strong>in</strong>dre, mais plutôt de l’<strong>in</strong>terpréter à travers une série d’analyses fortorig<strong>in</strong>ales <strong>et</strong> productrices des moments clefs de <strong>la</strong> production littérairequébécoise. Étant donné l’urbanisation re<strong>la</strong>tivement tardive des Québécoiseux-mêmes, ce qu’offre <strong>la</strong> ville à toute les dynamiques psychiques relevant de<strong>la</strong> condensation, de <strong>la</strong> projection <strong>et</strong> du doublement se trouve renforcé dans lecontexte montréa<strong>la</strong>is, où l’<strong>in</strong>digène est surtout apte à rencontrer sa propreétrang<strong>et</strong>é dans les yeux de l’Autre. <strong>Les</strong> sources méthodologiques de Harel sontvastes <strong>et</strong> maîtrisées, mais c’est surtout l’appropriation kristévienne de ce queFreud propose au suj<strong>et</strong> de l’<strong>in</strong>quiétante étrang<strong>et</strong>é qui lui donne son support leplus riche. Ce<strong>la</strong> est particulièrement le cas dans l’excellent chapitre consacré à<strong>la</strong> littérature partipriste, où le vol<strong>et</strong> primitiviste du discours décolonisateur <strong>et</strong>« sa redécouverte de l’identité entrevue comme orig<strong>in</strong>aire » se heurte à c<strong>et</strong>teprésence « étrangère » qui semble symboliser tout ce qui est aliénant dans <strong>la</strong>métropole <strong>et</strong> qui appartient « aux autres»:« L’étranger est dans <strong>la</strong> plupart de cestextes une figure <strong>in</strong>tériorisée, associée à un discours aliénant (<strong>la</strong> parole de l’Autre)qui fait du suj<strong>et</strong> un être étranger à soi » (124). La littérature partipriste tend àproposer comme résolution « [<strong>la</strong>] fondation du nom propre « Québécois »,l’exercice d’une catharsis qui, après <strong>la</strong> purgation des passions, perm<strong>et</strong> der<strong>et</strong>rouver un Moi non altéré » (125). Également éc<strong>la</strong>irantes sont les analysesdes ouvrages de dép<strong>la</strong>cement, surtout ceux qui témoigneraient récemment del’« américanité » de <strong>la</strong> littérature québécoise. Si l’on peut bien se rendreétranger pour « se chercher », pour se donner de l’espace vis-à-vis d’unquotidien enf<strong>in</strong> c<strong>la</strong>ustrophobe, il faut se dem<strong>and</strong>er pourquoi tant deprotagonistes f<strong>in</strong>issent par ré<strong>in</strong>tégrer <strong>la</strong> communauté nationale. Pour Harel, <strong>la</strong>véritable quête dans bien de ces romans est ailleurs; dans Une histoireamérica<strong>in</strong>e de Jacques Godbout, par exemple, « [<strong>la</strong>] dérive californienneperm<strong>et</strong> de situer une <strong>in</strong>terrogation sur l’étranger, mais par le biais d’unedistance territoriale qui fait du Québec un lieu malgré tout préservé » (202). Onappréciera surtout l’analyse de French Kiss de Nicole Brossard, qui nousapporte une élucidation orig<strong>in</strong>ale de <strong>la</strong> façon dont <strong>la</strong> modernité du texte peut seconjuguer au proj<strong>et</strong> de l’écriture au fém<strong>in</strong><strong>in</strong>. Peut-être offre-t-elle l’une desréponses les plus créatrices au défi posé par l’hétérogène : déborder lemorcellement en quartiers de <strong>la</strong> ville, à <strong>la</strong> fois rassurant <strong>et</strong> <strong>in</strong>quiétant dans sasubstantialisation de <strong>la</strong> Différence, tout en avouant le caractère utopique d’unparcours éternel qui n’aboutira que dans un non-lieu empêchant touteénonciation subjective. « La ville est analogue à un corps <strong>et</strong> le parcours estsemb<strong>la</strong>ble à une jouissance. Mais ce corps, même s’il est dispersé, doit offrirprise à <strong>la</strong> lecture, à l’<strong>in</strong>terprétation. Le refus de l’emprise cartographique, dudispositif panoptique, est partiel... La totalisation panoptique est rej<strong>et</strong>ée auprofit de <strong>la</strong> mise en scène de surfaces diverses (de <strong>la</strong> peau à <strong>la</strong> pupille) qui nesont, en déf<strong>in</strong>itive, pas tant des lieux d’<strong>in</strong>scription ou de sédimentation du sensque de sa modification » (251, 253, 254).170