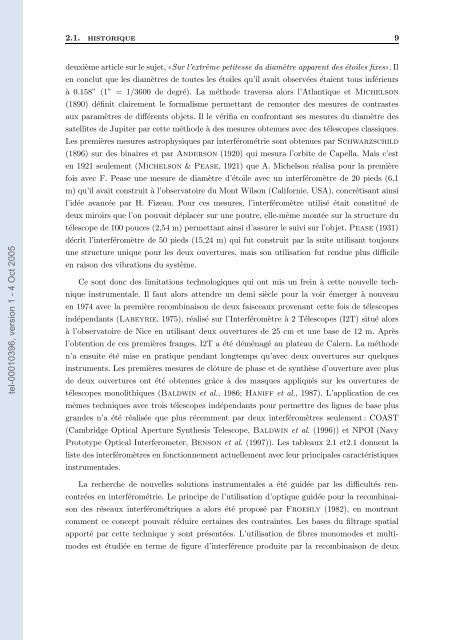Qualification de IONIC, instrument de recombinaison ...
Qualification de IONIC, instrument de recombinaison ...
Qualification de IONIC, instrument de recombinaison ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
tel-00010396, version 1 - 4 Oct 2005<br />
2.1. HISTORIQUE 9<br />
<strong>de</strong>uxième article sur le sujet, ✭Sur l’extrême petitesse du diamètre apparent <strong>de</strong>s étoiles fixes ✮. Il<br />
en conclut que les diamètres <strong>de</strong> toutes les étoiles qu’il avait observées étaient tous inférieurs<br />
à 0.158” (1” = 1/3600 <strong>de</strong> <strong>de</strong>gré). La métho<strong>de</strong> traversa alors l’Atlantique et Michelson<br />
(1890) définit clairement le formalisme permettant <strong>de</strong> remonter <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> contrastes<br />
aux paramètres <strong>de</strong> différents objets. Il le vérifia en confrontant ses mesures du diamètre <strong>de</strong>s<br />
satellites <strong>de</strong> Jupiter par cette métho<strong>de</strong> à <strong>de</strong>s mesures obtenues avec <strong>de</strong>s télescopes classiques.<br />
Les premières mesures astrophysiques par interférométrie sont obtenues par Schwarzschild<br />
(1896) sur <strong>de</strong>s binaires et par An<strong>de</strong>rson (1920) qui mesura l’orbite <strong>de</strong> Capella. Mais c’est<br />
en 1921 seulement (Michelson & Pease, 1921) que A. Michelson réalisa pour la première<br />
fois avec F. Pease une mesure <strong>de</strong> diamètre d’étoile avec un interféromètre <strong>de</strong> 20 pieds (6,1<br />
m) qu’il avait construit à l’observatoire du Mont Wilson (Californie, USA), concrétisant ainsi<br />
l’idée avancée par H. Fizeau. Pour ces mesures, l’interféromètre utilisé était constitué <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ux miroirs que l’on pouvait déplacer sur une poutre, elle-même montée sur la structure du<br />
télescope <strong>de</strong> 100 pouces (2,54 m) permettant ainsi d’assurer le suivi sur l’objet. Pease (1931)<br />
décrit l’interféromètre <strong>de</strong> 50 pieds (15,24 m) qui fut construit par la suite utilisant toujours<br />
une structure unique pour les <strong>de</strong>ux ouvertures, mais son utilisation fut rendue plus difficile<br />
en raison <strong>de</strong>s vibrations du système.<br />
Ce sont donc <strong>de</strong>s limitations technologiques qui ont mis un frein à cette nouvelle tech-<br />
nique <strong>instrument</strong>ale. Il faut alors attendre un <strong>de</strong>mi siècle pour la voir émerger à nouveau<br />
en 1974 avec la première <strong>recombinaison</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux faisceaux provenant cette fois <strong>de</strong> télescopes<br />
indépendants (Labeyrie, 1975), réalisé sur l’Interféromètre à 2 Télescopes (I2T) situé alors<br />
à l’observatoire <strong>de</strong> Nice en utilisant <strong>de</strong>ux ouvertures <strong>de</strong> 25 cm et une base <strong>de</strong> 12 m. Après<br />
l’obtention <strong>de</strong> ces premières franges, I2T a été déménagé au plateau <strong>de</strong> Calern. La métho<strong>de</strong><br />
n’a ensuite été mise en pratique pendant longtemps qu’avec <strong>de</strong>ux ouvertures sur quelques<br />
<strong>instrument</strong>s. Les premières mesures <strong>de</strong> clôture <strong>de</strong> phase et <strong>de</strong> synthèse d’ouverture avec plus<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ouvertures ont été obtenues grâce à <strong>de</strong>s masques appliqués sur les ouvertures <strong>de</strong><br />
télescopes monolithiques (Baldwin et al., 1986; Haniff et al., 1987). L’application <strong>de</strong> ces<br />
mêmes techniques avec trois télescopes indépendants pour permettre <strong>de</strong>s lignes <strong>de</strong> base plus<br />
gran<strong>de</strong>s n’a été réalisée que plus récemment par <strong>de</strong>ux interféromètres seulement : COAST<br />
(Cambridge Optical Aperture Synthesis Telescope, Baldwin et al. (1996)) et NPOI (Navy<br />
Prototype Optical Interferometer, Benson et al. (1997)). Les tableaux 2.1 et2.1 donnent la<br />
liste <strong>de</strong>s interféromètres en fonctionnement actuellement avec leur principales caractéristiques<br />
<strong>instrument</strong>ales.<br />
La recherche <strong>de</strong> nouvelles solutions <strong>instrument</strong>ales a été guidée par les difficultés ren-<br />
contrées en interférométrie. Le principe <strong>de</strong> l’utilisation d’optique guidée pour la recombinai-<br />
son <strong>de</strong>s réseaux interférométriques a alors été proposé par Froehly (1982), en montrant<br />
comment ce concept pouvait réduire certaines <strong>de</strong>s contraintes. Les bases du filtrage spatial<br />
apporté par cette technique y sont présentées. L’utilisation <strong>de</strong> fibres monomo<strong>de</strong>s et multi-<br />
mo<strong>de</strong>s est étudiée en terme <strong>de</strong> figure d’interférence produite par la <strong>recombinaison</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux