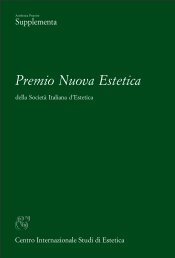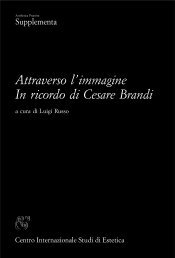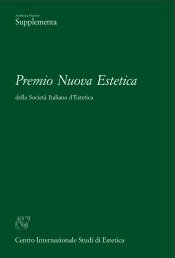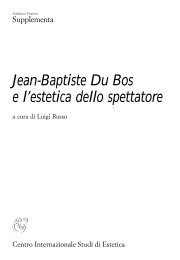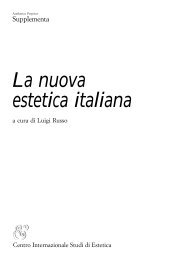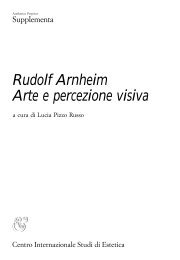Guido Morpurgo-Tagliabue e l'estetica del Settecento - SIE - Società ...
Guido Morpurgo-Tagliabue e l'estetica del Settecento - SIE - Società ...
Guido Morpurgo-Tagliabue e l'estetica del Settecento - SIE - Società ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Mais le problème est de ne pas se laisser enfermer dans l’empirieet de remonter au transcendantal pour concevoir le sublime comme lacondition de possibilité de l’expérience esthétique et de l’expériencetout court. Il importe alors de modifier notre conception du transcendantal:de ne plus le concevoir comme anhistorique, mais de le placerà la fois dans l’histoire générale et dans l’histoire singulière de chacund’entre nous. Le transcendantal est un savoir qui nous tisse, tout ennous restant plus ou moins fermé. C’est dire qu’il ne passe que partiellementet souvent après-coup dans le registre de la connaissance 12 .Hypothèse donc, mais hypothèse heuristique, obligeant à saisir la singularitédes manifestations du sublime chez certains auteurs ou à certainesépoques déterminées en fonction d’un pràttein non seulementartistique, mais esthétique.1L’Esthétique contemporaine, § 145, début et note 8, trad. fr. par Marcelle BourretteSerre, Marzorati, Milano, 1960.2Demetrius On style, Cambridge Univ. Press, 1902. Voir P. Chiron, Du Style, Les BellesLettres, Paris, 1993, et Giovanni Lombardo, Lo Stile, Aesthetica, Palermo, 1999.3Du sublime, XXXV, 5.4Mes pensées, 1720-1755, XII, 446, édition de Daniel Oster, Seuil, Paris, p. 902. Soulignépar moi.5Observations sur le sentiment du beau et du sublime, trad. Kempf, Vrin, Paris, 1969, p.39.6Ibid., p. 41.7«Remarque générale sur l’exposition des jugements esthétiques réfléchissants», FMV,p. 117, cf. traduction Philonenko, Vrin, Paris, p. 107.8Le Chant du monde, 1934.9De Trinitate, V, 7.10Investigations philosophiques, § 182. Voir le commentaire de Patrice Loraux, «Lesopérations en peut-être», Wittgenstein et la philosophie d’aujourd’hui, textes présentés parJean Sebestik et Antonia Soulez, Méridiens Klincksieck, Paris, 1992.11G. Charbonnier, Le Monologue du peintre, Paris 1959, pp. 143-45, cité par Merleau-Ponty dans L’Œil et l’esprit, p. 3112Cette distinction entre savoir et connaissance est d’origine freudienne et lacanienne.Voir Jacques Lacan, L’Envers de la psychanalyse, 1967-68, Le Séminaire, livre XVII, Seuil,Paris, 1991.101