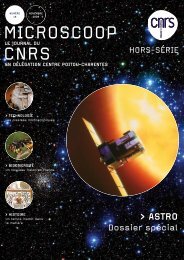Étude des propriétés hydriques et des mécanismes d ... - sacre
Étude des propriétés hydriques et des mécanismes d ... - sacre
Étude des propriétés hydriques et des mécanismes d ... - sacre
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Chapitre 3 : Etude <strong>des</strong> <strong>propriétés</strong> <strong>hydriques</strong><br />
de la masse imbibée qui se stabilise quand le degré de saturation atteint la valeur autorisée par la<br />
géométrie du réseau poreux. Ceci est manifeste dans le cas de la pierre de Sébastopol en considération<br />
de sa cinétique d’imbibition particulièrement élevée. Et de plus, <strong>des</strong> mesures sans coupure avec<br />
l’alimentation en eau ont confirmé c<strong>et</strong>te explication car dans ce cas, la saturation massique correspond<br />
à peu près à la saturation visuelle. Néanmoins, dans le cas du tuffeau blanc, la masse imbibée<br />
augmente toujours après l’arrivée du front capillaire au somm<strong>et</strong> de l’éprouv<strong>et</strong>te même pour les<br />
mesures avec alimentation en eau continue. Le décalage entre saturations visuelle <strong>et</strong> massique n’est<br />
donc pas dû à c<strong>et</strong> artefact de mesure, mais à un autre phénomène.<br />
2.1.1.b. Profil de teneur en eau durant l’imbibition<br />
Afin de connaître la répartition de l’eau lors de l’imbibition capillaire, <strong>des</strong> mesures du profil de<br />
teneur en eau ont été réalisées. La méthode utilisée est celle dite <strong>des</strong> "crayons" (Chéné, 1999a) : pour<br />
les deux pierres, un prisme de 12 cm de hauteur <strong>et</strong> de faible section (1 cm × 2 cm) est découpé. Tous<br />
les cinq millimètres, une rainure entourant la section de l’éprouv<strong>et</strong>te est réalisée afin de favoriser un<br />
prélèvement rapide <strong>des</strong> coupes d’échantillonnage. Les prismes ainsi préparés subissent une imbibition<br />
sous coupure de l’alimentation en eau. Quand le front capillaire atteint une hauteur de 8 cm, les<br />
prismes sont récupérés <strong>et</strong> sectionnés tous les cinq millimètres. Le volume de prélèvement avoisine 1<br />
cm 3 , ce qui suffisant pour être représentatif <strong>des</strong> matériaux. Les échantillons ainsi récoltés sont ensuite<br />
pesés très rapidement. Après passage à l’étuve à 105°C, la teneur en eau à différentes cotes du prisme<br />
subissant une imbibition capillaire est ainsi mesurée. Le profil de teneur en eau durant une imbibition<br />
capillaire est donc déterminé pour le tuffeau blanc <strong>et</strong> la pierre de Sébastopol, <strong>et</strong> les résultats sont<br />
illustrés à la figure III.8.<br />
Les mesures confirment que la zone en-<strong>des</strong>sous du front capillaire possède un degré de saturation<br />
proche de la valeur correspondant au remplissage de la porosité capillaire (80 % pour le tuffeau blanc<br />
<strong>et</strong> 70 % pour la pierre de Sébastopol). Le profil de teneur en eau durant l’imbibition est à peu près le<br />
même pour les deux pierres, c’est à dire que la teneur en eau n’est pas rigoureusement constante<br />
jusqu’au niveau du front capillaire. Il existe un gradient de teneur en eau proche du front capillaire. Ce<br />
gradient est peu marqué dans le cas de la pierre de Sébastopol <strong>et</strong> la partie de la pierre au-<strong>des</strong>sus du<br />
front d’imbibition reste quasiment sèche. Au contraire, dans le cas du tuffeau blanc, il existe un<br />
gradient marqué qui s’étend sur près de trois centimètres en aval du front capillaire où la zone proche<br />
du front capillaire est saturée à 60 % au lieu de 80 % comme la base de la zone imbibée. Ceci est<br />
provoqué par un remplissage progressif <strong>des</strong> différents pores capillaires. En eff<strong>et</strong>, contrairement à la<br />
pierre de Sébastopol, le tuffeau possède une structure poreuse étalée en taille de pores <strong>et</strong> à tendance<br />
bimodale (mesoporosité de type III générée principalement par l’arrangement <strong>des</strong> sphérules d’opale <strong>et</strong><br />
microporosité de type I générée principalement par l’état de surface <strong>des</strong> sphérules d’opale). Ceci<br />
forme donc un système à deux réseaux poreux, ayant <strong>des</strong> pores de taille différente <strong>et</strong> donc une vitesse<br />
100<br />
Kévin Beck (2006)