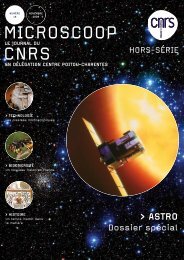Étude des propriétés hydriques et des mécanismes d ... - sacre
Étude des propriétés hydriques et des mécanismes d ... - sacre
Étude des propriétés hydriques et des mécanismes d ... - sacre
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Chapitre 2 : Caractérisation morphologique <strong>des</strong> matériaux<br />
Tuffeau blanc Pierre de Sébastopol<br />
Densité <strong>des</strong> soli<strong>des</strong> ρs (g/cm 3 ) 2,54 2,70<br />
Porosité totale Ntot 48,4 % 42,6 %<br />
Tableau II.5 : résultats de la pycnométrie pour le tuffeau blanc <strong>et</strong> la pierre de Sébastopol<br />
Les différences principales entre les deux pierres peuvent se visualiser facilement par le coefficient<br />
de dispersion <strong>et</strong> le diamètre seuil. Le domaine poreux du tuffeau est très étendu (Cd = 41) alors qu’il<br />
est beaucoup plus restreint autour d’une valeur moyenne dans la pierre de Sébastopol (Cd = 4), <strong>et</strong> c<strong>et</strong>te<br />
valeur correspond à un réel seuil de percolation de la pierre qui est de l’ordre de 20 µm. Le diamètre<br />
de pore seuil du tuffeau est d’environ 5 µm. Ainsi, l’analyse porosimétrique indique qu’il existe un<br />
facteur 4 entre le tuffeau blanc <strong>et</strong> la pierre de Sébastopol concernant le diamètre seuil d’accès de pore.<br />
La morphologie du milieu poreux a été approchée par porosimétrie au mercure qui donne une allure<br />
de la distribution porale du matériau. Il faut néanmoins avoir conscience que la porosimétrie au<br />
mercure est une méthode invasive mesurant le volume cumulé <strong>des</strong> différents diamètres d’accès au pore<br />
comme les étranglements, <strong>et</strong> non <strong>des</strong> diamètres réels <strong>des</strong> pores. De même, les images de microscopie<br />
ne sont que bidimensionnelles <strong>et</strong> ne montrent donc que <strong>des</strong> coupes de pores. L’approche la plus<br />
représentative de l’organisation texturale pourrait être obtenue par une analyse en trois dimensions de<br />
la pierre à partir d’une reconstitution d’images réalisées par tomographie à rayons X (Al-Raoush,<br />
2005 ; K<strong>et</strong>cham, 2005 ; Taud, 2005). Mais là encore, les dimensions réduites <strong>des</strong> échantillons testés <strong>et</strong><br />
la faible résolution <strong>des</strong> mesures limitent la parfaite représentativité <strong>des</strong> données obtenues. La taille<br />
courante <strong>des</strong> voxels est d’une dizaine de micromètres (Gualda, 2006 ; Cnudde, 2006) <strong>et</strong> l’inconvénient<br />
principal de c<strong>et</strong>te technique est la forte limitation de la taille de l’échantillon analysé quand on veut<br />
avoir une bonne résolution (Wildenschild, 2002), <strong>et</strong> les meilleures résolutions sont de l’ordre de 0,2<br />
µm, ce qui laisse encore une large gamme de pores inexplorés pour une pierre comme le tuffeau.<br />
3.3.2. Surface spécifique<br />
La surface spécifique est définie pour un milieu poreux comme la somme <strong>des</strong> surfaces développées<br />
par les particules formant le squel<strong>et</strong>te du milieu (<strong>et</strong> donc la surface <strong>des</strong> parois <strong>des</strong> pores) pour une<br />
unité de masse du matériau poreux. Elle représente donc la surface susceptible de fixer <strong>des</strong> molécules<br />
par adsorption <strong>et</strong> varie essentiellement selon la taille <strong>des</strong> pores <strong>et</strong> l’importance de la fraction argileuse.<br />
La valeur de surface spécifique la plus proche de la réalité est donnée par l’adsorption physique <strong>et</strong> la<br />
condensation capillaire de gaz à basse température (méthode B.E.T. de Brunauer-Em<strong>et</strong>t-Teller du<br />
noms de ses auteurs, 1938). Le principe de c<strong>et</strong>te méthode est détaillé à l’annexe A.4. Des échantillons<br />
d’environ 1 cm 3 (volume suffisant pour être représentatif <strong>des</strong> matériaux) sont préalablement séchés <strong>et</strong><br />
dégazés à 140°C pendant 24 heures pour s’assurer de l’évaporation de toute l’eau de l’espace poral.<br />
L’isotherme d’adsorption-désorption d’azote à 77 K (température d’ébullition de l’azote) est réalisée<br />
Kévin Beck (2006) 79