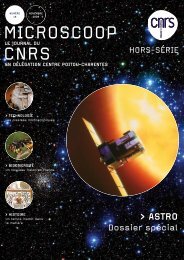Étude des propriétés hydriques et des mécanismes d ... - sacre
Étude des propriétés hydriques et des mécanismes d ... - sacre
Étude des propriétés hydriques et des mécanismes d ... - sacre
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Chapitre 1 : les formes d’altérations rencontrées<br />
épaisseur, sa couleur, sa composition dépendent de la nature <strong>et</strong> de l’âge de la pierre ainsi que <strong>des</strong><br />
conditions environnementales (Figure I.3). L’aspect en épiderme s’observe facilement sur la figure<br />
I.3.a où on peut distinguer n<strong>et</strong>tement, sur une main courante en tuffeau, une patine ocre d’aspect lustré<br />
<strong>et</strong> le cœur de la pierre qui reste blanchâtre. Les patines peuvent se former rapidement comme le<br />
montre la figure I.3.b où une pierre neuve posée en 1998 s’est recouverte d’une fine pellicule ocre<br />
d’aspect satiné. Les patines couvrent généralement les surfaces exposées aux intempéries <strong>et</strong> donc<br />
soumises à <strong>des</strong> alternances d’imbibitions <strong>et</strong> de séchages, <strong>et</strong> elles ne se forment pas de façon homogène<br />
sur toutes les pierres d’un monument. Sur les pierres situées à l’abri <strong>des</strong> intempéries, ou au contraire<br />
soumises à <strong>des</strong> lessivages entraînant <strong>des</strong> dissolutions, les patines sont inexistantes. L’acquisition de<br />
ces teintes superficielles ocres est souvent due à un très léger enrichissement en oxy<strong>des</strong> de fer de la<br />
couche externe de la pierre (quelques centièmes de pourcentage suffisent). Lors <strong>des</strong> migrations <strong>des</strong><br />
flui<strong>des</strong> par capillarité, les oxy<strong>des</strong> disséminés dans la pierre sont transférés vers la surface<br />
d’évaporation où ils s’accumulent. L’induration superficielle est due à un enrichissement en surface de<br />
minéraux comme du gypse ou <strong>des</strong> carbonates <strong>et</strong> oxalates de calcium, qui viennent combler la porosité.<br />
14<br />
(a)<br />
(b)<br />
Figure I.3 : patines observées sur une main courante en tuffeau (cloître de la Psal<strong>et</strong>te – Tours).<br />
(I.3.a : patine sur une pierre ancienne ; I.3.b : patine sur une pierre posée en 1998)<br />
Par ailleurs, suivant la composition minéralogique ce ces patines, il est utile de préciser les notions<br />
de calcin <strong>et</strong> de sulfin, couramment utilisées par les tailleurs de pierre. Le calcin est une induration<br />
superficielle de calcite. C<strong>et</strong>te croûte plus dense que le reste de la pierre induit une augmentation de<br />
dur<strong>et</strong>é d’autant plus grande que la pierre est tendre (Pauly, 1990). Il est admis que le calcin constitue<br />
une matière qu’il faut conserver car elle constitue une protection tant qu’elle conserve sa cohésion.<br />
Mais dans de nombreux cas, le calcin se détache de la surface sous forme de p<strong>et</strong>ites plaques qui se<br />
révèlent riches en sulfates mais sans réelle accumulation de particules noires (Figure I.4). C<strong>et</strong>te croûte<br />
a d’abord été appelée "mauvais calcin", puis sulfin à cause de sa composition chimique riche en sulfate<br />
<strong>et</strong> par analogie avec le calcin.<br />
Kévin Beck (2006)