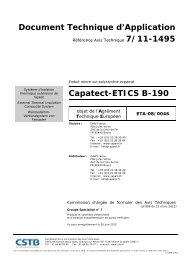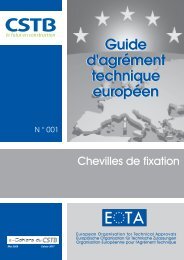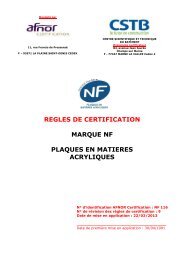Fissuration des mortiers - CSTB
Fissuration des mortiers - CSTB
Fissuration des mortiers - CSTB
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1 Introduction<br />
Influence de la carbonatation sur la fissuration<br />
Cette étude a été réalisée dans le cadre du stage de master recherche de T. Mauroux, dont le<br />
rapport est disponible à cette référence (Mauroux 2007 [31]).<br />
Le processus appelé carbonatation est une réaction naturelle qui se produit entre les principaux<br />
hydrates de la matrice cimentaire et le dioxyde de carbone contenu dans l’atmosphère<br />
(cf. chapitre 1 paragraphe 5.3). Dans <strong>des</strong> conditions normales, la concentration en CO2 dans<br />
l’air ambiant est d’environ 0,01 %. La carbonatation est donc un processus extrêmement lent,<br />
gouverné à la fois par la source de CO2 disponible pour réagir, et par sa diffusion très lente au<br />
travers du matériau. Cette réaction a surtout été étudiée dans le cadre de problématiques touchant<br />
à la corrosion <strong>des</strong> armatures en acier dans le béton armé. En effet, la conséquence directe<br />
de la consommation de la portlandite par la réaction de carbonatation, est une baisse du pH de la<br />
solution intersticielle, qui détruit la couche de passivation <strong>des</strong> aciers et provoque leur corrosion.<br />
Toutefois ce phénomène engendre d’autres modifications chimiques, physiques et<br />
mécaniques qui sont moins souvent abordées. Ainsi la carbonatation provoque un retrait du<br />
matériau qui pourrait, selon Houst (Houst 1992 [35]), induire une macro-fissuration à long<br />
terme de la structure. Les expériences sur le sujet ont consisté, dans l’ensemble, à effectuer <strong>des</strong><br />
mesures de retrait libre. Or, seuls les essais de retrait empêché sont capables de rendre compte<br />
<strong>des</strong> contraintes que subit une couche de mortier mise en oeuvre sur un support rigide.<br />
Afin de comprendre comment agit ce phénomène sur le comportement mécanique d’une<br />
couche mince, nous avons décidé de réaliser <strong>des</strong> essais à l’anneau dans <strong>des</strong> conditions de carbonatation<br />
accélérée. Nous avons également mené en parallèle <strong>des</strong> essais de fluage en compression,<br />
et <strong>des</strong> essais de caractérisation classiques afin de pouvoir mieux intérpréter les résultats<br />
obtenus.<br />
2 Matériaux et outils d’investigation<br />
2.1 Formulation du mortier CEReM3<br />
La première difficulté de l’étude réside dans l’impossibilité de réutiliser l’un <strong>des</strong> <strong>mortiers</strong><br />
CEReM pour le tester dans <strong>des</strong> conditions de carbonatation accélérée. Ceci est vrai pour deux<br />
raisons principales. La première est que le mortier CEReM, comme le mortier CEReM2 (utilisé<br />
au chapitre 5), contient une quantité initiale de calcite apportée par le filler calcaire. Ceci rend<br />
difficile la quantification de la calcite, formée seulement par carbonatation de la portlandite, par<br />
analyse thermo-gravimétrique (ATG) ou par observation au microscope électronique à balayage.<br />
La seconde est que l’étude du retrait de carbonatation doit être totalement découplée de la<br />
<strong>des</strong>siccation initiale du matériau. A ce sujet, certains auteurs pensent que ces deux retraits sont<br />
intimemement liés et indissociables. Baron et Sauterey (Baron et Sauterey [89]) pensent que<br />
le retrait de carbonatation est même proportionnel au retrait de <strong>des</strong>siccation. Pour dissocier les<br />
deux, il est nécessaire de sècher notre mortier jusqu’à stabilisation du retrait de <strong>des</strong>siccation.<br />
Il faut donc impérativement un mortier capable de résister aux contraintes engendrées par la<br />
<strong>des</strong>siccation jusqu’à stabilisation de celles-ci afin de pouvoir mesurer les contraintes engendrées<br />
par la carbonatation. Ce postulat de départ écarte d’ores et déjà le mortier CEReM pour cette<br />
étude.<br />
Nous avons fait le choix de nous baser sur la composition CEReM2 et de lui appporter<br />
quelques modifications. En premier lieu, le filler calcaire est remplacé par du filler siliceux.<br />
86